Avec Après Jean-Luc Godard / Je me laisse envahir par le Vietnam, le jeune metteur en scène se juche sur les épaules du réalisateur suisse pour repousser les limites de la représentation théâtrale, et accouche d’une expérience subjuguante d’intensité intellectuelle.
En dépit de son titre, Après Jean-Luc Godard / Je me laisse envahir par le Vietnam n’est pas un spectacle sur le réalisateur, ni à propos de ses films, ni même autour des deux réunis. Après Jean-Luc Godard / Je me laisse envahir par le Vietnam est une œuvre théâtrale d’après Jean-Luc Godard, une plongée dans les contreforts de la psyché créatrice d’un homme qui a renversé la table, explosé les cadres et continue, encore aujourd’hui, à étendre le domaine de la lutte artistique. Pour son premier spectacle en dehors du cocon de l’Ecole du TNS où il a fait ses gammes au sein de la promotion 44, Eddy D’aranjo ne s’est pas penché sur le mythe Godard, sur le réalisateur d’Epinal, celui du Mépris, d’A bout de souffle, de Pierrot le Fou ou de Vivre sa vie, mais s’est plutôt juché sur les épaules du Godard « d’après », celui qui, depuis l’expérience du groupe Dziga Vertov, et plus encore depuis les années 1980, ne cesse de vouloir sortir de l’impasse dans laquelle la prétendue « mort du cinéma », qu’il a lui-même décrétée, l’a plongé. Un Godard du temps présent, en somme, qui réalise Film Socialisme, dit Adieu au langage et bâtit Le Livre d’image. Alors, dans l’esprit de ce « JLG »-là, qui questionne inlassablement le cinéma pour en repousser les limites, Eddy D’aranjo interroge son art, le théâtre, pour ausculter ses ressorts et ses carences, pour évaluer ce qu’il est, surtout, capable de représenter ; non pas dans une quête du réel, ou de l’ultra-réel – à la manière, par exemple, d’un Alexander Zeldin –, mais bien avec la volonté de le dépasser et de combler ses manques. Concept en diable, pourront arguer certains, Après Jean-Luc Godard / Je me laisse envahir par le Vietnam s’impose, en réalité, comme le témoin saisissant de la puissance intellectuelle de son jeune auteur.
Avec l’ambition dévorante de tout embrasser, Eddy D’aranjo ouvre son exploration par une fiction. Pleurer Jeannot, s’intitule-t-elle, telle une injonction à prendre soin de ce qui est en train de disparaître – ou a peut-être déjà disparu. Jeannot, c’est le nom de cet homme, brinquebalant, dépendant, dont le crépuscule point déjà depuis quelques mois. Essoré par le temps dont les ravages s’observent sur son visage, il s’échine à vouloir éplucher une pomme qui lui résiste et échange par la pensée avec une femme – la sienne, peut-on supposer – qui, au vu de son air fantomatique, a déjà fait le grand saut. Victime d’une mauvaise chute, le vieil homme se vaporise et cède sa place à ce qui lui reste d’entourage : son aide-soignante, Anna, son neveu, Adrien, accompagné par sa soeur, Camille, et par son petit-ami, Jack. Tandis qu’en arrière-plan, la scénographe du spectacle, Clémence Delille, et sa régisseuse générale, Edith Biscaro, – qui se sont annoncées au début de la représentation – empaquettent déjà les affaires du disparu, l’aréopage juvénile se lance dans une succession de pas de deux. Entre eux, il n’est question d’aucun small talk, d’aucune précaution, d’aucun réalisme, pourrait-on presque oser.
Exhumant les contentieux intimes passés et présents, leurs prises de parole se fondent sur un langage au-delà du réel, sur cette poétique qui n’affleure jamais et qui reste, en théorie, au tréfonds des êtres, trop occupée à remuer, sans que cela soit avouable, leur intérieur. En cela, Eddy D’aranjo s’essaie à un geste théâtral post-cathartique qui chercherait non pas à reproduire la réalité pour expurger les passions, mais à verbaliser l’indicible et à créer des images essentielles pour pleurer. A mi-chemin entre le Godard des débuts, dont les dialogues très écrits traduisent aussi les tourments humains – mu par la conviction, disait-il, que « le cinéma substitue à notre regard un monde qui s’accorde à nos désirs » –, et du « JLG » d’aujourd’hui, qui plaque, avec sa voix d’outre-tombe, des certitudes métaphysico-philosophiques sur une série composite d’images, le jeune metteur en scène et son comédien, Volodia Piotrovitch d’Orlik, accouchent d’un texte d’une beauté aussi fatale que soumise à conditions. Pour l’éprouver, il faut accepter d’entrer dans le système, d’exploser le cadre théâtral pré-conçu, de chausser les lunettes, nouvelles, qui nous sont tendues afin de prendre conscience que tout, jusqu’à la direction d’acteurs distanciée, est le résultat d’un calcul savant et d’une précision sans faille, permise par ses quatre acteurs, Majda Abdelmalek, Nans Merieux, Bertrand de Roffignac et Léa Sery.
A la confluence des influences
Déstabilisante en soi, l’expérience aurait pu s’arrêter là, mais Eddy D’aranjo, bien conscient qu’il lui revient désormais de finir le travail, comme on analyserait le revers d’une médaille, décide de passer de l’irréalisé à l’irreprésenté. Pour opérer cette transition, il rappelle Jeannot, revenu d’entre les morts ou, plus probablement, de l’EHPAD où il avait été placé. Nu comme un ver, le vieil homme s’est « oublié », obligeant son entourage à le nettoyer. Il n’est alors plus question de « parler avec des mots », mais bien avec des gestes et, au fond, « avec des sentiments », de montrer cette réalité que l’on cache, sciemment, au fin fond des institutions, de mettre au vu et au su de tous cette dégradation humaine et, en même temps, cet amour inconditionnel qui, par sa pureté, fait achopper le langage. Si elle mériterait sans doute d’être resserrée, cette séquence, qui prend bien vite l’allure d’un rituel, fait montre d’une proximité travaillée, et n’a d’autre objet que d’utiliser le théâtre pour faire remonter le réel, dans toute sa dureté, à la surface.
Car, dans la seconde partie qu’il préfigure, Eddy D’aranjo bifurque. Il n’est alors plus affaire de fiction, mais de métathéâtre qui ausculte, cette fois, « un spectacle en train de disparaître » et dépasse rapidement la stricte exégèse qu’on l’on pouvait craindre. En même temps que le décor de Clémence Delille, dont la précision est, comme toujours, remarquable, Volodia Piotrovitch d’Orlik, jusqu’ici caché sous le masque de Jeannot, déconstruit, face public, puis face caméra, le spectacle tel qu’il s’est fait et tel qu’il est en train de se faire. Il y raconte les tentatives et les tentations, les décalages temporels et les écarts conceptuels, les chausse-trapes aussi, comme cet essai avorté de reconstituer certaines scènes de Godard, de mettre le cinéma à l’épreuve du théâtre, alors que, comme le souligne Clémence Delille en préambule, « on ne peut pas faire ici ce qu’on peut faire là-bas ; mais on ne peut pas non plus faire là-bas ce qu’on peut faire ici ». Alors, dans une ultime mise à l’épreuve du théâtre, Eddy D’aranjo lui soumet ces Images malgré tout, ces quatre clichés pris par des membres du Sonderkommando dans le camp d’Auschwitz-Birkenau auxquels Georges Didi-Huberman a consacré un livre, tels des reliques clandestines de la machine d’extermination nazie que le cinéma, au grand dam de Godard, a échoué à saisir. Logiquement, l’entreprise achoppe et touche aux limites de l’irreprésenté, mais elle étonne par sa profondeur intellectuelle, sa forme radicale, et le jeu « blanc » de Volodia Piotrovitch d’Orlik, comme matériau d’un théâtre qui ne reste théâtre que par la réflexivité, intense, qu’il impose.
Aussi exigeante que stimulante intellectuellement, l’expérience théâtrale du jeune metteur en scène tient sa puissance de la confluence des influences où elle se situe. Au-delà des quelques citations rendues à Godard – la scène culte du Mépris entre Bardot et Piccoli, les mots en gros plan d’Adieu au langage, le smartphone comme vecteur d’interview, à la manière de ce que le cinéaste avait lui-même pu faire lors du Festival de Cannes 2018… –, Eddy D’aranjo a su s’inspirer de la maestria scénique d’un Julien Gosselin – auprès de qui il travaille en tant que dramaturge –, de la vision castelluccienne de la décrépitude humaine – Sur le concept du visage du fils de Dieu –, de la distanciation d’une Marie-José Malis – dont il fut l’assistant sur Hypérion. Sauf que, loin de tout esprit de compilation, tout se passe comme si Eddy D’aranjo avait tout digéré pour en faire son propre miel, et donner, déjà, une identité à son théâtre. Un art qu’il malaxe comme Godard malaxe le cinéma. Le réalisateur ne pouvait pas rêver plus bel hommage.
Vincent Bouquet – www.sceneweb.fr
Après Jean-Luc Godard / Je me laisse envahir par le Vietnam
Texte, conception et mise en scène Eddy D’aranjo
Avec Majda Abdelmalek, Nans Merieux, Volodia Piotrovitch d’Orlik, Bertrand de Roffignac, Léa Sery et Édith Biscaro, Clémence Delille
Collaboration artistique Volodia Piotrovitch d’Orlik
Scénographie et costumes Clémence Delille
Collaboration technique Edith Biscaro
Lumière Anne-Sophie Mage
Son Saoussen Tatah
Vidéo Typhaine SteinerProduction déléguée Prémisses
Coproduction La Commune – Centre dramatique national d’Aubervilliers, Théâtre National de Strasbourg, Théâtre de la Cité internationale
Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National
Avec le soutien du Fonds d’Insertion pour Jeunes Comédiens de l’ESAD – PSPBB, de la Région Île-de-France et de la DRAC Île-de-France
Remerciements Compagnie Si Vous Pouviez Lécher Mon CœurEddy d’Aranjo est le lauréat 2019 du Dispositif Cluster initié par Prémisses, Office de production artistique et solidaire pour la jeune création, et est à ce titre en résidence de création et d’action artistique au Théâtre de la Cité internationale pendant trois ans. Il est artiste associé à la Commune – Centre dramatique national d’Aubervilliers, au Théâtre Olympia – Centre dramatique national de Tours, et au Théâtre National de Strasbourg.
Durée : 2h45
Théâtre National de Strasbourg
du 22 février au 2 mars 2022La Commune – Centre dramatique national d’Aubervilliers
du 10 au 20 mars 2022Théâtre de la Cité Internationale, Paris
du 4 au 19 avril 2022





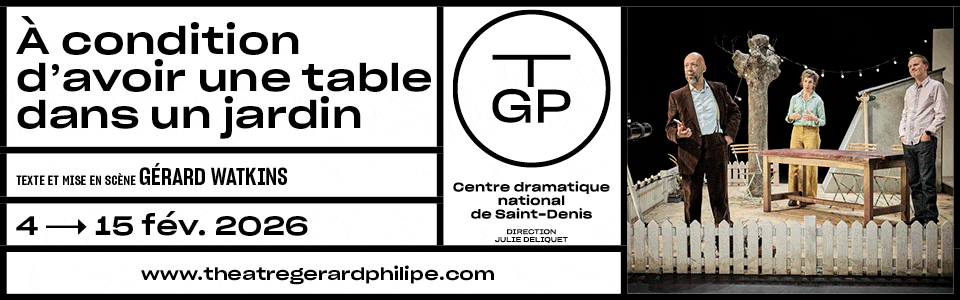








Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !