Conçue comme un appendice autonome de son magistral Liebestod, la dernière création de la performeuse espagnole, donnée au CDN d’Orléans, n’en a malheureusement ni le souffle, ni la puissance.
Habituellement, arrive toujours un moment où Angélica Liddell s’y colle, où, au beau milieu de son enchaînement de tableaux, généralement remarquables, la performeuse espagnole s’avance, se fige et empoigne un micro pour administrer à son auditoire une charge verbale, parfois logorrhéique, souvent sublime. On se souvient d’ailleurs, avec une émotion certaine, de la déflagration causée par sa saillie la plus récente, coeur battant de son magistral Liebestod, qui avait fait trembler, l’été dernier, les murs de l’Opéra Confluence dans le cadre du Festival d’Avignon. Plus à nu que jamais, l’artiste s’y sacrifiait sur l’autel du théâtre et emportait tout un monde dans sa tombe, grâce à une plume acérée qui portait le langage théâtral à des sommets, à la fois renversants et bouleversants de justesse. Rien de tel, malheureusement, avoue-t-on d’emblée, dans sa dernière création, Terebrante, donnée en première mondiale au CDN d’Orléans. Conçue comme un appendice autonome de son opus précédent, cette proposition plus intimiste n’en a ni le souffle, ni la puissance, tel un livre d’images replié sur lui-même.
Angélica Liddell y exploite pourtant un filon cousin, venu des profondeurs de la culture espagnole, où la figure du toréro Juan Belmonte aurait cédé sa place au flamenco, ou plutôt au siguiriya qui en est l’un des chants traditionnels, avec la mort et le deuil pour principaux berceaux. Comme si, après l’offrande sacrificielle de Liebestod, venait le temps de la douleur térébrante, celle qui ne cesse de s’amplifier, de redoubler, et aurait l’effet d’« un coup de poignard sur un coup de poignard », résume l’artiste. Telle l’« obsession d’une même note antérieure au langage », décrit le réalisateur José Val del Omar, le siguiriya pousse la performeuse à se passer du pouvoir de la langue – qui constitue son atout maître – et à s’adonner à une cérémonie muette, primitive, où les symboles auraient remplacé les mots. Au fil des tableaux, se devinent quelques-uns de ses traditionnels tropismes : sa déchirure originelle liée à un désir d’amour impossible à rassasier, sa relation ambigüe avec l’enfance comme paradis perdu, son goût pour le sacré qu’elle cherche à ressusciter et pour le rituel qu’elle entend orchestrer… Telle qu’en elle-même, elle n’hésite pas à jouer la carte de la stratégie du choc pour essayer de sidérer, puis de cueillir, les spectateurs, comme lors de ce prologue où elle fume, culotte baissée, avec son vagin et son anus, ou, pire encore – et les âmes sensibles devront alors se soumettre ou se démettre –, lorsqu’elle diffuse, plusieurs minutes durant, une vidéo d’extractions dentaires en (très) gros plan. Tout tendant, comme elle l’écrit en épilogue, à se servir de la souffrance pour faire naître la beauté, dans un environnement, guitares et drapeau faisant foi, imprégné de culture gitane.
Il serait faux de dire qu’Angélica Liddell n’atteint jamais son but, tant certaines images, à intervalles irréguliers, font esthétiquement mouche, à l’instar de ces guitares qui, après avoir dansé dans le vide, s’écrasent violemment au sol, ou de ce rite doublement dédoublé autour d’un bouquetin triomphant. Dans son expérimentation de la douleur, physique ou psychologique, le sacrifice revient comme une antienne, qu’il s’agisse de celui d’un poulet, d’un bœuf, de la musique, de l’être-aimé, et d’elle-même, qui finit, littéralement, imbibée d’alcool en tous genres. Sauf que, s’il est possible de capter quelques signaux parmi la myriade envoyés par l’artiste, il est impossible de tous les décrypter, et tout se passe comme si elle se complaisait dans un hermétisme savamment calculé, dont elle seule détiendrait la clef qu’elle se plairait à jalousement garder. Surtout, si l’âme et le charme parviennent bien, de temps à autre, à poindre sous cette cuirasse passablement étanche, l’ensemble apparaît, en définitive, curieusement et largement froid, raide, par trop maîtrisé, voire emprunté. Comme si, pour cette fois, et c’est là que le bât blesse vraiment, Angélica Liddell elle-même n’y croyait pas franchement.
Vincent Bouquet – www.sceneweb.fr
Terebrante
Texte, mise en scène, scénographie et costumes Angélica Liddell
Avec Angélica Liddell et la participation de Salté Ye, Gumersindo Puche et Palestina de los Reyes
Assistant à la mise en scène Borja López
Régisseurs Nicolas Guy, Michel Chevallier
Son Antonio Navarro
Assistant lumières Tirso IzuzquizaCoproduction Atra Bilis, ERT Emilia Romagna Teatro Fondazione, CDN Orléans / Centre – Val-de-Loire, IAQUINANDI S.L., Festival Temporada Alta Girona
Durée : 1h20
CDN Orléans / Centre – Val-de-Loire
les 29 et 30 octobre 2021Festival Temporada Alta, Gérone
le 19 novembreFestival de Otoño, Madrid
les 27 et 28 novembreEmilia Romagna Festival, Bologne
les 29 et 30 avril 2022
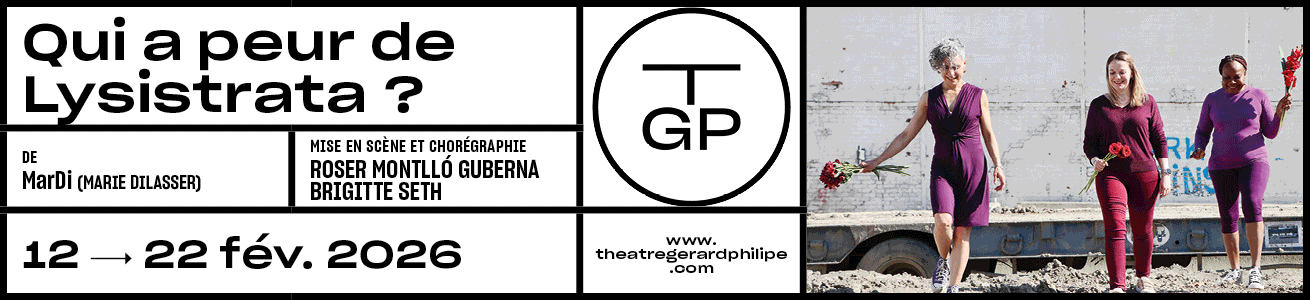













Si la performance d’ingéniosité Lidell est décevante, elle a au moins le mérite d’avoir généré votre texte dont la tenue donnerait presque envie d’aller voir l’œuvre malgré ses limites que vous exposez si bien. Merci pour ce précieux travail de décryptage.