Avec ສຽງຂອງຍ່າ (La voix de ma grand-mère), Vanasay Khamphommala fait du théâtre un lieu de réconciliation, de dialogue entre ses origines laotiennes et sa culture européenne. Elle fait pour cela appel à l’archive vivante qu’est son père, avec qui elle réalise un rituel fait d’éléments culturels divers. Aux systèmes de domination et aux hiérarchies existantes, cette création oppose une douceur et une intelligence rares et contagieuses.
Pour Vanasay Khamphommala, « impossible » n’est pas français. Il n’est guère plus laotien. Avec sa compagnie Lapsüs Chevelü créée en 2017, l’artiste déploie une esthétique queer qui relie ce qui est habituellement séparé dans nos sociétés : les genres, les vivants et les morts, les cultures et les langues, les pratiques populaires et les représentations et systèmes de pensée considérés comme supérieurs par ceux qui les produisent et en font usage… Ce goût du mélange, qui se cristallise sous des formes différentes, tantôt sur des scènes de théâtre, tantôt dans des lieux non dédiés à cet art, a vocation à bousculer bien des certitudes, notamment quant au rapport entre les nombreux éléments qu’elle fait se rencontrer dans ses créations. Il arrive alors que, dans ces opérations de brassage, se produisent des accouplements inattendus. Voilà les « beautés nouvelles » que cherche à produire Lapsüs Chevelü dans sa quête de « transphormation du monde » présente dans toutes les créations de la compagnie, dont la recherche d’alternatives porte aussi sur les modes de production et de diffusion du spectacle vivant. Cette démarche singulière, que l’on retrouve au cœur de ສຽງຂອງຍ່າ (La voix de ma grand-mère), créé au Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine (TnBA), abolit la notion d’« impossible ». Elle repousse toujours plus les interdits.
En choisissant pour titre un mot laotien, Vanasay Khamphommala poursuit ce qu’elle avait commencé en toute fin d’Écho (2022), sa création précédente : la convocation de ses origines laotiennes, qu’elle considérait jusque-là comme étant étanches à sa culture française et européenne acquise dans le cadre de sa formation intellectuelle et artistique. Afin de remplir la mission qu’elle s’était fixée au seuil de sa pièce, rien moins que guérir l’humanité du chagrin d’amour, elle faisait en effet appel dans Écho à un rituel musical laotien, le sen, utilisé dans l’exorcisme des chagrins d’amour. En prenant place sur les coussins ou les tabourets disposés en cercle, les spectateurs de ສຽງຂອງຍ່າ (La voix de ma grand-mère) ayant le souvenir d’Écho peuvent avoir la sensation que nul temps ou très peu a passé entre les deux créations. Tournant autour de l’autel qui trône au centre de son plateau miniature recouvert de tapis colorés, au rythme d’une musique lao des années 1980, Vanasay Khamphommala n’a guère besoin de dire l’entre-deux cultures et l’entre-deux époques depuis lequel elle s’apprête à s’adresser à nous : sa mise et sa marche dansante lui tiennent lieu de parole. Avant qu’elle n’use de cette dernière davantage et de manière beaucoup plus intime qu’elle ne l’a fait jusque-là dans aucun de ses spectacles.
Habillée d’une jupe traditionnelle lao, ou « sin », et d’un survêtement de sport, chaussée de sabots à plateforme en plastique décorés de petites figures type jeu vidéo, Vanasay se présente à nous comme une hôtesse joyeusement hybride. En nous invitant à ne rejoindre nos places qu’après nous être déchaussés, elle ne nous fait pas seulement quitter notre espace-temps habituel, mais nous fait entrer dans le sien, qui se situe à la croisée de plusieurs cultures et du côté du rituel qui est au cœur du langage de Lapsüs Chevelü. « ສະບາຍດ [« bonjour » en lao, NDLR]. Au Laos, on retire souvent ses chaussures en signe de respect — quand on rentre chez quelqu’un, ou quand on participe à une cérémonie comme le ສ)’ຂວ+ນ, par exemple », nous dit-elle en guise d’accueil. Comme l’indique son titre, ສຽງຂອງຍ່າ (La voix de ma grand-mère) s’ancre dans une réalité composite, laotienne autant qu’européenne, qui préexiste en partie au temps de la représentation et, pour le reste, s’y bâtit devant nous. Comme dans Écho, cette construction complexe se réalise suivant un objectif tel que les aime Vanasay Khamphommala, non pas « impossible », donc, mais pouvant être jugé comme tel selon une logique occidentale : retrouver la voix de sa grand-mère lao qu’elle n’a pas connue, car décédée au Laos il y a près de 80 ans. Soit l’âge de son fils, autrement dit du père de Vanasay, Somphet Khamphommala. Ce n’est pas la première fois que Lapsüs Chevelü regarde vers la mort, qu’elle cherche à la rendre présente quand tout autour la rejette ou la dissimule. Non dans les larmes, mais au contraire avec un esprit de fête, comme au Laos où la mort donne lieu à la noce.
Annoncée très tôt dans le spectacle, l’entrée en scène de Somphet Khamphommala fait vraiment démarrer le rituel, qui cohabite alors avec le récit de l’enquête menée au Laos par Vanasay – accompagnée parfois du créateur sonore Robin Meier Wiratunga. Le dialogue économe qu’entretiennent alors père et fille est la part visible et audible d’un ample travail qui touche autant à l’Histoire qu’à la psychologie, en passant par une forme d’anthropologie ou encore par une réflexion linguistique. Indépendantes du spectacle, des vidéos et des textes réalisés par l’artiste et son équipe faite de personnes très différentes, mais toutes traversées par les questions de l’exil et de l’identité, peuvent donner accès au spectateur à différentes strates de cette riche et grande recherche. Les gestes et les mots employés par le duo père-fille convergent quant à eux pour l’essentiel vers la cérémonie qui occupe le centre du spectacle, dont on découvre que l’objet réel n’est pas tout à fait l’objet annoncé. Davantage que la voix de son aïeule en effet, c’est la mémoire de son père qu’explore Vanasay Khamphommala, faisant du théâtre un cadre rendant possible le partage d’un passé laotien empêché jusque-là par l’exil et la manière dont il est traité par la société française.
Désigné archive vivante par sa fille, Somphet Khamphommala marque par sa seule présence la réparation de la rupture entre les deux générations. ສຽງຂອງຍ່າ (La voix de ma grand-mère) s’inscrit ainsi pleinement dans la passionnante démarche queer de l’artiste, dont le jeu avec les normes dépasse de loin la question du genre – jamais abordée ici, même si l’on peut deviner qu’elle est ou un sujet dans la relation père-fille – pour s’étendre à toutes les formes d’expression culturelle. La beauté et la délicatesse de ce dialogue témoignent d’une grande croyance dans les pouvoirs du théâtre. Elle se communique à l’audience avec la douceur et le plaisir que donne la sensation de se voir confier un secret intime et précieux. Lequel rencontre les douleurs de chacun et les apaise, invitant à se créer ses propres rituels et ses « beautés nouvelles ».
Anaïs Heluin – www.sceneweb.fr
ສຽງຂອງຍ່າ (La voix de ma grand-mère)
Conception Vanasay Khamphommala
Avec Vanasay Khamphommala, Somphet Khamphommala, et les voix de Sieng In Bounmisay, Naly Lokhamsay, Daly Hiangsomboun
Collaboration artistique Thomas Christin
Création sonore Robin Meier Wiratunga
Scénographie Kim lan Nguyễn Thi
Travail chorégraphique Olé Khamchanla
Costumes Vanasay Khamphommala, Marion Montel Tissage Mai Bounmisay, Souksavanh Chanthavanh, Monkham Thongpanya
Régie générale, son, plateau Maël Fusillier
Création lumière, régie lumière, plateau Léa DhieuxProduction Lapsus chevelü
Coproduction TnBA – Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine ; Théâtre des Îlets – Centre dramatique national de Montluçon ; Théâtre Olympia – Centre dramatique national de Tours ; Maison de la Culture d’Amiens ; L’Atelier à spectacle – Scène conventionnée du Pays de Dreux ; La Pop
Soutiens Région Centre-Val de Loire ; Département Indre-et-Loire ; Ville de Tours ; Institut français (aide à la création et à la mobilité au Laos) ; compagnie FANGLAO (Vientiane) ; Traditional Arts and Ethnology Center (Luang Prabang)Vanasay Khamphommala est lauréate MIRA de l’Institut français pour ce projet.
Lapsus chevelü est conventionnée par la DRAC Centre-Val de Loire, et soutenue par la Ville de Tours.Durée : 1h05
Vu en mai 2024 au Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine (TnBA)
Maison des Métallos, Paris
du 16 au 18 octobre 2025Théâtre de la Renaissance, Oullins
du 20 au 22 novembreCDN d’Orléans, dans le cadre du festival La Caverne
du 5 au 7 février 2026La Halle aux Grains, Scène nationale de Blois
le 13 marsThéâtre 13, Paris
du 4 au 7 mai
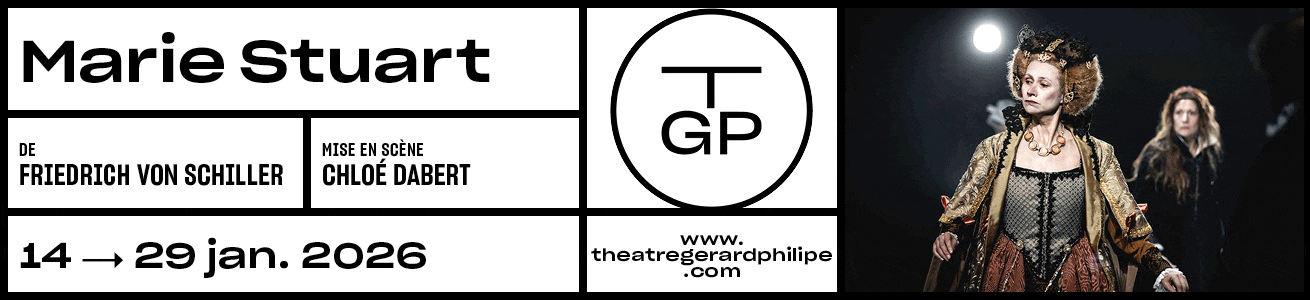

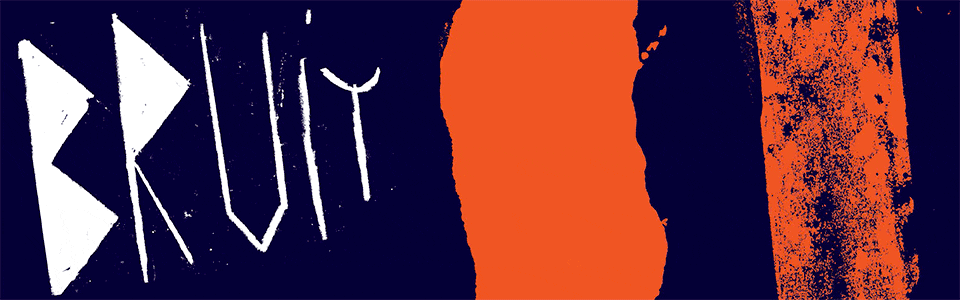


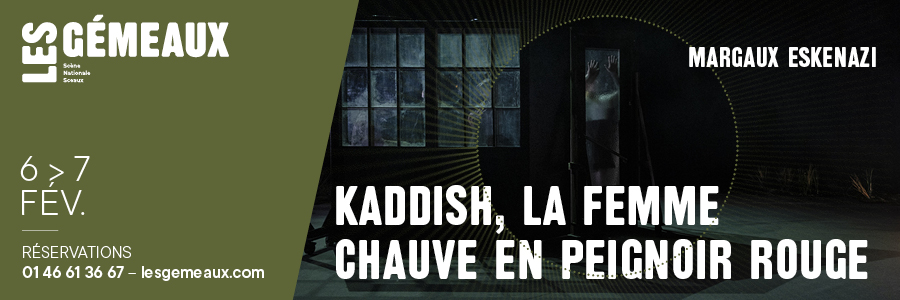







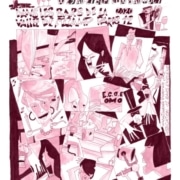
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !