Viktor Kyrylov, Ukrainien de 20 ans, se trouvait à Moscou le 24 février 2022 lors du déclenchement de l’invasion russe en Ukraine. Il était étudiant à l’école de théâtre russe, le GITIS. Son rêve d’enfance se transforme alors en cauchemar. Sa langue maternelle, le russe, devient celle de l’envahisseur. Réfugié en France avec sa famille, il poursuit ses études au Conservatoire national d’art dramatique de Paris, puis intègre l’Académie de la Comédie-Française. C’est là qu’il écrit son seul en scène, Maintenant je n’écris plus qu’en français, présenté au Théâtre de Belleville. Rencontre avec un comédien déraciné.
Où étiez-vous au tout début de la guerre en Ukraine ?
J’étais à Moscou. Je suis né à Odessa, dans le sud de l’Ukraine, qui est historiquement plutôt russophone. En 2019, je suis allé faire mes études de théâtre à Moscou, au GITIS, l’Institut d’État d’art théâtral. C’était mon rêve de gosse de faire du théâtre à Moscou parce que j’aimais tellement la littérature russe et ses écrivains. J’étais heureux d’entrer dans la grande tradition de l’enseignement développé par Stanislavski. Le matin du 24 février 2022, j’ai été réveillé par un appel de ma mère qui m’a dit que les Russes avaient commencé à bombarder notre ville natale.
Et là, dans votre tête, que se passe-t-il ?
Dans ma tête, tout a commencé à se bouleverser. J’étais perdu. Moi, l’Ukrainien, qui est allé faire ses études à Moscou par choix. Personne ne m’a forcé à le faire. Je me suis dit qu’en fait, j’étais un traître, un traître à ma patrie. C’était très perturbant. Je me suis dit que la seule chose qui pourrait me faire pardonner envers mon peuple, « me blanchir », comme on dit en français, serait de rentrer chez moi et de participer à la défense de ma patrie. Mais on s’est disputé avec ma mère qui m’a dit : « Viktor, je ne t’ai pas mis au monde pour que tu meures, tu dois choisir ». J’ai choisi ma mère.
Est-ce que ce sentiment de culpabilité continue de vous hanter ?
Oui, ma demande de pardon envers l’Ukraine ne m’abandonne pas.
Avez-vous encore des contacts avec vos anciens camarades du GITIS ?
Non. Après les bombardements sur le théâtre d’art dramatique de Marioupol en 2022, quand les Russes l’ont attaqué alors qu’il y avait presque 1 600 civils réfugiés à l’intérieur, dont des familles avec des enfants, j’ai coupé tous les contacts avec mes copains russes. Cet épisode a été trop douloureux.
Aviez-vous des relations avec la France ?
Non, pas du tout. Je ne savais pas parler français à l’époque. Je suis venu comme ça, juste parce que j’avais vu à l’époque Hiroshima mon amour, un vieux film de la Nouvelle Vague, que j’ai tellement aimé. Je me suis dit que les Français faisaient de belles choses. On m’a accueilli en tant que réfugié ukrainien, au Mans d’abord. J’ai envoyé un mail au Conservatoire national d’art dramatique de Paris, en disant que je voulais finir ma formation de théâtre débutée à Moscou. Et j’ai demandé à passer une audition pour rentrer au Conservatoire. Là, on m’a dit que je n’en avais pas besoin. C’était la volonté de la directrice de l’époque, Claire Lasne Darcueil, d’accueillir des étudiants ukrainiens. Il y en avait déjà trois. Puis, j’ai passé l’audition de l’Académie de la Comédie-Française, où je suis resté un an. Je suis le premier Ukrainien à avoir foulé le plateau de la salle Richelieu !
À partir de quand vous êtes-vous lancé dans l’écriture du spectacle ?
L’année dernière, lorsque que j’étais à l’Académie de la Comédie-Française. L’institution accompagne les étudiants dans la conception d’un projet. Et c’est Eric Ruf qui m’a vivement conseillé de commencer l’écriture de mon histoire, de raconter ce que j’avais vécu depuis le début de la guerre. J’ai présenté une première ébauche du texte lors d’une carte blanche.
Pourquoi avez-vous écrit le spectacle en français ?
Avant la guerre, il y avait environ 45 % de la population qui parlaient plus russe qu’ukrainien ; et avec la guerre, il m’est devenu impossible de parler en russe. Parce que c’est la langue de l’occupant. Pour moi, c’est une question tellement compliquée que, finalement, entre l’ukrainien et le français, je préfère parler français. Parce que je me suis réfugié dans cette langue, dans cette culture, dans ce théâtre. J’ai aussi été accompagné par Laurent Muhleisen, le conseiller littéraire de la Comédie-Française. Le texte a beaucoup navigué entre nos mains. Et puis, il y a eu une résidence au Théâtre de Belleville pour commencer à travailler le texte au plateau ; et enfin, cette proposition inouïe de Laurent Sroussi, le directeur du Théâtre de Belleville, de coproduire le spectacle, et de le programmer.
Que ressentez-vous quand vous êtes sur cette scène, au Théâtre de Belleville ?
Le théâtre, c’est ce qui me sauve. C’est là où je peux m’exprimer en entier. C’est un moment intime à partager avec le public. Dans la scénographie, il y a un tableau où l’on projette une cartographie animée qui résume l’histoire de l’Ukraine à travers les siècles ; puis, je retourne ce tableau qui devient un miroir. À ce moment-là, j’évoque cette question de la trahison, de la culpabilité. Je me parle à moi-même comme lorsque je suis chez moi. Et j’ai envie de cracher sur ce miroir, sur ce comédien ukrainien formé en Russie, et qui désormais parle français. C’est cette intimité que je veux partager avec le public. Ce spectacle est ma demande de pardon envers l’Ukraine et ma lettre de gratitude envers la France qui m’a hébergé.
Si un jour on vous propose de jouer un auteur russe, que ferez-vous ?
Je ne peux plus m’associer à cette langue qui était ma langue maternelle et surtout m’associer aux auteurs russes. Ça va, on joue beaucoup d’auteurs russes dans le monde ! Ils peuvent se débrouiller sans moi.
Propos recueillis par Stéphane Capron – www.sceneweb.fr
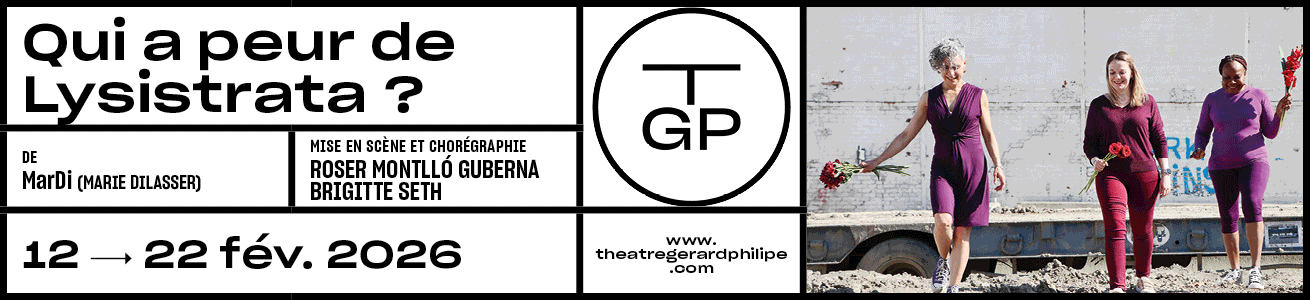




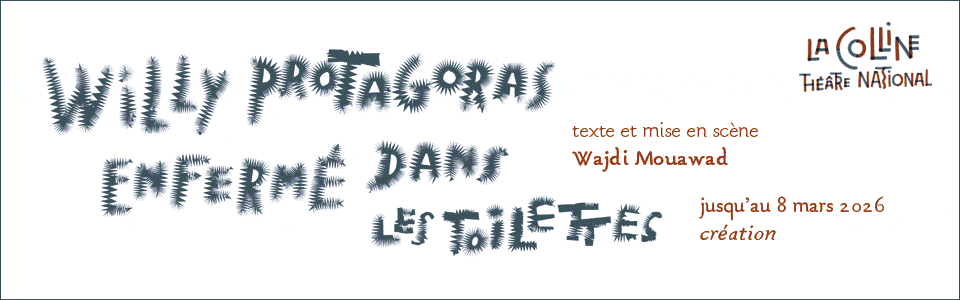







Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !