À l’Opéra Bastille, l’artiste iranienne Shirin Neshat présente sa lecture d’Aida de Verdi et défend un propos aussi bien esthétique que politique sur le sort cruel et déplorable des peuples opprimés, notamment des femmes, dans un Moyen-Orient ravagé par la guerre.
Importée du Festival de Salzbourg où elle a déjà été montrée deux fois, la singulière Aida de Shirin Neshat ouvre la saison de l’Opéra de Paris huit ans après sa création. On ne peut pourtant pas vraiment parler de reprise tant sa signataire a retravaillé pour affiner, renforcer, son geste, et ainsi mieux servir le propos qu’elle veut délivrer. Créé au Caire, l’opéra égyptien de Verdi quitte la cité antique des pharaons pour gagner l’Iran contemporain, et cela sans forcer le trait ni multiplier d’outranciers clins d’œil à l’actualité. Le décor sculptural placé au centre d’un plateau tournant est une grande boîte, dont les hauts murs en pierres dénudées et défraîchies sont d’une blancheur qui transpire l’éternité. Il figure autant un temple ancestral, où s’adonnent à la dévotion les foules religieuses, que le fatal tombeau dans lequel les amants périssent. L’espace met en tension une forte monumentalité et un net dépouillement. Dans une épure soignée se déploient ponctuellement des effets spectaculaires comme le sacrifice d’une bête, puis d’une jeune femme. D’étranges et droites silhouettes noires, maléfiques et mortifères, s’avancent en cortège. La mort rôde partout.
Sans doute, cette version d’Aida n’est pas un grand spectacle de théâtre dans la mesure où la direction d’acteurs peut demeurer assez classique et statique. Mais l’intérêt de la mise en scène se trouve davantage dans la puissance évocatrice de ces images fortes, soutenant un propos nécessaire sur l’oppression. À dessein, l’épisode central et le plus célèbre de l’œuvre, où l’armée victorieuse défile devant son roi en conduisant les prisonniers de guerre, n’a ici rien d’un péplum triomphant. Il prend même une tournure étonnamment crépusculaire alors qu’un film en noir et blanc, récemment tourné, présente en gros plan le déchaînement de violence exercé sur des corps misérables, arrachés et jetés au sol, dénudés, maltraités, avant leur exécution collective.
Fortement marquée par l’expérience de l’exil et du déracinement, Shirin Neshat ancre toute son œuvre plastique (photographies et vidéos) dans la culture persane au service d’une vision humaniste, dénonçant les fanatismes et aspirant à la liberté. En témoignent les visages anonymes, douloureusement habités, des beaux portraits exposés sur le rideau de scène pendant les longs précipités, les scènes de foules au cours desquelles s’exacerbent la lutte contre les rapports de force et de domination entre les hommes – représentant l’ordre dogmatique en habits traditionnels ou en uniformes – et les femmes – odalisques en nuisettes prenant le frais –, ou encore les autres projections évoquant l’errance et l’impossible deuil d’un chœur funèbre, qui arpente le désert en portant des brancards ou creuse une fosse dans le sol aride pour enterrer les cadavres. À la fin, une minuscule barque sur laquelle quelques migrantes cahotent au milieu de la mer, se présente comme une possible échappée et un véritable contrepoint au destin des héros verdiens tragiquement emmurés.
Un plateau vocal de belle envergure a magnifié la première de cette production entrée au répertoire de l’Opéra de Paris. Piotr Beczała se montre toujours plus glorieux dans Radames. Une projection éclatante et des moyens vocaux superlatifs donnent à entendre aussi bien l’héroïsme que le lyrisme qu’il convient d’apporter au rôle. Les conflits politiques entre Égyptiens et Éthiopiens se doublant de rivalité amoureuse, la princesse Amneris jalouse l’esclave Aida. Eve-Maud Hubeaux fait forte impression parée de costumes chatoyants, et impose avec une autorité altière toute sa fougue, son impétuosité vocale et sa riche palette expressive. Saioa Hernández campe le rôle-titre avec plus de simplicité et de déchirure au moyen d’un chant joliment modulé, sans une ampleur énorme mais aux accents lumineux et touchants. Krzysztof Bączyk (le Roi), Alexander Köpeczi (Ramfis) et Roman Burdenko (en Amonastro très incarné) sont également excellents. En très grande forme ce début de saison, l’Orchestre et les Chœurs de l’Opéra ont forcé l’admiration, trouvant un juste équilibre entre le faste pompeux et l’intimisme feutré inhérents à la partition, tantôt presque martial, tantôt proche du murmure (dans l’invocation de Phtà) sous la baguette dynamique, même un peu survoltée, mais bien attentive, du chef Michele Mariotti.
Christophe Candoni – www.sceneweb.fr
Aida
Musique Giuseppe Verdi
Livret Antonio Ghislanzoni, d’après Auguste Mariette
Direction musicale Michele Mariotti, en alternance avec Dmitry Matvienko
Mise en scène et vidéo Shirin Neshat
Avec Saioa Hernández en alternance avec Ewa Płonka, Piotr Beczała en alternance avec Gregory Kunde, Eve-Maud Hubeaux en alternance avec Judit Kutasi, Roman Burdenko en alternance avec Enkhbat Amartüvshin, Alexander Köpeczi, Krzysztof Bączyk, Manase Latu, Margarita Polonskaya
Orchestre et Chœurs de l’Opéra national de Paris
Décors Christian Schmidt
Costumes Tatyana van Walsum
Lumières Felice Ross
Chorégraphie Dustin Klein
Dramaturgie Yvonne Gebauer
Chef des Chœurs Ching-Lien WuDurée : 3h25 (entracte compris)
Production créée au Festival de Salzbourg
Reprise en coproduction avec le Teatre del Liceu, BarceloneOpéra Bastille, Paris
du 24 septembre au 4 novembre 2025





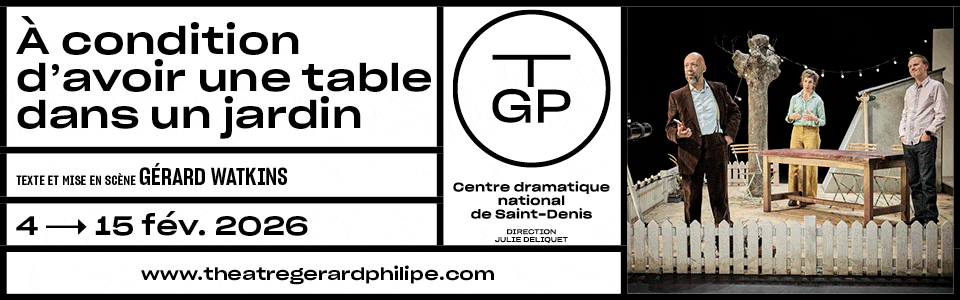








Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !