La metteuse en scène revient à Thomas Bernhard et transforme sa Plâtrière en cloaque suffocant, où, au milieu d’une scénographie immersive remarquable d’organicité, l’isolement et la folie s’entremêlent et se nourrissent de façon magistrale.
Il faut se la représenter cette Plâtrière pour tenter d’en comprendre la puissance ténébreuse, pour essayer de saisir le pouvoir maléfique de cette bicoque délabrée. Isolée au milieu d’un paysage enneigé, parsemé de sapins décharnés, cette ancienne usine à chaux est devenue un cloaque, une sorte de squat où, au son des chiens hurlants, cohabitent, dans une saleté remarquable, pigeons, corneilles, cafards et cadavre, dont l’odeur pestilentielle incommode des vagabonds de passage qui s’amusent, façon clowns tristes, avec des restes de déco de Noël. Visages neutralisés par un masque – style Fantômas –, ces badauds grouillants sont bien décidés à se débarrasser de cet amas de chair criblé de balles et choisissent, sans barguigner, d’appeler les autorités, avant de déguerpir telle une bande d’insectes effrayés par la lumière des gyrophares. « Ils m’ont dit qu’ils envoyaient une ambulance, mais, à ce niveau-là, elle aurait plutôt besoin d’un corbillard », s’amuse l’un d’eux, sans autre forme de compassion. Elle, c’est la femme de Konrad, « le fou » qui habitait là, mais qui a visiblement, lui aussi, pris la poudre d’escampette.
A la manière de Thomas Bernhard, à qui l’on doit cet invraisemblable roman, Séverine Chavrier opère, une fois le décor planté, un retour en arrière pour mettre la main sur l’auteur du crime et plonger dans le quotidien de ce couple hors du commun. Reclus volontaire, abandonné par tous, cet effrayant tandem a élu domicile dans cet endroit sordide voilà plusieurs années. Infirme, dépendante, elle semble plus préoccupée par la maigre pitance qu’elle avalera au dîner que par les cachets qu’elle refuse de prendre. Entre deux cigarettes, elle ne cesse d’humilier son mari, à qui elle fait payer cet isolement forcé, et n’a d’yeux que pour son enfance, où tout semblait encore possible alors que plus rien ne l’est aujourd’hui. Face à elle, Konrad est pris entre deux feux, entre les désidératas de cette épouse tyrannique et la nécessité maniaque – style Jack Torrance dans Shining – d’achever sa « grande oeuvre », ce « traité médico-mathématico-métaphysique » sur l’ouïe sur lequel il planche depuis vingt ans, mais dont il n’a pas écrit une traître ligne.
Pour l’heure, ses recherches se bornent à une série de feuillets qu’il a entassés au fond de la cave et aux résultats de curieux exercices de phonétique et de linguistique auxquels il soumet sa femme à grand renfort d’intimidations en tout genre. Chez lui, le bruit est devenu une obsession telle qu’il cherche, à tout prix, à s’en prémunir, en déménageant à la Plâtrière, bien sûr, mais aussi en transformant cette masure inhospitalière en forteresse apparemment imprenable. Mirador dans le jardin, caméras de vidéosurveillance dans chaque recoin, collection de fusils de chasse accrochés au mur, Konrad vit comme un forcené assiégé, sous la menace – réelle ou fantasmée – de l’extérieur, de ces improbables intrus masqués qui s’invitent pour faire des travaux, chasser sur ses terres, lui servir de confidents ou se payer sa tête. Sa solitude, brisée par les livraisons Deliveroo et les visites d’une aide-soignante dilettante, il la chérie, la cultive et la désire, jusqu’à la folie, alors qu’elle paraît, irrémédiablement, et pour son plus grand malheur, lui échapper.
Plutôt que de reprendre in extenso l’oeuvre de Thomas Bernhard – une gageure tant elle apparaît comme une litanie ininterrompue de flux et de reflux de pensée, dopée aux circonvolutions –, Séverine Chavrier a décidé d’en conserver seulement le canevas – comme elle avait déjà pu le faire dans Nous sommes repus mais pas repentis et Les Palmiers sauvages. Aux personnages de l’auteur autrichien, elle administre un traitement de choc, une mise sous cloche scénique : elle les propulse dans la Plâtrière et les observe se débattre, comme on regarderait les flocons retombés dans une boule à neige fortement secouée. Grâce au travail scénographique de Louise Sari, à la création vidéo de Quentin Vigier, à la partition musicale de Simon d’Anselme de Puisaye, intensément interprétée par Florian Satche, et aux lumières de Germain Fourvel, comme autant d’éléments époustouflants, l’environnement devient un cocon organique capable d’influer sur le devenir des individus qu’il enserre et sur la perception des spectateurs, pleinement immergés dans ces bas-fonds suffocants. D’autant que l’impression d’enfermement est minutieusement, et de façon subjuguante, entretenue par la metteuse en scène, à travers la superposition de trois écrans, mais aussi grâce à cette maison dont l’étroitesse du sous-sol, du couloir et même de la pièce principale – en regard de l’immensité du plateau – met sous tension la moindre action.
Aux confins du thriller et de l’horreur, Konrad et sa femme apparaissent alors dans toute leur monstruosité, et dans toute leur misère affective. Entre eux, ne subsiste rien de plus qu’un rapport de force quotidien, un lien dominant-dominé qui s’inverse au gré des humeurs et des événements de la journée. En commun, ils n’ont plus que la folie dans laquelle, à des degrés différents, ils plongent irréversiblement. Une descente aux enfers que Séverine Chavrier imbrique magistralement avec l’isolement, transformé en vecteur de ravages mentaux dévastateurs pour la santé psychique des êtres, comme pour leur humanité. Surtout, elle dirige d’une main de maître Laurent Papot, Marijke Pinoy et Camille Voglaire qui donnent respectivement à Konrad, sa femme et leur aide-soignante une intensité et une profondeur envoûtantes. Chacun à leur endroit, ils font montre d’une aisance fabuleuse qui concourt à faire de la Plâtrière une maison des horreurs où tout, y compris le pire, semble possible, voire probable. De cette expérience menée dans un laboratoire grandeur nature, aucun ne réchappera indemne, pas même le public qui, au sortir, mettra plusieurs minutes pour reprendre pleinement ses esprits, habilement chamboulés.
Vincent Bouquet – www.sceneweb.fr
Ils nous ont oubliés
d’après La Plâtrière de Thomas Bernhard
Mise en scène Séverine Chavrier
Avec Laurent Papot, Marijke Pinoy, Camille Voglaire
Musicien Florian Satche
Education des oiseaux Tristan Plot
Scénographie Louise Sari
Création vidéo Quentin Vigier
Création son Simon d’Anselme de Puisaye, Séverine Chavrier
Création lumières Germain Fourvel
Création costumes Andrea Matweber
Assistante scénographie Amandine Riffaud
Construction du décor Julien Fleureau, Olivier Berthel
Conception de la forêt Hervé Mayon – La Licorne Verte
Accessoires Rodolphe NoretProduction CDN Orléans/Centre-Val de Loire
Coproduction Théâtre de Liège – Tax Shelter (Belgique), Théâtre National de Strasbourg, ThéâtredelaCité – CDN Toulouse Occitanie, Tandem Scène Nationale, Teatre Nacional de Catalunya – Barcelone (Espagne)
Avec l’aide exceptionnelle de la région Centre-Val de Loire
Partenaires Odéon-Théâtre de l’Europe, JTN – Jeune Théâtre National – Paris, ENSATT – École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre – Lyon, Ircam – Institut de recherche et coordination acoustique/musique
Avec la participation du DICREéAMDurée : 3h45 (entractes compris)
La Colline Théâtre national
du 16 janvier au 10 février 2024 au Grand théâtre
du mardi au samedi à 19h30 et le dimanche à 15h30
relâche dimanche 21 janvier










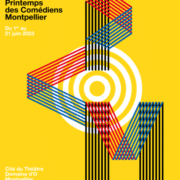



Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !