Dans Ruination : The True Story of Medea, l’iconoclaste chorégraphe britannique Ben Duke revisite le mythe de Médée avec beaucoup d’humour et de dérision, mais non sans gravité.
La relecture des mythes est chose toujours courante et peut prendre bien des aspects, du plus convaincant au plus controversé. Parvenir à raconter différemment, renouveler la perception d’une histoire déjà bien connue, adopter un point de vue qui enrichit au lieu de réduire le sens, qui rend intelligible sa contemporanéité, c’est ce que réussit parfaitement l’adaptation de Médée proposée par Ben Duke. Sa version paraît bien insolite tant elle ne s’encombre pas d’un pompeux respect pour le caractère noble et élevé de la tragédie antique ici franchement démythifiée. Proche de la comédie, elle aime distiller une cocasse et grinçante légèreté, comme en témoigne l’amusant prologue où le public est accueilli et apostrophé par un Hadès très queer. Le dieu du royaume des morts se retrouve les fesses nues sous son tablier de thanatopracteur, et devise sur son amour immodéré pour le ballet. Tout au long de la pièce, on relève un maniement très efficace du second degré. S’impose un humour constant, parfois scabreux, plus noir aussi, teinté d’ironie, notamment dans la manière dont est montré Jason, tant est pris le parti de mettre à distance l’héroïsme du personnage masculin. Orgueilleusement égocentrique, et opportuniste, celui-ci se présente plus prompt aux conquêtes du cœur qu’aux exploits guerriers. Son interprète, Liam Francis, hyper séduisant, ne se lasse pas de le tourner en ridicule en arborant des poses statuaires et vaillantes, ou en apparaissant nu comme un ver pendant que Médée enduit son corps de son onguent magique avec lequel il sera invincible pour conquérir la toison d’or.
Badine, la pièce bascule aussi dans l’inconfort, la noirceur et la cruauté. Quelque chose d’imparable est d’emblée acté, puisque les personnages sont déjà morts et bien défaits au début du spectacle. Ils séjournent aux Enfers représentés comme un lieu sombre et souterrain où l’on pénètre grâce à une longiligne échelle descendue des cintres. Jason et Médée, déjà arrivés, sont transportés sur des brancards métalliques réfrigérants comme dans les morgues. Leurs corps sont froidement enveloppés dans des bâches en plastique. Polysémique, ce même espace évoquera une prison, puis la salle d’audience d’une cour de justice, où se déroulera le procès de l’héroïne présumée coupable qui prend alors la parole et fait son convaincant plaidoyer. Hadès en procureur et Perséphone en avocate, l’un et l’autre en costard rose ostentatoire, assurent le spectacle avec une répartie piquante. À la barre, convoqués en qualité de témoins, le père de Médée, coiffé d’une couronne bachique et traité comme un satyre héroï-comique, et Jason, son ex-mari. Dans la salle, le public assure le rôle des jurés.
Ce projet singulier repose sur une écriture précise et mélangée, car se situant au carrefour de la danse, du théâtre et de la musique. Il est solidement défendu par six danseurs, qui sont aussi clairement acteurs, accompagnés par trois musiciens, dont une chanteuse de jazz, une pianiste classique et un contre-ténor. Tous forment une troupe aux multiples talents, et apparaissent comme les fiers représentants de toutes les diversités humaines et artistiques. Ces impeccables interprètes sont viscéralement investis à la fois physiquement et émotionnellement dans une danse qui met en relief l’attraction et la répulsion des corps. Des références aux cultures savante et populaire abondent, comme se télescopent des pratiques artistiques allant du ballet classique au divertissement moins élitiste – avec d’évidents emprunts au music-hall et au concert pop –, et ce, sans aucune hiérarchie ou différenciation des genres et des tons. La liberté et l’habileté avec lesquelles l’histoire de Médée se raconte au présent sont tout à fait réjouissantes. La pièce, qui fait sa première française au Théâtre de la Ville, à Paris, a été jouée de nombreuses dates dans une salle secondaire du Royal Opera House, à Londres. À la tête de la compagnie Lost Dog depuis 2004, le chorégraphe et metteur en scène Ben Duke fait découvrir l’originalité d’une forme et d’un ton, jamais univoques, mais bien détonants, séduisants, qui font rire autant qu’ils émeuvent.
Christophe Candoni – www.sceneweb.fr
Ruination : The True Story of Medea
Mise en scène et chorégraphie Ben Duke
Avec Miguel Altunaga, Jean Daniel Broussé, Maya Carroll, Liam Francis, Anna-Kay Gayle, Hannah Shepherd et les musiciens Sheree DuBois, Yshani Perinpanayagam, Keith Pun
Décor Soutra Gilmour
Direction musicale Yshani Perinpanayagam
Lumières Jackie Shemesh, assisté de Joe Hornsby
Son Jethro Cooke
Vidéo Hayley Egan
Assistante à la direction Andreea Paduraru
Assistante à la chorégraphie Winifred Burnett-Smith
Dramaturgie Raquel Meseguer Zafe
Surtitrage Dominique Hollier
Régie des surtitrages Katharina Bader
Direction plateau Amy Steadman
Régie son Chris Campbell
Régie lumières Hector Murray, Conor Westley
Adjointe à la direction plateau Hannah GillettCoproduction Royal Ballet, Londres ; Lost Dog
Durée : 1h40
Théâtre de la Ville, Les Abbesses, Paris
du 21 au 26 janvier 2025





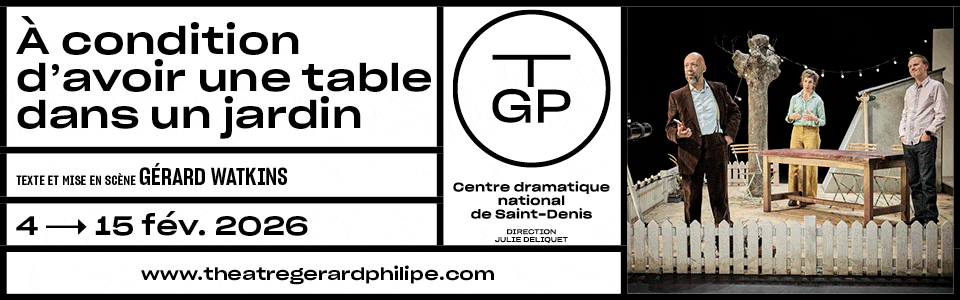





Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !