Que font le théâtre, le cinéma et la télévision de l’origine perçue des interprètes ? En d’autres mots, quels rôles leur sont « prescrits et proscrits » quand ils sont perçus comme non-Blancs ? « Quelles assignations ethnoraciales », de la formation au recrutement, configurent leurs trajectoires ? Et comment se débrouillent-ils avec ça ? Une passionnante étude menée par deux universitaires dessine une problématique aigüe dans laquelle le théâtre s’en tire (à peine) mieux que l’audiovisuel.
L’histoire court pas mal parmi les comédiens, celle d’une loi d’airain des responsables de casting : « Ne mets pas deux Noirs dans tes rôles, sinon les spectateurs risquent de les confondre ». Réalité ou légende urbaine ? Peu importe. C’est de notoriété publique ; dans les auditions pour l’audiovisuel, les fiches précisent les phénotypes des rôles : « black, maghrébin » ou « caucasien », comme on dit pour les Blancs. Les directeurs et directrices de casting peuvent même classer leurs fichiers selon ces catégories. La loi les y autorise. « Il existe une dérogation pour les arts du spectacle qui permet de le faire alors que les professionnels le cachent parce qu’ils pensent que c’est illégal », précise Maxime Cervulle, co-auteur avec Sarah Lécossais de l’étude « La couleur des rôles », qui sera publiée en septembre 2025 aux éditions Le Bord de l’eau.
Le ministère de la Culture a financé cette enquête, dont le Syndeac (Syndicat National des Entreprises Artistiques et Culturelles) a proposé, ce vendredi 21 mars, une présentation axée sur le théâtre, cœur de métier du syndicat. Les résultats en sont assez déprimants. On pressentait l’audiovisuel français coincé dans son supposé réalisme, sa vraisemblance souvent fantasmatique. « Alexandre Dumas, afro-descendant aux chevaux crépus, interprété par Gérard Depardieu, où est le réalisme ? », rigole un participant. Certes, mais le cercle vicieux fonctionne à plein. Les juges restent souvent blancs et les délinquants maghrébins. Ainsi imprime-t-on dans l’imaginaire des représentations prégnantes. L’étude, toutefois, dépasse largement la question des clichés pour interroger le vécu des artistes perçus comme non-Blancs. Menée auprès de 100 professionnels – une moitié d’interprètes, un quart de metteuses et metteurs en scène, un quart de responsables de casting –, elle a permis de creuser diverses problématiques, mais aussi le sentiment que rien ne change. Ou très peu.
Le théâtre semblait pourtant, en théorie, plus ouvert. Mais, ce milieu qui fonctionne beaucoup par réseaux fermés s’avère, en réalité, presque aussi difficile pour les interprètes perçus comme non-Blancs. Ainsi, le théâtre de répertoire leur est souvent interdit, pour des questions de supposée vraisemblance, à l’instar de l’audiovisuel. Dès la formation, la distribution des rôles semble toujours les empêcher d’endosser ceux de Bérénice ou d’Harpagon. Le théâtre contemporain leur serait, lui, plus ouvert, mais on leur demande souvent d’y porter le témoignage de leur parcours de personne racisée. Côté audiovisuel, c’est donc pire encore. Le doublage permet, certes, à ces interprètes de pas mal travailler, mais c’est un autre piège qui s’ouvre alors : les plateformes, type Netflix ou Disney +, demandent des Noirs pour doubler des Noirs, des Blancs pour des Blancs, etc. Avec les séries américaines, le travail abonde donc, mais l’enfermement dans des stéréotypes guette encore.
Une absence de prise de conscience
Le théâtre clame pourtant avoir la liberté de s’affranchir des codes de représentation. En théorie, tout y serait possible, mais, en réalité, la place accordée aux non-Blancs y reste incertaine, indique l’étude. Menée avec des artistes de tous âges, cette dernière porte évidemment les traces d’un long héritage, d’une histoire des représentations « où le blanc, c’est le neutre ». Mais l’on peut quand même, semble-t-il, se permettre d’espérer un avenir meilleur, à l’aune de cette diversité qui s’accroît dans les promotions des écoles nationales de théâtre. Sept interprètes entrant dans la carrière disaient ainsi, à la différence de leurs aînés, n’avoir été confrontés à aucune situation de discrimination. Ils et elles étaient passés par les écoles publiques, un autre son de cloche venant toutefois des cours privés.
Comment, alors, davantage changer l’ordre des choses ? Colour blind contre colour conscious : faire jouer indépendamment de l’origine ou promouvoir des quotas. Depuis les années 1980, la Grande-Bretagne a choisi la première option, rappellent les auteurs de l’étude, et l’on pourrait suivre leur exemple, mais ils en appellent surtout à une action publique significative. Il y a pour eux une absence de prise de conscience du problème. « On est au niveau des VSS il y a 15 ans », avancent-ils. Des pistes : un dispositif pour recevoir les signalements de discrimination – il existerait déjà, mais personne ne le connaît ; des études pour quantifier le phénomène, ce que la dérogation de la loi sur les arts du spectacle permettrait. Mais c’est peut-être celle-ci, finalement, qu’il faudrait remettre en cause, affirment Maxime Cervulle et Sarah Lécossais, pointant particulièrement du doigt les pratiques discriminatoires de l’audiovisuel qui ont cours en toute impunité. Il y a même pour cela une forme d’urgence, dorénavant « La puissance publique a du pouvoir dans l’audiovisuel et le spectacle vivant. On ne sait pas ce qu’il peut se passer demain. Alors, si d’ici là, rien n’a été mis en place contre les discriminations… ». Le rapport a été remis au ministère de la Culture en avril 2024.
Eric Demey – www.sceneweb.fr
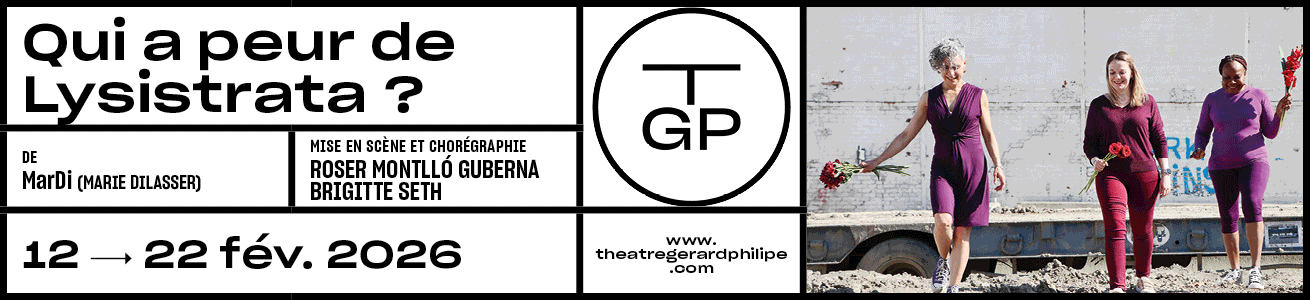




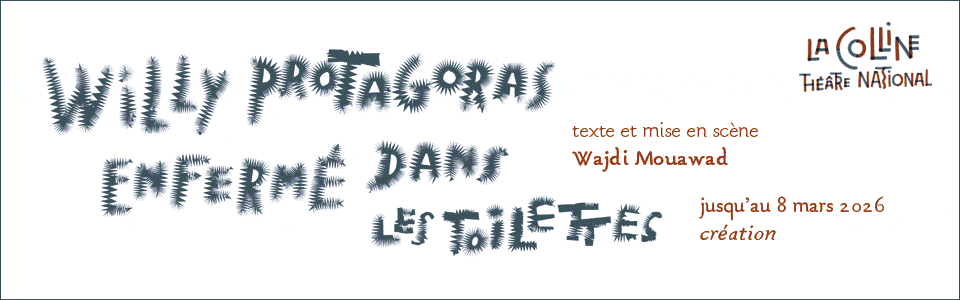
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !