Le metteur en scène s’empare de Ce que j’appelle oubli de Laurent Mauvignier et transforme le plateau de théâtre en chambre d’écho du flux de conscience du romancier.
Combien sont-elles ces cannettes de bière, vides, froissées, qui jonchent le sol ? Des dizaines ? Une centaine ? Peut-être plus. Loin de constituer un simple tapis de détritus vulgaires, leur amoncellement, dans sa façon de baliser, voire d’enserrer, le plateau, a ici la force du symbole. Car un homme est bel et bien mort « pour ça », « comme ça », seulement pour avoir bu, un jour de décembre 2009, l’une de ces cannettes dans les allées d’un supermarché lyonnais. Son forfait à peine accompli, ce jeune sans domicile fixe s’est vu emporter, manu militari, par quatre vigiles, un quatuor de molosses de tous âges, au fond de l’arrière-boutique. L’homme ne rechigne pas, se débat à peine, se demandant simplement – et ce seront ses seuls mots – « pourquoi on est ici, pourquoi si loin », avant que son passage à tabac ne commence. Ses quatre agresseurs – car il faut appeler un chat un chat – auront beau nier, peu après, devant les magistrats, leur intention d’en arriver là, la réalité est brutale, cruelle : ils ont, tant collectivement qu’individuellement, grisés par l’effet de meute, ôté la vie d’un homme. Pour une malheureuse cannette de bière.
Ce fait divers, Laurent Mauvignier s’en est, comme il a coutume de le faire (Dans la foule, Continuer), emparé pour tisser Ce que j’appelle oubli. Court, intense, cet ouvrage d’une soixantaine de pages tient en une seule et unique phrase, avec un tiret en guise de point final. Le narrateur y interpelle directement le frère de la victime, lui donne des explications, lui fournit des armes – les mots – pour l’aider à concevoir l’impensable, à surmonter cette perte, terrifiante d’ordinaire, qui jamais, en tout cas « pas pour ça », « pas comme ça », « pas maintenant », n’aurait dû advenir. Arpenteuse précise du drame, de ses contours et multiples dommages collatéraux, cette adresse n’a, contre bien des attentes, rien d’un lamento, mais est traversée par une double pulsion a priori paradoxale : une pulsion de mort et une pulsion de vie qui, enchevêtrées, comme nourries l’une l’autre, lui offrent toute sa puissance et toute sa justesse.
Contrairement à Denis Podalydès qui, il y a quelques années, au Studio-Théâtre de la Comédie-Française l’avait endossé en solitaire, Michel Raskine confie ce texte à un tandem quasi-gémellaire, composé de Thomas Rortrais et Louis Domallain. Au premier, fidèle du metteur en scène, reviennent les mots ; au second, l’art des percussions qui, composées sur le sol, un tube en métal ou un corps, viennent accompagner le flot mauvignierien et lui offrir une chambre d’écho pointilliste. A cette oeuvre non directement dramatique, Michel Raskine confère une théâtralité immédiate. Dans un écrin scénographique radical de simplicité, aux commandes de lumières à cru, il la traite à la manière d’une partition dont seraient dévoilés les tempi cachés et les nécessaires silences, lourds de sens. Le metteur en scène s’inscrit alors dans les pas de Laurent Mauvignier, dans sa volonté de n’ajouter aucun pathos, de raconter cette histoire au scalpel, à travers le regard d’un observateur compatissant, mais pas toujours amène.
Cette tendance, qui se devine à la lecture, Michel Raskine la transforme en cap qui structure la direction d’acteurs qu’il impose à Thomas Rortrais. Son ton ne sera pas lourd, grave, mais distancé et, parfois, à la limite du narquois, voire du sarcastique. L’orientation est étonnante, détonante même, et ôte une partie de la dureté du texte originel. A force de suffisance et de détachement, elle provoque une certaine mise à distance du récit qui redouble, alors qu’elle n’en avait nul besoin, l’intention première de son auteur. Pour autant, le jeune comédien fait montre d’une magnifique aisance, d’une belle présence et restitue les flux et les reflux imaginés par Laurent Mauvignier avec une remarquable fluidité. En compagnie de Louis Domallain, dont la seule présence vaut davantage que la composition musicale, aux manifestations trop rares pour être essentielles, il offre un corps à l’âme façonnée par le romancier, et restitue sa pleine et entière humanité à cet homme, qu’un jour de décembre 2009, on avait abattu tel un animal.
Vincent Bouquet – www.sceneweb.fr
Ce que j’appelle oubli
Texte Laurent Mauvignier
Mise en scène Michel Raskine
Avec Louis Domallain et Thomas Rortais
Décor Stéphanie Mathieu
Lumière et régie générale Julien LouisgrandProduction Rask!ne & Compagnie
Coproduction Célestins – Théâtre de Lyon, Le Bateau Feu – Scène nationale Dunkerque, Les Aires – Scène conventionnée de Die et du DioisCe que j’appelle oubli de Laurent Mauvignier est publié aux Éditions de Minuit.
Rask!ne & Compagnie est conventionnée par le ministère de la Culture – DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et reçoit le soutien de la Ville de Lyon.
Durée : 1h10
Théâtre des Célestins, Lyon
du 26 janvier au 6 février 2022MC2: Grenoble
du 12 au 19 marsLe Rive-Gauche, Saint-Étienne-du-Rouvray
le 1er avrilLe Bateau Feu, Scène nationale Dunkerque
du 5 au 7 avril





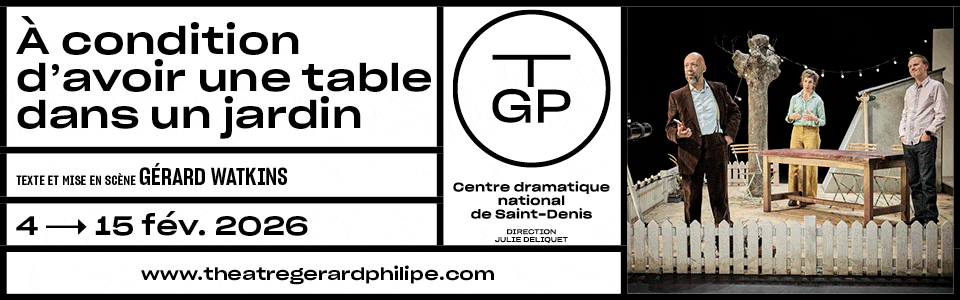







Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !