
Photo Carla Neff
Avec Les Garçons qui croient sont très seuls, les autres Garçons sont perdus, donné à Aubervilliers, le Groupe T transforme la scène de théâtre en hétérotopie où, malgré une dilatation dramaturgique excessive qui tend à diluer la substance du propos, une autre et belle façon de vivre ensemble se dessine.
Est-ce une utopie ou plutôt un retour aux origines, à la base d’un contrat social refondé, repensé, réagencé, où les rapports de pouvoir, de lutte et de domination seraient, si ce n’est vaincus, à tout le moins contrecarrés ? Au sortir des Garçons qui croient sont très seuls, les autres Garçons sont perdus, qui doit son titre à des vers de la poétesse Emily Dickinson, la question brûle les lèvres tant il nous aura été donné de voir, trois heures durant, une autre façon de concevoir le groupe et la communauté, une autre manière de nouer et d’entretenir les rapports humains et non-humains, une autre trajectoire sociétale qui, si elle peut s’avérer possible, nécessiterait un large et profond chamboulement des règles, des habitudes, des codes du vivre-ensemble, et se ferait, peut-être, au prix d’une certaine solitude, d’un isolement relatif de l’individu, devenu intimement seul malgré le monde qui l’entoure.
Au fondement de cet attelage, pétri par un curieux mélange de doute et d’assurance, ces Garçons-là ont, au-delà de leurs treillis militaires et de leurs chapeaux en forme d’auréole qui leur donnent l’allure d’icônes médiévales, quelque chose de peu commun. D’entrée de jeu, leur cheffe de file, seule jeune femme du groupe, pose les fondations de leur projet : la veillée-spectacle qui s’annonce, et interrompt provisoirement leur vagabondage, sera « un espace de réflexion et de rêverie », où toute joute avec le public sera proscrite – sous peine de voir la représentation s’arrêter net –, où les scènes qui seront interprétées apparaîtront comme autant de « reliefs », dont l’un des Garçons pourra donner le « la », avec le soutien et la complicité de ses camarades qui entreront, par la suite, dans son jeu et l’accompagneront dans sa démarche créatrice. Dans l’attente du retour de trois membres du groupe, l’un d’entre eux se lance et se confie sur sa noirceur intime qu’il associe à la présence d’un crapaud dans son ventre. Partie prenante de ce conte aux contours mélancoliques, un Garçon s’essaie alors à une solution : peut-être faudrait-il utiliser une petite fourche pour tuer l’animal et en évacuer naturellement la triste carcasse.
Devant le scepticisme affiché par le reste de la fratrie, un autre propose une solution alternative : donner un prénom au crapaud, l’accueillir, le faire sien, le nourrir aussi avec quelques limaces par jour – un régime auquel l’ensemble de ses camarades se soumettront de concert –, jusqu’à ce que, au bout de quatre ou cinq années, le batracien meurt de sa belle mort et se retrouve expulsé, puis enterré. En un tour de main, en un « relief », les bases de la croyance des Garçons commencent à se dessiner : chez eux, l’acte théâtral devient un levier de réparation, par le collectif, du réel, des rapports avec autrui, humain et non-humain, mais aussi, et peut-être surtout, de soi-même, de ses propres turpitudes, de sa propre solitude et, parfois, de son éreintante tristesse.
Transformée en hétérotopie, selon le concept développé par Michel Foucault, la scène dans la scène apparaît comme un lieu de conciliation et de réconciliation, capable, tout aussi bien, de panser des blessures intimes que de mettre fin à une querelle autour de l’attribution de matelas. À ceci près que, lorsque deux des trois membres du groupe jusqu’ici absents reparaissent, la petite communauté ne paraît plus isolée de son environnement, en discontinuité, mais bien en prise directe avec lui. Car, loin d’être simplement une troupe d’artistes vagabonds, les Garçons sont, avant tout, un groupe de résistants, en lutte contre le capitalisme et les ravages causés au vivant. Les deux membres sur le retour, sans le troisième que l’on devine rapidement tombé au front, reviennent d’ailleurs d’un ersatz de « zone à défendre », de la ville de Saint-Amand-les-Eaux, où un aéroport ne doit pas tarder à sortir de terre. Avant de se lancer prochainement à l’assaut d’un élevage de porcs bretons, les membres du collectif doivent d’abord s’employer à restaurer les liens qui les unissent, mis à rude épreuve par la perte de l’un des leurs : l’un des trois combattants accuse son compagnon d’avoir pêché par excès d’héroïsme et d’avoir mis leur existence en danger en tentant de porter secours au troisième. Pour solder ce différend, un tribunal de fortune, ou plutôt un « lit de justice », se met alors en branle. Contrairement à un procès classique, celui-ci n’a pas pour but de décider d’une quelconque sanction, mais de trouver une voie de réparation possible, grâce au récit gestuel des événements qui, dans son aridité et sa véracité, évite les écueils d’une parole intrinsèquement corrompue.
À chaque « relief », donc, qu’ils soient subis ou choisis, les Garçons, et le Groupe T derrière eux, restaurent, et amplifient, le pouvoir du théâtre, l’utilisent pour préserver, réparer, solidifier les existences et les rapports entre les êtres vivants, de toute espèce, et les éclairer, au passage, d’une lumière nouvelle, qu’ils espèrent, secrètement, évangélisatrice. Cette belle entreprise, le dramaturge Théo Cazau, le scénographe Antonin Fassio et la metteuse en scène Juliane Lachaut s’échinent à la nourrir de concert, sans aucune hiérarchie entre leurs différentes spécialités. Au coeur d’une ambiance aux atours médiévaux, dans les costumes comme dans la langue, tout concourt, à commencer par l’astucieuse scénographie digne d’un théâtre de tréteaux, à souligner la simplicité, voire la pureté du projet intellectuel de leurs Garçons. Loin d’être bâti au hasard, il a, malgré tout, besoin, pour advenir, de répondre à une série de règles garantes de la logique du « prendre soin », qui permet, par exemple, d’accueillir un nouvel élément et de l’aider, comme dans la scène finale, la plus réussie, drôle et émouvante de la collection de « reliefs », à dire adieu à ses proches, à ses parents morts lorsqu’il était enfant, à qui ses compagnons redonnent vie afin qu’il puisse leur adresser un double au revoir, et s’en émanciper définitivement.
Incarnés par des comédiens blancs, majoritairement d’âge mûr, qui, grâce à l’anonymat de leurs personnages, se confondent avec eux, les Garçons apparaissent aussi comme une troupe de repentis qui tenteraient de se débarrasser des oripeaux d’un système patriarcal qu’ils ont, on peut l’imaginer, longtemps contribué à parachever. Tous remarquables, notamment dans les dernières encablures de la pièce où ils font plus directement montre de leurs larges et belles capacités de jeu, les actrices et acteurs se retrouvent néanmoins légèrement entravés par le mouvement chaotique d’une dramaturgie qui, parfois, a les défauts d’un spectacle de jeunesse. À intervalles très réguliers, elle semble se faire prendre au piège de la douceur que les Garçons, qui ne veulent rien brusquer, mettent en place, et qui, au théâtre, donne une impression de longueur et de langueur. Victime d’une dilatation excessive qui tend à diluer la portée de son propos, la pièce gagnerait à être drastiquement resserrée pour gagner en force, en puissance et en impact direct, et éviter de perdre quelques spectateurs en chemin. Même si, on le comprend, la lenteur constitue, à n’en pas douter, l’une des clefs de cette hétérotopie car, dans les rapports avec autrui comme en soi, le temps long s’impose bien souvent comme le levier essentiel d’une réparation durable.
Vincent Bouquet – www.sceneweb.fr
Les Garçons qui croient sont très seuls, les autres Garçons sont perdus
Une création du Groupe T, conçue par Théo Cazau, Antonin Fassio et Juliane Lachaut
Texte Théo Cazau
Mise en scène Juliane Lachaut
Scénographie, costumes et régie générale Antonin Fassio
Avec Camille Blanc, Jean-Yves Duparc, Frédéric Fachena, Olivier Horeau, Yaëlle Lucas, Bertrand Schiro, Aurélien Vacher
Dramaturgie et collaboration artistique Camille Blanc
Assistanat à la mise en scène Marie Vandame
Collaboration scénographie Quentin Frichet
Création sonore, interprétation et régie son Solal Mazeran
Création et régie lumière Louise BrinonProduction Groupe T
Coproduction La Commune – CDN d’Aubervilliers, le Collectif 12 à Mantes-la-Jolie, Centre dramatique national Besançon Franche-Comté
Cette pièce a obtenu le soutien du dispositif destiné aux auteurs dramatiques et de l’Aide à la Création de la DRAC Île-de-France, ainsi que du T2G de Gennevilliers pour un accueil en résidence.
Le Groupe T sera artiste associé au Studio-Théâtre de Vitry-sur-Seine à partir de septembre 2024.Durée : 3h (entracte compris)
La Commune, CDN d’Aubervilliers
du 23 au 30 avril 2024




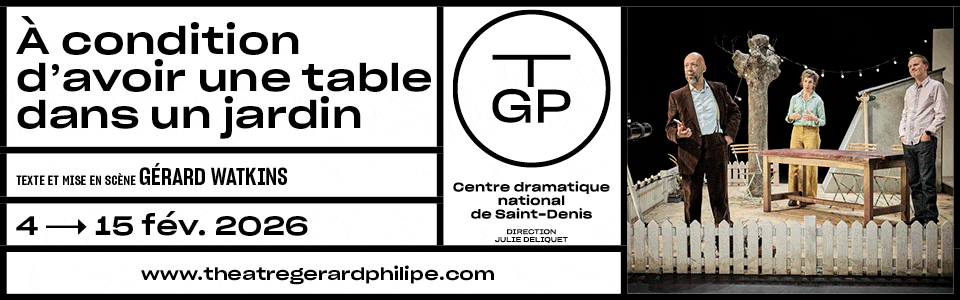








Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !