Créé au Théâtre national de la Colline, à Paris, L’Animal imaginaire de Valère Novarina prolonge le travail développé par l’artiste. Une œuvre dont la vitalité teintée de mélancolie est atténuée par des longueurs.
Dans un entretien entre Valère Novarina et le peintre Jean Dubuffet (publié dans Personne n’est à l’intérieur de rien, correspondance Jean Dubuffet, Valère Novarina aux éditions L’Atelier contemporain), ce dernier répondait ainsi à la question du premier : « Combien êtes-vous ? – Tout homme est un gâteau feuilleté. » De prime abord cocasse, la réponse pourrait, néanmoins, s’appliquer pour tenter de définir L’Animal imaginaire de Novarina, tant ce nouvel opus travaille par sédimentation, incorporant et agrégeant les références, citations, réminiscences des œuvres antérieures. Variation à partir d’un même langage scénique et textuel, L’Animal imaginaire produit une forme avec laquelle le dramaturge, metteur en scène, dessinateur et peintre franco-suisse prolonge et creuse ce qui fonde son travail d’écriture depuis son premier texte dramatique publié en 1971, L’Atelier volant. Soit l’élaboration d’une langue proliférante, débordante, qui ne cesse de s’inventer pour réfléchir le réel autrement. Assujettissant tout ce qui l’entoure, la langue novarinienne produit de la jubilation, du rire. Ses effets sont poétiques, voire, politiques, en ce qu’ils nous renvoient à la manière dont les mots nous font autant qu’ils contrefont ce qui nous entoure.
Mais reprenons. Lorsque L’Animal imaginaire débute, le plateau est à vue. Sur celui-ci, un vaste carré blanc au sol désaxé par rapport à la scène délimite l’espace de jeu, tandis que deux immenses tableaux – peints par Novarina – sont disposés l’un sur l’autre en fond de scène. Bientôt, une comédienne (Julie Kpéré) entre et s’assied à une petite table située à l’avant-scène côté jardin. Comme si elle allait écrire, elle s’adresse à nous, spectateurs, et détaille son rapport à l’écriture : « Avant que d’écrire je ne savais pas ce que j’allais écrire ; en écrivant, je voyais que j’écrivais des choses que je n’avais jamais sues. J’écris ce que je ne pense pas encore. Ne plus être le maître du livre, celui qui en détiendrait le sens, ne plus être le guide du lecteur mais celui qui fait le voyage avec lui. (…) » À ce prologue valant, qui sait, comme un précis de l’écriture de Novarina, succède une séquence où des voix s’interpellent. Sur un ton balançant entre légèreté et gravité, elles appellent qui l’espace, qui le temps, qui la chair humaine, avant de signaler : « Public, prends courage : la suite est nombreuse ! »
Et la suite va l’être, en effet, car durant un peu plus de deux heures trente, les neuf comédiens et deux musiciens, rejoints parfois par deux techniciens voire, un chœur d’amateurs, vont donner corps à la langue. L’Animal imaginaire ne déroule pas une narration selon une chronologie classique, linéaire. Comme toujours chez l’auteur, il n’y a ni repères temporels ou spatiaux, ni personnages avec une psychologie ou une histoire. Seuls existent des figures constituées et mues par le langage – un langage carnavalesque, où les néologismes vont bon train, produisant à la fois familiarité par la proximité avec le réel et distance par leur caractère parfois grotesque.
Dans cette succession de séquences des situations se dessinent : pastiche de journal télévisé ou de prêche catholique, harangue politique, cène réinventée, présentation scrupuleuse d’un territoire par les peuplades qui l’occupent, démonstration scientifique, etc. Au gré de celles-ci, les comédiens auront recours à quelques tables, tréteaux, tabourets, ou introduiront d’autres peintures, plus petites, reconfigurant la circulation dans l’espace. Le tout est parfois ponctué de chansons, accompagnées à l’accordéon par Christian Paccoud, ces dernières valant comme un prolongement aux accents de théâtre forain de cette parole organique.
Ces petits mondes qui se déploient ne sont pas inconnus les uns aux autres, et des figures comme des thèmes reviennent, lancinants. Il se dit, ainsi, la solitude, le néant, l’angoisse du temps qui passe, la peur de la disparition. Face à cette forme dense, qui croît à l’infini, les spectateurs aguerris pourront retrouver des personnages, des figures, des sujets présents dans de précédentes œuvres de l’auteur (Le Babil des classes dangereuses, L’Acte inconnu, Le Vivier des noms, etc.). Pour ceux découvrant son travail, il importera de lâcher prise, de ne pas chercher une structure traditionnelle. Pour tous, il faudra en accepter les longueurs.
Car c’est là le paradoxe de cet Animal imaginaire : maîtrisé dans son interprétation par une équipe rompue à cet univers – des neufs acteurs, huit ont déjà travaillé avec Novarina –, puissant par son organicité et par l’efficacité concrète de certaines séquences, pertinent par sa scénographie – les deux grands tableaux agrègent dans leur abstraction tous les motifs du spectacle (visages, profusion d’images, figures géométriques, jaillissement de la parole, etc.) – L’Animal imaginaire souffre de sa longueur. Certaines scènes se révèlent moins fortes, d’autres s’enferrent, tels les pastiches de prêches, trop appuyés. Le spectacle perd alors de sa vitalité et court le risque de ne plus produire, en lieu et place d’une œuvre tantôt mélancolique, tantôt cocasse, renvoyant au passage avec une poésie bouleversante à la nécessité d’user de la langue en conscience, qu’une répétition stérile et vaine. Celle d’un artiste se complaisant un brin trop dans le ressassement de ses obsessions.
Caroline Châtelet – www.sceneweb.fr
L’animal imaginaire
texte, mise en scène et peintures Valère Novarinaavec Edouard Baptiste, Julie Kpéré, Manuel Le Lièvre, Dominique Parent, Agnès Sourdillon, Nicolas Struve, René Turquois, Bedfod Valès, Valérie Vinci et Christian Paccoud – accordéon – Mathias Lévy – violon
collaboration artistique Céline Schaeffer
musique Christian Paccoud
scénographie Jean-Baptiste Née
lumières Joël Hourbeigt
costumes Charlotte Villermet
dramaturgie Roséliane Goldstein et Adélaïde Pralon
collaboration musicale Armelle Dumoulin
assistante de l’auteur Sidonie Han
régie générale Richard Pierre
régie lumière Paul Beaureillesrégie plateau Elie Hourbeigt
production/diffusion Séverine Péan et Emilia Petrakis / PLATÔ
administration Carine Hily/ PLATÔ
production déléguée L’Union des contraires
coproduction La Colline – théâtre national, Scène nationale du Sud-Aquitain
Avec le soutien de L’Organisation Internationale de la Francophonie et de la Fondation Connaissance et Liberté (FOKAL) et en collaboration avec la compagnie Nous ThéâtreLe texte sera édité chez P.O.L. en septembre 2019
La compagnie L’Union des contraires est conventionnée par la ministère de la Culture – DRAC Île-de-France.
Durée: 2h45
La Colline – théâtre national
du 20 septembre au 13 octobre 2019 au Grand Théâtre
du mercredi au samedi à 20h30, le mardi à 19h30 et le dimanche à 15h30
participation d’un chœur d’amateurs le vendredi 20 septembre puis chaque samedi et dimanche, excepté le dimanche 22 septembre.
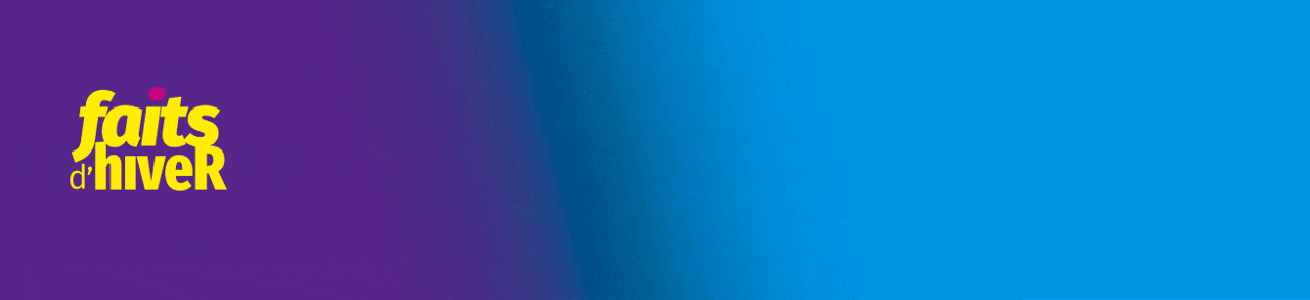




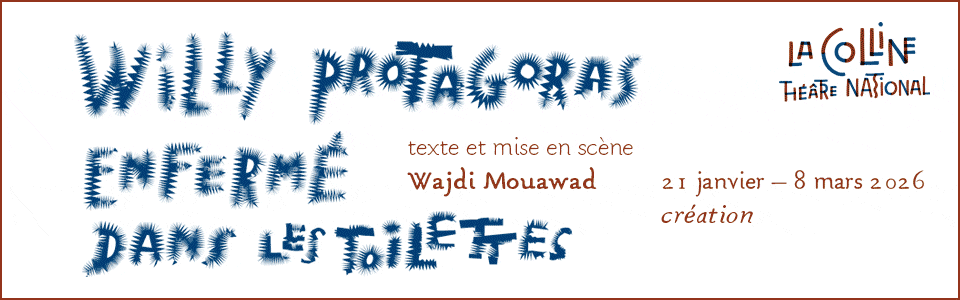








Oui il y a des longueurs mais c’est aussi un feu d’artifice de la langue et 6 des 9 acteurs sont fabuleux et nous conduisent au bout de la pièce.