Autrice, poétesse, slameuse, afroféministe, activiste LGBTQIA+, Joëlle Sambi est une artiste au travail puissamment politique.
Il y a des (beaux) spectacles pour lesquels, à la fin, l’on a envie de se lever et de ne cesser d’applaudir, tant ils saisissent, émeuvent. Et il y en a d’autres (beaux, toujours) pour lesquels on peine à se lever et où même applaudir semble impossible, tant le trouble et l’émotion travaillent en profondeur. Pour la journaliste-critique, Maison Chaos de Joëlle Sambi appartient à la seconde catégorie. Dans cette nouvelle création, l’artiste qui est tout à la fois poétesse et slameuse – signant des textes en prose aussi incisifs que poétiques –, afroféministe, activiste LGBTQIA+ et exilée permanente – dixit sa bio – se saisit de la question du viol, de l’inceste et des agressions sexistes et sexuelles. En plusieurs séquences, qu’elle soit seule au plateau ou accompagnée par la chanteuse Raphaële Green et la musicienne et compositrice Sara Machine – avec laquelle elle travaille depuis plusieurs années, co-signant, entre autres, le récent morceau Not All Men –, Joëlle Sambi scrute de l’intérieur ces violences autant que les moyens d’y résister, d’en réchapper.
Ce récit fragmentaire se déploie dans une forme volontairement épurée – le plateau étant seulement occupé par des voiles blancs dessinant des espaces possibles de circulation –, où parole comme écriture sont ciselées. Traversant divers états et atmosphères, l’adresse est précise, directe, franche et ne glisse jamais vers l’incarnation d’un personnage. Quant à la langue, elle est aussi concrète que percussive. Les mots font immédiatement images – telle cette métaphore de la maison qui chemine dans tout le texte pour désigner le viol et ses lieux (le premier étant la société hétéropatriarcale dans laquelle nous vivons). Ou, encore, celle – férocement drôle – de la « véranda » – la « dernière extension de la maison » – qui tacle la « résilience », cette injonction adressée comme solution aux victimes de violences.
Trouver un équilibre adéquat
Lorsqu’on rencontre le lendemain de la première à Actoral Joëlle Sambi, c’est autour de ce spectacle que l’échange débute. Comme elle-même le raconte, « ça a été le texte le plus difficile pour moi à écrire, mais c’est aussi celui dont je suis le plus fière. Parce que c’est celui qui est le plus près de moi, où je suis allée creuser très loin… ». Si cette histoire est personnelle – « ce que je dis sur scène, c’est mon histoire » –, il était essentiel pour l’artiste de trouver un équilibre adéquat entre le sujet et son passage au plateau. « J’ai énormément lu, cherché, pour trouver comment les questions du viol, de l’inceste, des agressions sexistes et sexuelles pouvaient être abordées sans que ce soit voyeuriste. » Avec son équipe, et notamment Meryl Moens à la dramaturgie, l’artiste a cheminé vers une forme qui « travaille autour de la parole, mais sans la mettre en scène ». Cette « femme que rien ne vient interrompre, surtout pas les artifices du théâtre », ses mots ne permettent aucune « polysémie. Ce qui est dit est dit, il n’y a pas d’échappatoire et on comprend de manière claire de quoi on parle ».
L’un des enjeux majeurs pour l’équipe était également « d’éviter le male gaze. Nous avons notamment regardé des films pour voir comment on filme un viol, comment est-ce qu’on en parle. Pour nous, la question était de faire en sorte que personne ne puisse se branler en écoutant ça, que personne n’ait prise pour du voyeurisme malsain. Ce qui importe, c’est ce qui se passe pour elle et non pas pour l’agresseur, qui n’a pas de substance en tant que telle ».
Une colère irradiante
L’une des caractéristiques traversant toute l’écriture de Joëlle Sambi – que l’on retrouve également dans les poèmes d’Et vos corps seront caillasses, ouvrage publié aux éditions de L’Arche – est, à mille lieues du pathos, une vitalité. Chez la poétesse, la langue comme la syntaxe condensent une énergie, où sourd parfois une colère irradiante qui participe d’une mise en mouvement. Interrogée sur cette qualité, Joëlle Sambi commence par donner son signe astrologique « c’est parce que je suis Bélier ascendant Capricorne… », avant d’ajouter : « La colère, elle est là depuis très longtemps chez moi. Je sais que c’est une compagne, mais il ne faut pas qu’elle soit mortifère. Mes colères peuvent être pyromanes, et j’estime que parfois, ça vaut le coup de tout casser, tout détruire. C’est nécessaire parce que sinon, on n’est pas entendu ou les choses ne passent pas. Après, la question est toujours celle de ‘que faire de cette colère qui me traverse ?’ ».
À cette question, l’écriture est l’une des réponses possibles que l’artiste déploie depuis plus de vingt ans. Elle qui a passé sa jeunesse entre la République démocratique du Congo et la Belgique – née à Bruxelles, elle y passe ses premières années, puis grandit à Kinshasa, avant de revenir à Bruxelles lorsqu’elle a une petite vingtaine d’années – va, dans l’écriture, d’une forme à l’autre. Poésie, d’abord, avant de glisser vers la nouvelle et le roman – certains de ses écrits étant primés : prix du Jeune Écrivain 2005 pour Religion ya Kitendi, prix du jury Gros Sel en 2008 pour Le Monde est Gueule de Chèvre. Et si elle a, pendant plusieurs années, travaillé – en tant chargée de communication pour un mouvement féministe à Bruxelles – en parallèle de l’écriture et de la lecture de ses textes, elle se consacre depuis presque dix ans uniquement à la création. Après un burn-out, elle rencontre la metteuse en scène Rosa Gasquet, qui lui propose de porter à la scène son premier texte de slam : Congo Eza – qui signifie en lingala « le Congo est » ou « le Congo existe ». « Rosa Gasquet nous a mises en scène avec Lisette Lombé. Nous avons fait nos premiers pas sur scène pendant deux ans et depuis je n’ai pas arrêté. »
Chercher le juste mot
Aujourd’hui artiste associée au Théâtre National Wallonie-Bruxelles, l’artiste continue de lier dans ses projets ce qui la constitue comme ce qui la traverse : la question des violences, qu’elles soient sexistes, racistes, homophobes, policières. La question de la normativité comme de l’appartenance – et qui s’exprime pour cette dernière aussi par la circulation entre les langues, lingala ou français. Des enjeux qui passent par une écriture majoritairement destinée à être dite, portée. « J’écris pour que les mots soient projetés. Quand j’écris, je me relis tout de suite pour voir en matière de rythme si ça fonctionne ou pas. N’étant pas comédienne et ne venant pas du théâtre, c’est un vrai défi. Et à la fois, c’est jouissif. Mais c’est ça qui est génial… En slam, on dit que lorsqu’on écrit un texte et qu’on doit le porter, il faut toujours d’abord en faire des caisses, pour trouver la juste place. La mise en scène c’est un peu ça : on teste plein de choses et on essaye de trouver le bon endroit pour que ce qu’on propose ne vienne pas gommer, remplacer, ce qui est dit. »
Cette attention, cette vigilance à trouver la juste place, le juste mot, Joëlle Sambi la relie dans son travail à sa militance. « Je pense que le fait d’être engagée avec d’autres personnes qui rencontrent plein d’autres formes de discrimination amène une attention à qui parle, d’où, comment. Disons que pour moi il y a toujours un ‘nous’ dans le ‘je’. Même si ce que l’on dit est toujours très singulier parce qu’on est seul à le vivre, au final on n’est jamais seul dans ce qu’on dit. Et de manière sous-jacente dans mon écriture il y a un ‘nous’ – ce qui oblige à un peu d’humilité et à toujours s’interroger sur ‘comment est-ce qu’on fait avec ça ?’ ».
Outre ses projets en théâtre et en poésie, Joëlle Sambi planche également sur un film documentaire et un roman. Le premier, Pinkshasa Diaspora – qui est en cours de développement et devrait sortir en 2026-2027 –, dessine « un portrait des militants LGBT de la diaspora congolaise vivant en Belgique et en France ». Le second, encore en cours d’écriture, s’intitule La Boucherie contemporaine et se déroule dans une ville imaginaire. Nommée Mpota – qui « signifie ‘la blessure’ en lingala » –, cette ville construit, dans l’espoir d’accéder à des aides adressées aux pays émergents, des prisons Supermax – du type de celles existant aux États-Unis. « Sauf que plus le temps passe, plus les prisons se remplissent de poètes, militants, résistants au gouvernement. » Le roman dessine l’itinéraire d’un groupe de jeunes gens queer vivant dans des bidonvilles et décidant d’ouvrir ses prisons. Où l’on voit que quelles soient les formes – fictions ou documentaires –, comme les médiums – cinéma ou écriture –, il est bien toujours question pour Joëlle Sambi de se coltiner au monde et à ses dérives. Comme de le contrer en donnant à entendre d’autres voix, en proposant d’autres regards.
caroline châtelet – www.sceneweb.fr
Faites de feu
de et avec Joëlle SambiDurée : 40 minutes
MAIF Social Club, Paris
les 2 et 3 mai 2025


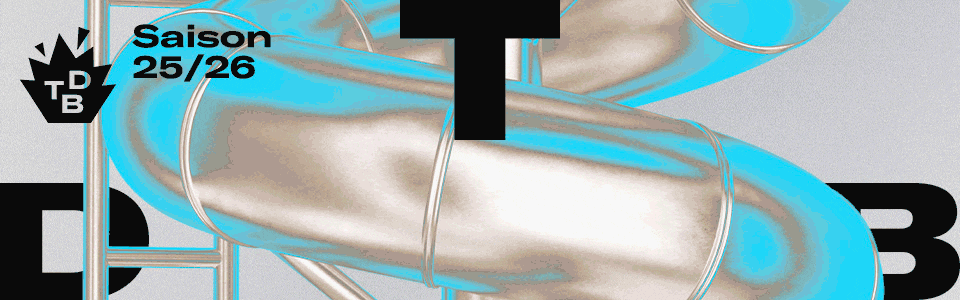


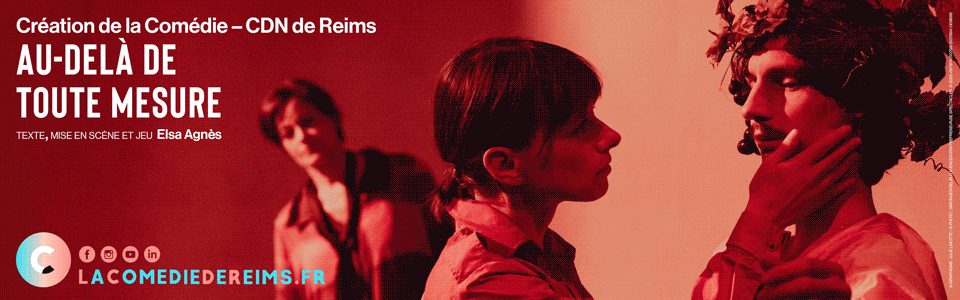


Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !