Dans le cadre de Faits d’hiver, festival de danse contemporaine (dirigé par Christophe Martin) qui peut se réjouir d’en être à sa 25ème édition cette année, Christine Armanger présente Je vois, venant de la mer, une bête monte. Un solo peuplé de créatures chimériques et d’échos au réel, qui s’empare de l’Apocalypse, sujet à la fois brûlant et ressurgi de la nuit des temps, pour nous en livrer une version toute personnelle, frictionnant le trivial et le sacré dans un geste artistique chargé de vitalité.
C’est par la musique que tout commence. Dans le noir du théâtre s’élèvent les notes d’une fanfare, des tambours d’abord puis des cuivres, une musique processionnelle andalouse qui prend aux tripes d’emblée tandis que dans un coin du plateau quelque chose bouge. L’œil ne distingue pas tout de suite l’informe au sol qui se meut comme un animal se contorsionne pour sortir de sa coquille. C’est un dinosaure de farces et attrapes qui se dresse alors devant nous et part illico explorer le monde, un terrain vierge ponctué de sacs Tati, comme autant de cachettes renfermant les accessoires qui viendront constituer au fur et à mesure la scénographie évolutive du spectacle. L’image est à la fois saisissante et hilarante. Il en sera ainsi de cette performance hybride, écartelée entre le trivial et le sacré, le rire et la gravité, entre une adresse public simple et franche et la composition complexe de tableaux étonnants.
Sous la peau de ce dinosaure 100 % Polyester, Christine Armanger, maîtresse de cérémonie ardente et généreuse, ne tarde pas à ôter son déguisement grotesque pour se dévoiler dans un legging à imprimé d’écorché vif et brassière couleur chair. Révélant sous l’artifice le corps à nu, corps dépecé de ses oripeaux, transpirant, transparent et offert. Ce corps traversé qui sera la matière première de ce geste performatif de haute tenue. Corps de chair évoluant dans un océan de plastique. Des brassées de sacs multicolores recyclés en costume de guerrière en guenille, en esquisses de chevaux annonciateurs du pire, des bouteilles en plastique ceinturées autour du ventre pour constituer une bouée de sauvetage du naufrage en cours, à moins que ce ne soit une rangée d’explosifs prêts à accélérer la fin. Chez Christine Armanger, les signes prolifèrent et le sens reste ouvert à toutes les interprétations. Les images parlent, c’est sûr, mais ce qu’elles disent s’imprime en chacun différemment. Le regard circule d’une scène à l’autre, échafaudant sa propre compréhension dans ce réseau de visions qui avance en s’épaississant.
De la naissance de l’humanité à son extinction, c’est une femme belle et bien vivante qui orchestre sous nos yeux son monde à elle, celui du plateau qui est son royaume, la projection concrète de son univers intérieur, le lieu où ce qui l’habite si intensément se réalise, prend forme et vie. Christine Armanger est une artiste obsédée par le corps, son expressivité, son symbolisme, nourrie d’iconographie religieuse et populaire et d’artistes de la scène qui hantent son imaginaire. Elle organise ici dans l’espace-temps de la représentation un ballet de rencontres entre elle-même et un florilège d’objets disséminés, cachés au départ pour mieux nous apparaître ensuite dans toute leur puissance évocatrice. Puisant son inspiration à la source de l’Apocalypse selon Saint Jean autant que dans le combat écologique de Greta Thunberg, jeune prophétesse des temps modernes, Je vois, venant de la mer, une bête monte déploie un éventail de références picturales pour livrer sa propre vision d’un monde agonisant tandis que musiques mariant opéra, folklore espagnol et électro mixée à une bande son de vagues et de vent (beau design sonore signé Cédric Michon), se mêlent au jeu pour mieux démultiplier les sources émotionnelles et ricochets polysémiques.
Entre Saint-Michel terrassant le démon de Raphaël, la gigantesque tenture de l’Apocalypse de Louis d’Anjou (la plus ancienne et la plus longue des tapisseries médiévales conservées, visible au Château d’Angers), la saturation figurative et la crudité des œuvres de Jérôme Bosch, la gestuelle déployée par Christine Armanger, toute en ruptures de rythmes et de ton, travaille postures bibliques et yogi, poses combattives et angéliques. Son visage est un paysage entre grimaces sataniques et sourires angéliques. De la même manière, syncopée, le texte avance par à coup, accumulant les digressions en apparence anecdotiques, les apartés et prises à parti du public, comme pour mieux nous perdre et nous guider à la fois dans cet environnement chaotique, cette cartographie mentale d’un cerveau en détresse face à l’inéluctable et pourtant riche de ressorts et soubresauts. C’est un melting-pot impressionnant qui nous fait passer par des grands écarts visuels et musicaux ahurissants. Dans nos oreilles, un extrait du clip de Thriller de Michael Jackson côtoie la BO d’Apocalypse Now tandis qu’un peu plus tard ressuscite la voix de Caruso interprétant Les Pêcheurs de perles de Bizet dans un enregistrement de 1904 resté dans son jus, moment de grâce où la danseuse tournoie dans un filet de pêche suspendu (recyclé par Click-Dive, entreprise ingénieuse et écoresponsable, spécialisée dans l’économie circulaire des déchets de la pêche).
Au milieu de cette extinction massive des espèces amorcée, du dérèglement accéléré du climat, de la pollution aux particules fines des villes et d’une nature en état de suffocation, nous tentons modestement, au bord de l’impuissance, de faire notre part, triant nos déchets, pratiquant le yoga, gorgés d’angoisses et de bonne volonté. Christine Armanger recycle nos peurs anticipatrices pour en faire la matière gonflée d’espoir d’une performance drôle et profonde qui ne se voile pas la face et joue du dévoilement justement pour mieux éclairer le trouble où nous nous situons. Sans donner de leçons, sans faire la morale, elle fait de cette création son acte de pénitence et nous embarque dans son rituel expiatoire, la tête haute ou tête en bas, fesses nues face à nous trouées par l’orifice d’un mégaphone vociférant dans le désert, seule et pleine car poreuse, en équilibre au bord du gouffre, en harmonie avec elle-même. Et lorsque, sortant d’un des sacs à carreaux une armée de capirotes (ces grands chapeaux coniques servant à enfiler les cagoules portées lors des processions de la Semaine Sainte en Espagne), vêtue d’un blouson à sequins aussi irisé qu’une boule à facette dans une discothèque, elle les dispose sur la scène en des allées et venues géométriques, c’est un champ de stalagmites qui se dessine devant nous jusqu’à ce qu’elle les cueille une à une comme on fait un bouquet de fleurs sauvages et nous bouleverse dans une chorégraphie finale, cône en guise de bec immaculé et effilé. Ce que l’on voit à ce moment-là, c’est la danse du dernier oiseau sur terre. Avant qu’il ne se transforme en une sorte de bactérie hérissée de pics, organisme vivant informe qui signe-là le renouveau de l’humanité. Ce spectacle nous rappelle à bon escient que le cycle est au cœur de la vie. Et que par son essence-même, elle est éternelle.
Marie Plantin – www.sceneweb.fr
Je vois, venant de la mer, une bête monte
Conception, scénographie, textes, montage son, interprétation : Christine Armanger
Co-conception et collaboration artistique : Laurent Bazin
Lumières : Philippe Gladieux
Design sonore : Cédric Michon
Chargée de production : Camille BoudiguesDurée : 1h
Les 15 et 17 février 2023
Au Théâtre de la Cité Internationale
Dans le cadre du Festival Faits d’hiver





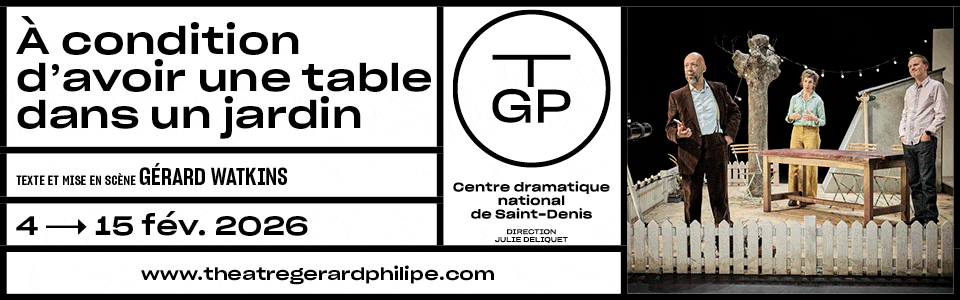
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !