Dans son récit Blanche, Catherine Blondeau interroge sa propre blancheur. Cette passionnante enquête autobiographique pose la nécessité d’une nouvelle « poétique de la relation », que l’auteure développe à l’échelle du Grand T à Nantes qu’elle dirige depuis 2011.
C’est par la fiction que Catherine Blondeau fait son entrée en littérature. Dans Débutants (Mémoire d’Encrier), publié à Montréal en 2018 puis en France en janvier 2020, la directrice du Grand T à Nantes rassemble dans un petit village de Dordogne, Les Eyzies, des personnages d’origines diverses. Des exilés plus ou moins volontaires. L’anglais Peter Lloyd, traducteur, y vit depuis la disparition de son amant, mort du Sida quinze ans plus tôt. Il y est devenu ami avec la jeune Polonaise Magda Kowalska, qui tient une maison d’hôtes dans le village, et rencontre en 2004 l’archéologue sud-africain Nelson Ndlovu, invité pour l’inauguration du musée national de la Préhistoire. Aussi documenté que romanesque, ce livre doit beaucoup aux différentes expériences de l’auteure, qui avant de prendre en 2011 la direction du Grand T a été Maître de conférences en littérature et arts du spectacle à l’Université de Rouen, directrice de l’Institut français d’Afrique du Sud à Johannesburg, attachée culturelle à Varsovie et conseillère artistique du festival Automne en Normandie.
Dans Blanche, ce riche parcours international apparaît de façon plus directe. Autobiographique, le récit qu’y déploie Catherine Blondeau retrace en de courts chapitres efficaces, ciselés à la manière de nouvelles, l’itinéraire intellectuel d’une femme qui, en découvrant la vie et les penseurs d’Afrique du Sud, découvre qu’elle est blanche. Son enquête vient bien après la stupeur : en suivant le sillage de Frantz Fanon qu’elle cite en exergue – « Dans le monde où je m’achemine, je me crée interminablement » – l’auteure se fait anthropologue d’elle-même. Elle remonte aussi loin que possible, à l’enfance, pour cerner les contours de sa propre blancheur. Autrement dit, de sa conscience d’être blanche dans des pays à la mémoire coloniale encore vive.
Mises au même plan, ses rencontres littéraires, ses expériences intimes et professionnelles dessinent les mécanismes d’une pensée complexe, prête à toutes les remises en question, à tous les déplacements. Mue par un profond désir de connaissance de soi et de transformation des rapports Nord-Sud, l’écriture de Catherine Blondeau incarne avec force et intelligence l’urgence d’une nouvelle éthique, sur le pan interhumain aussi bien que politique. Elle dit la nécessité d’une « poétique de la relation », selon l’expression d’Édouard Glissant cité à plusieurs reprises dans Blanche, de même que dans les textes de communication du Grand T, dont Catherine Blondeau travaille à faire un « théâtre de la relation ».
Dans Débutants et plus encore dans Blanche, l’Afrique du Sud occupe une place centrale. En quoi votre désir d’écriture est-il lié à ce pays ?
Catherine Blondeau : Je flirtais avec l’écriture depuis un certain temps lorsque je suis partie vivre en Afrique du Sud. J’avais déjà écrit quelques nouvelles, mais l’envie d’écrire un roman est vraiment née à cette période qui m’a beaucoup changée. En vivant dans ce pays qui m’était en tout étranger, je me suis retrouvée dans une position d’observatrice qui est idéale pour le romancier. Ne comprenant aucune des onze langues qui se parlent là-bas, j’avais toujours la sensation d’être un peu à côté de ce qui se passait, et en même temps d’être pleinement dans le présent. L’environnement sud-africain m’a tout de suite passionnée. Lorsque j’ai entamé l’écriture de Débutants, j’ai puisé dans tout ce que j’ai vécu pendant cinq ans dans ce pays, ainsi que plus tard en Pologne, un peu à la manière d’une anthropologue. Je suis aussi retournée dans ces deux pays pour mener des recherches qui allaient nourrir la fiction.
Justement, pourquoi avoir commencé par la fiction, avant d’entamer une démarche autobiographique ?
Je suis une grande lectrice, et mon univers de référence a toujours été la fiction. C’est à travers elle que j’aime le plus lire le monde. Écrire un roman était donc d’abord un rêve de lectrice. J’ai essayé à plusieurs reprises, en vain, jusqu’à ce qu’en passant quelques étés en Dordogne je découvre les liens forts qu’entretiennent depuis longtemps les équipes d’archéologues de cette région française avec ceux d’Afrique du Sud. J’ai trouvé là le ressort romanesque qui me manquait jusque-là, ainsi qu’une manière de rendre à ce pays tout ce qu’il m’a donné. Je me suis toujours un peu considérée comme une universitaire défroquée : le savoir me passionne mais je ne suis pas à l’aise avec l’idée de spécialisation. Le roman permet de convoquer des savoirs divers.
Ces savoirs ont pour beaucoup trait à des épisodes historiques, dont certains – comme l’apartheid – sont également évoqués dans Blanche. En quoi est-il important pour vous d’évoquer le passé ?
Dans la fiction française, le XXème siècle a très souvent tendance à se réduire à la Seconde Guerre Mondiale. C’est une sorte de mythologie, qui occulte de nombreux autres épisodes peu connus du grand public, comme l’histoire des Polonais exilés en France, notamment dans le quartier de la Petite-Pologne à Paris, faubourg populaire situé dans l’actuel VIIIème arrondissement. J’en parle dans Débutants à travers l’un de ses trois personnages principaux : Magda, Polonaise dont les parents ont grandi en France avant de retourner en Pologne sous le communisme. À travers le personnage de Nelson, j’aborde aussi dans ce même livre l’histoire de la lutte anti-apartheid, qui n’est elle non plus pas très connue en France. La connaissance de ces moments d’Histoire est selon moi indispensable pour appréhender le présent.
C’est à travers votre parcours personnel que vous abordez dans Blanche l’histoire coloniale et surtout post-coloniale franco-africaine. Quelle méthode avez-vous adoptée pour réaliser ce travail d’autobiographie historique ou « sociale » pour rendre le terme d’Annie Ernaux, notamment au sujet des Années auquel fait penser votre récit ?
Si les littératures afro-caribéennes occupaient déjà depuis longtemps une place importante dans mes lectures, c’est en découvrant les écrits du philosophe Achille Mbembe que la pensée post-coloniale devient centrale dans ma manière de comprendre le monde, et donc d’appréhender l’écriture. Je vis alors depuis peu en Afrique du Sud, et j’entame un grand cycle de lectures, dans lequel Franz Fanon s’impose très vite comme une figure majeure. Je lis pour la première fois Peau noire, masque blanc en 2006 : je suis fascinée par ce livre aussi politique que philosophique. La manière sensible et intellectuelle, proche d’une enquête, dont l’auteur fait le récit de son itinéraire personnel me passionne. Je m’identifie d’emblée à son parcours. Bien qu’à une époque et à une place différente de la sienne, je ressens la même étrangeté que lui, la même difficulté à trouver ma place dans les différentes sociétés où je vis. Plus de dix ans après ma première lecture, j’ai l’envie d’écrire une sorte de réponse, un dialogue avec ce livre qui m’a tant apporté. Franz Fanon questionnait sa noirceur ; j’interroge ma blancheur ou « blanchité ».
Franz Fanon est loin d’être le seul auteur que vous citez dans Blanche : dans ce récit, les événements de votre vie sont placés sur le même plan que vos lectures.
J’ai en effet eu l’envie de ponctuer ce texte par ce que j’appelle des « exercices d’admiration » ou des « notes d’impact ». Autrement dit, par des sortes de fiches de lecture très subjectives, où j’explique comment les œuvres en question ont modifié ma vision du monde. Cette démarche répond à un besoin d’orchestrer mes connaissances pour mieux construire ma blanchité. Des auteurs comme Léonora Miano, Ta-Nehisi Coates ou encore Brit Bennett, par exemple, m’ont beaucoup fait avancer. Je voulais leur rendre hommage, ainsi qu’à de nombreux autres.
Ces auteurs qui vous ont accompagnée dans votre réflexion sur votre « blanchité » sont pour la plupart anglo-saxons et noirs. Pour quelle raison ?
J’ai l’impression qu’en France, nous n’en sommes pas encore au stade du débat d’idées concernant les traces laissées par la période coloniale. Si dans les pays anglo-saxons, les études post-coloniales sont très développées et considérées comme un pan important de la recherche universitaire, elles pâtissent en France d’une assez mauvaise réputation. Elles sont souvent vues comme une attaque de la « pensée française », encore très marquée par l’héritage des Lumières. Si des voix différentes commencent à s’élever, elles sont la plupart du temps disqualifiées, et restent donc minoritaires. Avec Blanche, j’ai voulu dire la nécessité d’entrer en dialogue avec les cultures des anciens pays colonisés et de leurs héritières en Occident. Il est temps d’inventer un nouvel universalisme, différent de celui qui est décrété depuis le XVIIIème siècle. D’autant plus que ces cultures jugées minoritaires en France sont loin de l’être à l’échelle mondiale.
Est-ce du fait de la frilosité du milieu de l’édition français que Blanche est comme Débutants publié par une maison québécoise, Mémoire d’Encrier ?
Je ne pourrais le dire avec certitude. Ce qui est sûr, c’est que le manuscrit de Débutants a été refusé par les maisons d’éditions auxquelles je l’ai envoyé. Sa publication chez Mémoire d’Encrier est entre autres le fruit de ma rencontre en Pologne, lorsque je travaillais au Bureau du livre, avec l’écrivain Rodney Saint-Éloi, qui dirige cette maison formidable où il publie de nombreux auteurs que j’estime beaucoup, tels que Léonora Miano, Felwine Sarr ou encore Denis Laferrière. Lorsque Mémoire d’Encrier a commencé à être diffusé en France, il m’a semblé évident d’accepter la proposition de publication de Rodney Saint-Éloi. Dans sa maison, je me sens entourée d’une famille idéale.
Si le théâtre, qui vous occupe depuis 2011 en tant que directrice du Grand T à Nantes, est absent de Débutants, vous évoquez à plusieurs reprises des auteurs et metteurs en scène dans Blanche. L’écriture nourrit-elle votre manière de diriger un théâtre ?
L’écriture de Débutants était pour moi un lieu d’intimité, une sorte de refuge dans mon quotidien très chargé de directrice de théâtre. Avec Blanche en effet, cela a commencé à changer. J’y parle de ma relation avec certains artistes dont j’aime particulièrement le travail, comme Lazare ou Ahmed Madani. Ma réflexion sur ma blanchité a forcément eu un impact sur ma programmation et sur ma manière de diriger un lieu. Naturellement, j’ai voulu travailler avec des auteurs et des metteurs en scène issus de l’immigration et avec des francophones de tous pays. On parle beaucoup de la présence d’artistes issus de la « diversité » au plateau, mais il est pour moi aussi très important d’être attentif aux signatures. La question de la parité a encore tendance à reléguer au second plan celle de la « diversité » au sein des institutions théâtrales françaises. Je crois qu’il faut y être très attentif.
Comment cette attention s’exprime-t-elle dans votre programmation ?
Déjà à travers le choix des artistes associés au Grand T, parmi lesquels l’autrice et metteure en scène Marine Bachelot Nguyen chez qui les questions féministes et postcoloniales sont centrales. L’artiste franco-algérienne Anaïs Allais, qui pratique une écriture sensible et très documentée, est aussi parmi nous pour porter des récits qui creusent dans des zones d’ombre de l’Histoire. L’ensemble de la programmation du lieu reflète aussi mon goût pour le dialogue entre les cultures. Enfin, dans le cadre de la saison Africa2020, j’ai voulu initier une collaboration avec le festival burkinabé Les Récréatrales, dont les représentations se font dans des cours d’immeubles à Ouagadougou. Nous avons beaucoup à apprendre de l’équipe de ce festival, notamment dans sa façon d’inviter le théâtre dans des espaces qui ne sont pas conçus pour lui, et de s’adresser ainsi à tous. J’ai tenu à concevoir ce partenariat de la manière la plus équitable possible, en construisant avec les équipes burkinabés l’édition nantaise de leur festival. Elle aurait dû avoir lieu en décembre dernier, nous l’avons reportée aux mois de juin et juillet 2021. Mon équipe et moi avons tellement hâte de pouvoir poursuivre nos beaux dialogues artistiques et de les partager de nouveau avec un public…
Propos recueillis par Anaïs Heluin – www.sceneweb.fr
Blanche, Catherine Blondeau, Mémoire d’Encrier, 237p., 19 €.





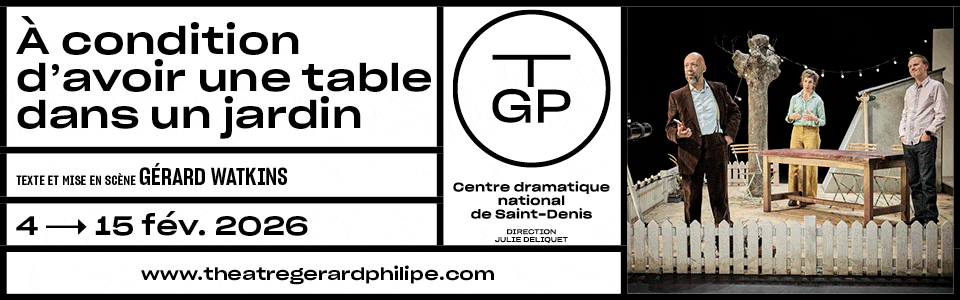





Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !