Martin Faucher est le directeur artistique du festival TransAmériques de Montréal depuis 2015, après en avoir été le conseiller artistique depuis sa création en 2007. L’édition 2019 s’achève le 4 juin. Il fait le point sur la création québécoise.
En tant que directeur artistique du Festival TransAmériques, quelle place laissez-vous à la création québécoise dans le festival et qu’est-ce qui oriente vos choix ?
La création nationale canadienne, pas seulement québécoise, représente 50% de la programmation du festival. Dans le lot, la majorité sont des projets québécois, mais il y a aussi des créations d’autres provinces. Je ne choisis pas les artistes en fonction de leur origine géographique, mais à partir de rencontres. Ils me parlent de leurs projets ou bien je vais voir leurs spectacles, et cela doit déclencher en moi un mouvement, que ce soit intellectuel ou artistique.
Quels sont les autres paramètres qui entrent en jeu dans vos choix ?
Je suis Montréalais depuis 1982, j’ai connu la ville dans ces années-là : cette effervescence de projets, de compagnies. Aujourd’hui, je suis conscient que des générations ont succédé à d’autres et j’essaye de laisser la place à chacun : les artistes confirmés comme les émergents. Mes choix sont conduits par la voix artistique, non pas la question politique ou sociale. Enfin, je suis un artiste à la tête d’un festival : je compose, je fais acte d’écriture. Je ne pourrai jamais témoigner d’une globalité mais seulement d’un ensemble de valeurs qui me guident, comme les bouleversements que connaît la société aujourd’hui dans son rapport avec les Premiers Peuples. On doit dépasser la seule réconciliation, l’inclusion, afin de trouver comment travailler avec l’autre. On doit retrouver le temps du regard sans faire autre chose en même temps, c’est pour ça que cette année la phrase qui conduit le festival est « sortir de soi ».
Qu’est-ce que vous aimeriez montrer davantage du Québec et que vous ne pouvez pas pour des raisons qui vous sont extérieures ?
Faire un festival, c’est un paradoxe. C’est à dire que l’on doit montrer l’inhabituel et en même temps c’est un business au sens Nord-Américain du terme : il faut que l’on vende des places. Nous devons donc porter une attention accrue aux artistes qui ne s’inscrivent pas naturellement dans cette logique de l’économie artistique. Donc j’aimerais montrer davantage, trouver des moyens pour travailler avec ceux qui n’incluent pas la dimension marchande dans leur création. Avec le festival, nous essayons de donner les moyens et la confiance pour accompagner les émergents. Nous essayons de démystifier les jeunes artistes auprès des partenaires, leur dire où est l’avenir, détecter les potentiels.
Qu’est-ce que la création contemporaine montre du Québec aujourd’hui ?
Au Québec, 80% de la danse contemporaine et 70% du théâtre se pratiquent à Montréal, le reste à Québec. Lorsqu’un artiste s’établit quelque part, c’est dans une ville et non pas dans un pays. Tout comme un artiste américain installé à Berlin depuis des années est berlinois. Alors qu’est-ce qu’un artiste de Montréal raconte d’aujourd’hui ? Sa relation au monde est très étrange, c’est un mélange de conscience politique et de simplicité de la vie comme seule Montréal l’apporte. A Montréal, il reste une certaine inconscience chez les artistes, qui en France a totalement disparu. La scène montréalaise est dans la transmission des émotions à l’autre, la bienveillance. Les gens de l’extérieur peuvent dire qu’on est consensuels parce qu’on aime à rappeler que, dans une salle de spectacle, on est bien ensemble. Les thèmes ne sont pas pour autant innocents : on s’intéresse à la famille, au rapport à la langue… En danse, on réinvente l’art d’être ensemble et comment sortir de la productivité. Montréal résiste au système qui veut que les artistes fassent preuve d’efficacité et de rendement.
Qu’est-ce que le monde voit de la création Québécoise aujourd’hui et, plus généralement, qu’est-ce qu’il ne voit pas ?
Souvent, les critiques soulignent une naïveté, un manque de complexité qui nous caractériserait. Ce qu’on ne voit pas en affirmant cela, c’est la force de la simplicité ou de la naïveté et, surtout, le plaisir qu’on tire d’un spectacle. J’ai l’impression qu’en France, il arrive qu’on refuse le plaisir théâtral, peut-être par manque d’abandon de soi. Nous, à Montréal, nous avons un rapport à l’esthétique et à l’émotion, pas seulement à l’idée.
Propos recueillis par Hadrien Volle – www.sceneweb.fr





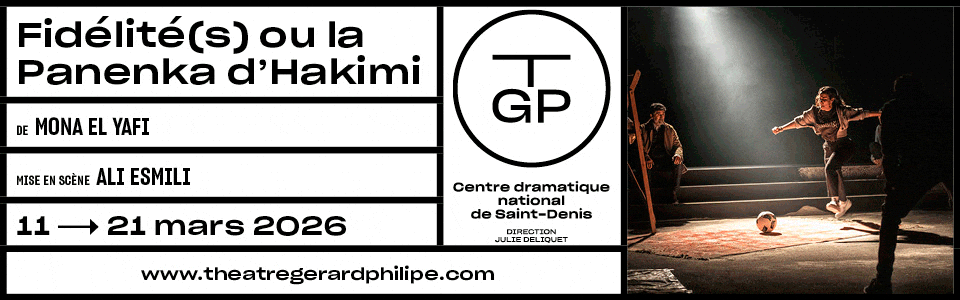








Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !