Au long de sa dernière création, l’artiste tente d’aller par le cirque à la rencontre du Grand Nord. Entre explorations d’hier et réalités d’aujourd’hui, ses sources d’inspiration multiples peinent à dessiner un chemin clair à travers le monde arctique.
Depuis Les hauts plateaux (2019), où il interrogeait avec son langage circassien l’état de l’homme dans un monde cerné par des catastrophes de tous ordres, Mathurin Bolze n’a pas fait que travailler à la création de la Cité Internationale des Arts du Cirque dans la Métropole de Lyon, dont la naissance très attendue est prévue pour 2028. Habitué aux grands écarts par sa discipline d’origine, le trampoline, l’artiste a su s’extraire des affaires institutionnelles et de leurs grands enjeux pour le développement des arts du cirque et s’en aller là où de cirque contemporain il n’y a guère, où même la présence humaine est chose rare : le Grand Nord. Le cirque, toutefois, n’est pas étranger au voyage, qu’il effectue avec une personne rencontrée lors de ses premières expériences d’interprète, avant de la perdre de vue : le compositeur et artiste sonore Philippe Le Goff, également passionné par le Grand Nord qu’il parcourt depuis plus de 30 ans, et à partir duquel il développe un travail fondé sur la notion d’oralité. En suivant ce connaisseur des paysages arctiques dans ses traversées, Mathurin Bolze avait l’intention de ramener dans sa besace de la matière pour un nouveau spectacle. Envisageait-il ainsi de poursuivre son exploration des abysses de l’époque ou, au contraire, de s’en éloigner, d’aller chercher dans le blanc et le froid des raisons d’espérer encore, autrement ?
À l’image de son titre qui laisse entrevoir doutes et autres méandres, Immaqaa, ici peut-être n’offre pas à la question de réponse claire. En faisant cohabiter un mot en inuktitut et sa traduction en français – « immaqaa » signifie « peut-être » dans cette langue inuite du Canada qu’a enseignée Philippe Le Goff à l’INALCO à Paris –, Mathurin Bolze pouvait nous faire miroiter la restitution par le cirque d’une expérience d’immersion dans une culture radicalement différente. C’est pourtant sur une voie tout autre que nous met la scène d’ouverture du spectacle, où l’élément central de la scénographie conçue par Gala Ognibene, un grand édifice blanc évoquant autant une piste de skate qu’un glacier, nous est présenté de dos. L’entrelacs de pièces métalliques, de portants de vêtements et autres accessoires que l’on retrouvera tout au long du spectacle rappelle la cabane inachevée du premier spectacle de Mathurin Bolze, son solo Fenêtres (2002), reprise ensuite dans Barons perchés (2015) qu’il interprète avec Karim Messaoudi. En exhibant d’emblée les dessous, les coulisses de son travail, le metteur en scène paraît d’autant plus revenir à l’origine de son geste qu’Immaqaa naît des retrouvailles évoquées plus tôt. En nous présentant ses huit interprètes – Léon Volet, Anahi De Las Cuevas, Tamila De Naeyer, Maxime Seghers, Helena Humm, Corentin Diana, Mattéo Callewaert et Dario Carrieri – en pleine simili-préparation dans leur sorte d’échafaudage, Mathurin Bolze semble partir de son cirque intime pour aller vers le Grand Nord, et non l’inverse.
Mais, une fois le décor retourné pour nous montrer sa face immaculée, cette approche se dissout elle aussi dans une esthétique hésitant entre illustration et évocation des réalités découvertes par Mathurin Bolze lors de son voyage. Souvent centrés sur une figure que les acrobates reproduisent et déclinent jusqu’à en épuiser les possibles, des tableaux acrobatiques alternent avec d’autres plus théâtraux, à la tonalité toujours légèrement absurde. Ces deux façons d’appréhender le plateau, en particulier sa pente qui paraît constituer pour les artistes à la fois l’horizon ultime et la limite de l’univers, peine à former un ensemble plus cohérent et lisible que le point de départ du spectacle. La relation au Grand Nord des acrobates, pour la plupart aériens, ne prend jamais vraiment consistance. Si les huit artistes abordent parfois leur agrès-glacier, qu’ils modulent et écartèlent au fil de la pièce avec la dégaine d’explorateurs du dimanche ou de citadins égarés, ils semblent entretenir un rapport plus métaphorique au territoire exploré par Mathurin Bolze, ainsi qu’à ses habitants et à leur langage. Sans aller jusqu’à tenter d’incarner des Inuits, on devine à travers certains numéros, comme le beau premier solo de trapèze avec lequel on découvre la face jusque-là cachée du décor, le désir de donner forme à d’autres manières d’habiter le monde que la nôtre.
L’utilisation singulière de certains agrès traditionnels, comme le trapèze et le trampoline, et l’apparition d’agrès inventés pour l’occasion ne suffisent pourtant pas à définir précisément ce rapport au monde et au présent qu’Immaqaa semble chercher à développer. L’effet documentaire produit par la présence d’images de montagnes, de sons et paroles collectés par Mathurin Bolze et Philippe Le Goff est sans cesse balayé par un onirisme dont le Grand Nord n’est plus qu’une source d’inspiration assez lointaine. Le metteur en scène dit aussi s’être nourri d’un roman d’Hélène Gaudy, Un monde sans rivage (Actes Sud, 2019), qui relate une expédition en ballon vers le pôle Nord à la fin du XIXe où ont péri tous les protagonistes retrouvés seulement trente ans plus tard. Cette source apparaît sous forme de traces, telles que l’apparition finale d’un grand tissu blanc aux allures de parachute, qui ne relient aucunement entre elles les composantes hétérogènes d’Immaqaa, dont on revient sans trop savoir où nous sommes partis ni pourquoi.
Anaïs Heluin – www.sceneweb.fr
Immaqaa, ici peut-être
Conception, mise en scène Mathurin Bolze
Avec Léon Volet, Anahi De Las Cuevas, Tamila De Naeyer, Maxime Seghers, Helena Humm, Corentin Diana, Mattéo Callewaert, Dario Carrieri
Composition musicale Philippe Le Goff
Conception sonore Jérôme Fèvre
Dramaturgie Samuel Vittoz
Scénographie Gala Ognibene
Construction décor Ateliers de la MC93 Bobigny
Machinerie scénique Nicolas Julliand
Création lumières Victor Egéa
Costumes Clara Ognibene
Création vidéo Orin CamusProduction Compagnie MPTA (Lyon)
Coproduction Maison de la Danse, Lyon – Pôle européen de Création ; UTOPISTES – Cité Internationale des Arts du Cirque ; La Brèche, Pôle National Cirque de Normandie ; Théâtre de Sartrouville et des Yvelines- CDN ; Scène nationale de Bourg-en-Bresse ; Espace des Arts, Scène nationale de Chalon-sur- Saône ; Château Rouge – Scène conventionnée – Annemasse ; MC2 : Maison de la Culture de Grenoble – Scène nationale ; BONLIEU – Scène nationale d’Annecy ; MALAKOFF Scène nationale Théâtre 71 ; Scène nationale de L’Essonne ; MC93 – Maison de la culture de Seine- Saint-Denis à Bobigny
Soutien Convention Institut Français / Ville de Lyon ; Aide à l’écriture pour les arts du cirque du Ministère de la Culture – Direction Générale de la Création Artistique ; Dispositif Jeune cirque national du CNAC de soutien à l’insertion de jeunes diplômé.es du DNSP d’Artiste de Cirque ; Dispositif d’insertion professionnelle de jeunes diplômés de l’ENACR (Rosny-sous-Bois).Durée : 1h10
Vu en mars 2025, au Théâtre de Sartrouville et des Yvelines – CDN
La Brèche, Pôle National Cirque de Normandie / Cherbourg-en-Cotentin, dans le cadre du festival SPRING
les 13 et 14 marsMC2 : Maison de la Culture de Grenoble, Scène nationale
du 19 au 21 marsChâteau Rouge, Scène conventionnée, Annemasse
les 27 et 28 marsScène nationale de Bourg-en-Bresse
du 9 au 11 avrilBonlieu, Scène nationale d’Annecy
du 16 au 19 avrilEspace des Arts, Scène nationale de Chalon-sur-Saône
les 21 et 22 maiMaison de la Danse, Lyon, dans le cadre du Festival utoPistes
du 3 au 6 juinLa Comédie Saint-Étienne, dans le cadre du Festival des 7 Collines
du 24 au 26 juin





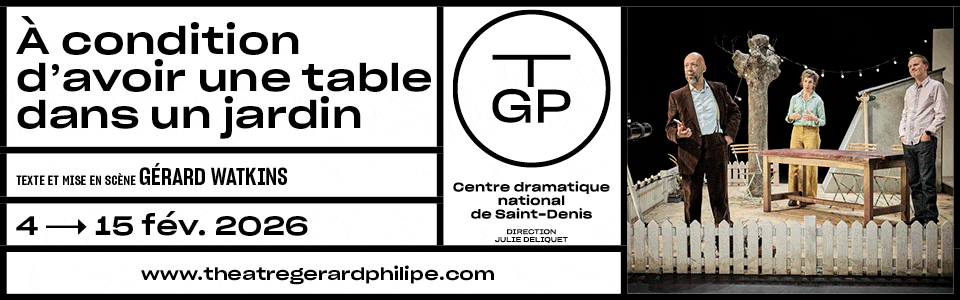







Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !