L’auteur et metteur en scène burkinabé se fait maestro tragique à l’occasion des Zébrures d’automne, le festival des francophonies qui se tient à Limoges du 24 septembre au 4 octobre. Avec force et douceur, il évoque, dans Fadhila, le destin des enfants-soldats enrôlés dans la violence, et le chagrin des mères qui les pleurent.
Une voix émerge du désert et fredonne une comptine. Trois rochers mordorés faiblement éclairés semblent abandonnés au milieu du sable. Ils seront le seul décor de la tragédie en trois temps qui va se dérouler sous nos yeux. Cette voix, c’est celle de Fadhila, qui convoque les souvenirs de ses deux fils, Abdou et Aziz. Ces images, invoquées par Fadhila, retracent peu à peu la lente séparation de l’aîné, Abdou, qui se fait enrôler par l’intégrisme islamique jusqu’à rejoindre les rangs des milices armées, malgré les efforts de sa mère. On y croise un instructeur qui, s’il s’avère sanguinaire, sait aussi utiliser les blessures des enfants un peu égarés qui se trouvent face à lui. Chez Abdou, c’est la rancœur envers son père, parti pour l’Europe après son licenciement, qui le hante. Les milices vont ainsi embrigader de nombreux garçons du village en leur promettant l’amour et la reconnaissance dont ils pensent manquer chez eux, mais en les remplaçant, en réalité, par la violence et les drogues.
Ayant donc perdu son mari et son fils aîné, Fadhila se raccroche au souvenir de son cadet, Aziz, qui, de son côté, veut s’engager comme Volontaire pour la défense de la patrie, un groupe affilié à l’armée qui s’oppose aux miliciens actifs dans le nord du pays. Ainsi, tels Étéocle et Polynice – les deux fils d’Œdipe et Jocaste dans la tragédie grecque éponyme –, on imagine les deux frères destinés à une guerre fratricide sans issue, chacun dans l’un des camps qui déchirent le pays. Reste alors Fadhila, seule dans le désert, telle une Antigone rendant hommage à ses hommes disparus, entourée de ces trois rochers comme autant de pierres tombales pour ces âmes égarées. Et, comme dans toute bonne tragédie, on la voit se battre vainement contre le sort inéluctable, interpeller les ancêtres sur la douleur de son destin, avant de l’affronter, finalement, magnifique d’affliction et de courage.
Elle n’aura pour seule compagne dans sa traversée du malheur que la truculente Madame Gombo frais, sa voisine. Celle-ci attend aussi le retour de son fils parti pour l’Europe. Alors, elle prépare inlassablement un unique et similaire gombo. Chez elle, l’arme de résistance numéro un, c’est la nourriture, et le rire. Personnage lumineux de douceur et de force, elle tiendra tête aux milices qui voudront la déloger du village, allant jusqu’à se crever les yeux, tel un nouvel Œdipe, pour les faire fuir. Aristide Tarnagda complète le tableau en rajoutant un dernier personnage, celui de l’aède – interprété par Romane Ponty-Bésanger –, prenant en charge certaines didascalies et se mêlant au chœur de femmes formées par Fadhila et Madame Gombo frais. Cette troisième figure féminine et d’importantes coupes dans le texte – laissant le destin d’Aziz suspendu entre la mort et le départ – permettent de recentrer l’intrigue sur les voix de ces femmes unies autour de la douleur du départ. Douleur qui, ici, n’est jamais exempte de douceur, comme nous le rappelle la dernière image, sublime, où les deux frères se retrouvent enfin dans un espace où l’enfance semble encore possible.
La force de la proposition tient évidemment à la langue précise et symbolique d’Aristide Tarnagda, qui explore à travers la dizaine de textes qu’il a signés pour le théâtre les thématiques de l’exil et du déracinement, mais aussi la place des femmes, comme dans Les larmes du ciel d’août. Avec Fadhila, l’auteur burkinabé fait entrer son écriture dans une nouvelle dimension et saisit les enjeux de la tragédie grecque pour mieux l’actualiser. Il la place avec beaucoup de doigté dans une réalité concrète – on entend le nom du président Sankara, des mentions à la Russie, au groupe armé Wagner, à la France –, tout en n’oubliant pas de rendre sa fable universelle, l’inscrivant dans un temps et un espace sans contour. Le tout est relevé par une distribution éblouissante – Safoura Kaboré se révèle en tragédienne intense – et par les somptueuses images ciselées par les couleurs et la lumière imaginées par Marie-Pierre Bésanger. Avec Fadhila, Aristide Tarnagda affirme sa langue unique et sa capacité à créer des images puissantes et communes.
Fanny Imbert – www.sceneweb.fr
Fadhila
Texte et mise en scène Aristide Tarnagda
Commande d’écriture du Bottom Théâtre
Avec Romane Ponty-Bésanger, Yaya Mbilé Bitang, François Copin, David-Minor Ilunga, Safoura Kaboré
Scénographie Marie-Pierre Bésanger
Construction décor CDN Théâtre de l’Union – Alain Pinochet, Clément Tilly
Artiste invitée Anne-Marie White
Assistance à la mise en scène Romane Ponty-Bésanger
Musique Joaquim Pavy
Lumières Marco Hollinger
Son Vincent Le Meur
Costumes Martine SoméProduction Le Bottom Théâtre
Coproduction OARA, Les Francophonies – Des écritures à la scène, L’Empreinte – Scène nationale Brive-Tulle, Théâtre National du Luxembourg, Théâtre de l’Union – CDN du Limousin
En partenariat avec la CITF, le Conseil des arts du Canada, Patrimoine canadien et la Fondation de France
Aide à la création de textes dramatiques – ARTCENA
Accueil avec le soutien de l’OARA et en partenariat avec le CCM Jean Gagnant – Ville de LimogesLa compagnie est soutenue par le Ministère de la Culture DRAC Nouvelle Aquitaine, la région Nouvelle Aquitaine, le Département de la Corrèze et la ville de Tulle.
Durée : 2h
Vu en septembre 2025 au CCM Jean Gagnant, Limoges, dans le cadre des Zébrures d’automne / Les Francophonies – Des écritures à la scène
L’Empreinte, Scène nationale Brive-Tulle
les 12 et 13 novembreThéâtre National du Luxembourg
du 18 au 21 novembre


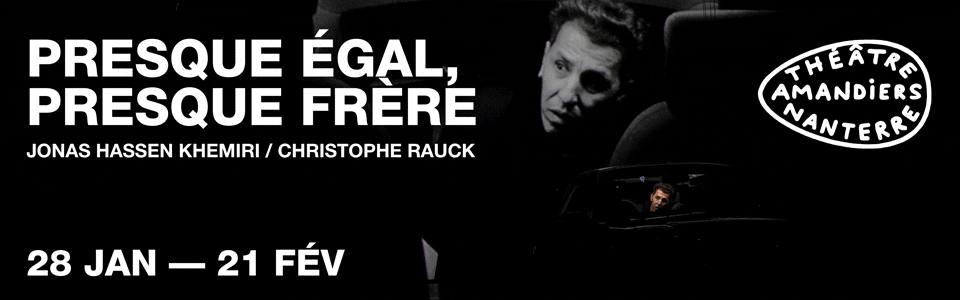




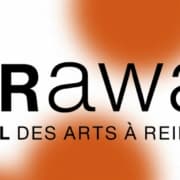





Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !