Génération sceneweb (4/30). Avec sa compagnie La Part du Pauvre/Nana Triban créée en 2000, la metteure en scène et auteure Eva Doumbia défend un théâtre d’identités plurielles. Un théâtre opposé à toutes les dominations.
Écrire et mettre en scène sont pour Eva Doumbia des réactions à ce qui se trame aujourd’hui dans le monde, en particulier en matière d’injustices. Le soir où nous l’appelons, au tout début du reconfinement, les réactions à l’assassinat de Samuel Paty la tourmentent. La dénonciation d’enfants de dix ans par des professeurs, surtout, l’inquiètent. « Il va falloir que des artistes s’emparent du problème. Le processus qui mène à décapiter quelqu’un doit être questionné, décrypté par la littérature, le cinéma, le théâtre ». Elle n’en dit rien alors, mais il n’est pas impossible qu’elle relève cette mission que l’on peut qualifier d’« utilité publique », comme l’ensemble du théâtre qu’elle créée depuis la fondation de sa compagnie La Part du Pauvre/Nana Triban en 2000. Née dans la banlieue du Havre d’un père ouvrier et d’une mère institutrice, Eva Doumbia porte d’emblée une esthétique qui lui ressemble : « monstrueuse, hybride », dit-elle.
Après avoir rassemblé des artistes d’ici et d’ailleurs – d’Amérique et d’Afrique – autour de textes d’Edward Bond, d’Alfred de Musset, de Lars Norén, de Bertold Brecht, de Dieudonné Niangouna, de Chester Himes ou encore d’Aristide Tarnagda qu’elle fait connaître sur les scènes françaises, Eva Doumbia opère en 2010 un tournant féminin, voire féministe. Tout commence par une tragédie capillaire : lorsque, pendant sa grossesse, Eva perd une tresse. « Mes cheveux ne repoussaient pas, je ne savais pas quoi faire pour eux. Le mouvement Nappy était alors loin d’être développé comme il l’est aujourd’hui. C’est en faisant des recherches sur internet que j’ai trouvé des réponses, notamment auprès du salon Boucles d’Ebène ». La différence capillaire des femmes noires, et la violence que celles-ci infligent à leurs cheveux pour la cacher, est au cœur de Moi et mon cheveu, cabaret capillaire. Un beau succès, qui nourrit son désir d’aborder sur scène la question des identités féminines plurielles ou « afropéennes », mot qu’elle découvre alors sous la plume de Léonora Miano, et qui devient l’un des axes de son vocabulaire théâtral.
Afropéennes, c’est d’ailleurs le titre de sa création suivante. Adaptation des Écrits pour la parole de Léonora Miano, cette pièce interprétée par des artistes nées en France de parents africains est d’abord mal accueillie par le milieu professionnel. Eva n’est pas surprise : son travail dérange les habitudes du monde théâtral, il divise. « Les artistes noirs sont encore rares sur les plateaux, et plus encore les récits qui les mettent en scène. Je ne me reconnaissais pas dans ces récits ; d’où mon désir d’aller vers des écritures de femmes noires ». La metteure en scène se lance alors dans La Traversée. Soit trois spectacles où se succèdent les mots de Jamaïca Kincaid, de Fabienne Kanor et de Maryse Condé, l’une des grandes figures tutélaires d’Eva Doumbia. « Comme cette immense romancière qui n’a pas les faveurs de l’élite, je me suis toujours sentie un peu de côté. Même si les choses changent depuis quelques années, vers une plus grande ouverture ».
Passeuse décoloniale
Eva Doumbia a hérité de ses parents, tous deux communistes, une fibre militante : au sein du collectif Décoloniser les Arts fondé en 2005, elle participe à ce mouvement de reconnaissance des artistes racisés au sein des institutions. De retour en Normandie après avoir longtemps vécu et travaillé à Marseille, elle poursuit cet engagement au sein du Théâtre des Bains Douches à Elbeuf, où elle est en résidence artistique avec sa compagnie depuis septembre 2019, avec pour objectif d’« ouvrir cet équipement culturel de proximité à la population qui en est éloignée ». Elle y invite des artistes pour la plupart afrodescendants, dont les univers empruntent des sillons parallèles aux siens, qu’elle creuse maintenant avec sa propre écriture.
« Face à l’absence de récits destinés au théâtre qui me conviennent, j’ai ressenti le besoin d’en créer ». Après son roman Anges fêlées (2017), elle écrit et met en scène Le Iench (2020), fiction familiale située dans un quartier populaire, où elle dénonce les violences quotidiennes d’un monde raciste et patriarcal. « Le théâtre doit trouver sa place au cœur des quartiers populaires, il doit aussi en porter les accents, les langages ». Pour mieux ancrer son théâtre dans le présent, l’auteure et metteure en scène interroge aussi régulièrement le passé. C’est le cas dans Autophagies, qu’elle aurait dû créer au Festival d’Avignon 2020, où elle témoigne d’une histoire coloniale toujours à l’œuvre dans nos assiettes. Du cheveu à la banane ou au riz, tout est bon pour Eva Doumbia pour œuvrer à la décolonisation des imaginaires. Tout en envisageant d’aborder des sujets « plus universels ». Des injustices qui ne toucheraient pas que les personnes racisées, mais tout un chacun, par l’intime.
Anaïs Heluin


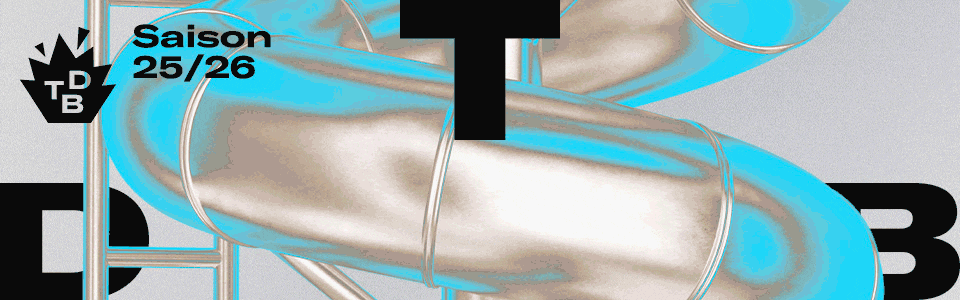


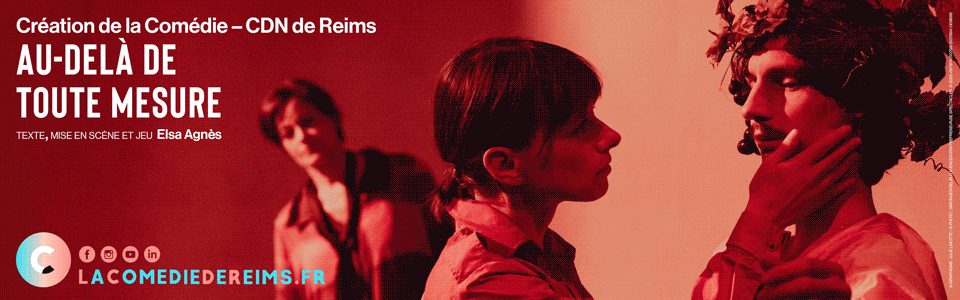








Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !