Avec Toutes les autres, l’autrice Clotilde Cavaroc aborde un sujet tabou : la sexualité des personnes en situation de handicap. Et lève le voile sur une pratique encore illégale en France, qui peine à se faire reconnaître comme un métier à part entière, celle d’assistant·e sexuel·le.
C’est un métier qui n’est pas reconnu en tant que tel dans notre pays, assimilé à de la prostitution. En Suisse, ce n’est pas le cas. On les appelle assistant·es sexuel·les. Leur mission ? Accompagner des personnes en situation de handicap qui le réclament dans la réappropriation de leur corps par l’intermédiaire d’un partage d’intimité, sexuel ou simplement sensuel. Retrouver ses sens et sensations pour remettre du sens au cœur de son existence. Clotilde Cavaroc s’est inspirée d’un essai autobiographique de Marcel Nuss (Je veux faire l’amour) et d’un documentaire de Stefano Ferrari (Moi, assistante sexuelle), qui abordent chacun le sujet sous une perspective différente, pour écrire cette pièce de fiction nourrie à la source du réel. Une histoire simple, mais juste et délicate, qui nous confronte à un impensé sociétal. La sexualité des personnes en situation de handicap est en effet un tabou, leur isolement et leur difficulté à trouver un ou une partenaire un angle mort.
Jamais misérabiliste ni larmoyante, la pièce avance étape par étape, de rendez-vous en rendez-vous, afin de mieux épouser le rythme nécessaire pour s’apprivoiser. D’abord, il y a l’embarras du premier coup de fil, formuler la demande à un inconnu relève du saut dans le vide ; puis, la gêne de la première rencontre, le côté « bizarre » d’une date moyennant finance. Et si Antoine est infirmier, marié et pratique cet « à-côté », Clémence, qui fait appel à lui, n’est pour autant ni sa patiente ni sa cliente, mais la « bénéficiaire », selon le terme approprié. Car, dans ce contexte de grande vulnérabilité où un cadre est posé d’emblée pour éviter les dérapages, où les limites sont énoncées dès le premier contact, les mots ont leur importance. Ils ont le pouvoir d’enfermer et de réduire une situation – comme le fait la mère de Clémence, intrusive et opposée au procédé – autant que de l’ouvrir à une autre vision des choses. Le rapport d’argent clarifie le contexte, strictement professionnel : il s’agit d’un service prodigué à quelqu’un qui en a besoin et le réclame, et dont le consentement des deux est évidemment la base.
Au-delà de son caractère sexuel, c’est une relation qui se tisse, la rencontre de deux êtres qui apprennent à se connaître, à se faire du bien et à se donner du plaisir. Mais le début du spectacle, qui commence par la fin, douloureuse et déchirante, nous annonce, par un effet de boucle, que, malgré toutes les précautions prises, l’attachement est parfois inévitable, un mal pour un bien, peut-être. La pièce ne tranche pas dans un sens ou dans l’autre, elle observe et donne à comprendre ce service d’une teneur particulière. Aucun jugement moral ici, mais l’envie de témoigner. Dans un décor simple, qui symbolise l’appartement de la jeune femme qui a perdu l’usage de ses jambes à la suite d’un accident de voiture, rien n’est en trop : un fauteuil roulant, une table et une chaise. Les tapis qui jonchent le sol apportent chaleur et intimité à ce huis clos émouvant. Subtile, la mise en scène d’Élise Noiraud joue sur une partition de lumières qui en éclairent les différents degrés de fiction.
Ponctué de voix off de témoignages audio, de monologues-confidences face public qui nous plongent dans l’intériorité de Clémence ou dans les réunions d’Antoine, qui partage avec des confrères et consœurs les problématiques auxquelles ils et elles sont confronté·es, le spectacle déroule son alternance de dialogues et de scènes charnelles délicatement chorégraphiées. S’y expriment la naissance d’une confiance réciproque, un laisser-aller progressif, le besoin de toucher et d’être touché, une complicité grandissante et belle à voir. Ces parenthèses de tendresse sont le prolongement physique du lien qui se noue entre Antoine et Clémence, interprétés avec une palette de jeu souple et émouvante par Kimiko Kitamura et Stéphane Hausauer. Et si la bande son accompagne de façon un peu trop mélodramatique ce qui glisse doucement vers une histoire d’amour, les références musicales n’en demeurent pas moins douces à l’oreille, d’Arvo Pärt à René Aubry, en passant par Anohni and the Johnsons, jusqu’à la chanson finale signée Grand Corps Malade.
Marie Plantin – www.sceneweb.fr
Toutes les autres
Texte Clotilde Cavaroc
Commande de mise en scène Elise Noiraud
Avec Kimiko Kitamura, Stéphane Hausauer
Collaboration artistique Clotilde Cavaroc
Création lumières François Leneveu
Scénographie Fanny Laplane
Chorégraphies Ira Nadia KodicheCoproduction Compagnie OrNotToBe, Pony Production, ACME, Compote de prod
Partenaires Région Ile-de-France, APF France handicap, APPAS, Adami, Beaumarchais-SACD, Mairie du XXe arrondissement de Paris, Proarti
Accueil en résidence Les Plateaux Sauvages, la MTD d’Epinay-sur-Seine, le Théâtre de Bligny, le Théâtre Douze
Action financée par la Région Ile-de-France
Ce projet a bénéficié du soutien de la commission culture de la mairie du 20ème arrondissementDurée : 1h10
Théâtre de Belleville, Paris
du 5 au 28 octobre 2025


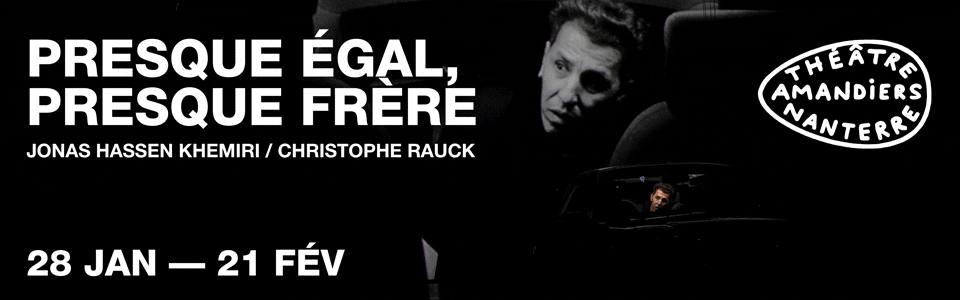








Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !