Solo organique à la puissance déflagratrice, Boujloud (l’homme aux peaux) fait craquer les coutures de la représentation pour convoquer ce qui reste de nous après : après le viol, après l’abus, après l’inceste. Terrienne et tribale, mais à la marge du folklore, Kenza Berrada puise à la source d’un rite traditionnel d’Afrique du Nord pour relier la parole au corps. Chamanique et réparateur.
Certains spectacles ont la grâce des offrandes, la force ancestrale des rites, la puissante nécessité d’exister dans un présent qui tremble et fait vaciller les fondations de l’ancien monde. Boujloud (l’homme aux peaux) est de ceux-là. Il participe de toutes les voix qui osent briser le silence et nos représentations erronées, il s’immisce dans un élan contemporain du féminin qui reprend ses droits, il explose les frontières culturelles pour embrasser nos histoires, nos vies, et les viols subis par des générations de femmes à la merci d’un système qui permet le pire. Mais Boujloud n’est pas un spectacle de plus sur le sujet. Il apporte sa pierre, il ouvre un cratère, il répare en allant chercher dans les abysses de la mémoire. Il puise dans le rituel ses vertus expiatoires et replace le corps de la femme au centre de l’arène, au centre du cercle de l’attention, au centre du regard et de la parole qui en sort. Kenza Berrada est l’instigatrice de ce sort, l’âme démoniaque de ce spectacle brûlant autant que réconfortant, qui plante sa hache dans les tabous, les interdits, les convenances et tous les empêchements. Elle se révèle performeuse hallucinante et hallucinée dans une transe physique et verbale qui laisse le public en état de sidération.
C’est au Théâtre de la Bastille, qui consacre sa programmation aux dramaturgies méditerranéennes et sa saison aux « identités performées », que l’on découvre ce phénomène. La salle du haut nous transporte ailleurs, au Maroc vraisemblablement (on le comprendra rapidement), grâce à un écran de tissu blanc projetant des ambiances énigmatiques et nocturnes entrecoupées de textes qui viennent planter le décor : le Boujloud est un rituel ancestral du Rif et du Haut Atlas occidental, un carnaval de monstres aux prises avec des forces obscures et surnaturelles, une mascarade qui met en scène l’abus et travestit l’homme en animal. Pendant ce temps, presque nue dans une scénographie tapissée de végétation en fond de scène et de peaux de bêtes étalées au sol, Kenza Berrada, les yeux maquillés de noir en un masque de guerre, s’enduit le corps et le visage d’argile, carapace protectrice ou seconde peau pour renaître ; elle se couvre et se découvre des fourrures qui l’entourent, se métamorphose au gré des âges qu’elle convoque. « J’ai 36 ans », « J’ai 7 ans ». On avance et on recule dans l’espace et dans le temps au rythme de ses évocations et transformations. Chronologie abolie. Générations confondues. Frontières effacées. On ne la quitte plus des yeux et des oreilles, sous hypnose littéralement.
Si sa présence scénique est emplie de mystère et d’autres vies que la sienne, son entrée en matière met les choses au clair, et Kenza Berrada nous fait d’emblée part de sa démarche. Partie enquêter sur la notion de consentement chez les femmes de sa génération (des trentenaires) dans son pays d’origine, elle croise le chemin d’Houria qui lui confie son histoire. Cette rencontre dynamite le projet initial, qui prend alors un virage inattendu. L’impact du récit sur Kenza est tel qu’il aspire toute sa récolte documentaire pour faire de cette confidence un nœud dramaturgique, le lieu d’où nait ce à quoi nous assistons ici et maintenant : la restitution de cette parole prise dans les mailles réparatrices du rite. Kenza Berrada se fond dans Houria, à moins que ce ne soit Houria qui se fonde dans Kenza, de même que toutes les victimes de viol qui traversent cette voix et ce corps intermédiaire, car dépositaire de témoignages qu’elle dépose ici même à nos pieds. Le secret, la honte, le fardeau sont pris en charge par la performeuse qui s’approprie, dans le même temps, un rituel masculin pour mieux le faire sien, renverser la donne et reprendre possession de ce dont les femmes sont dépouillées lorsqu’abusées : leur propre corps.
Assise sur sa chaise en plastique, Kenza Berrada est comme imprimée par la gestuelle et la voix d’Houria, le corps jamais tranquille, jamais au repos, jamais absent. Pris dans un mouvement permanent d’intranquillité, il déverse ce qui a été trop longtemps tu, et qui tue à petit feu, il se confesse et évacue l’indicible, il partage et donne de cet intime qui n’a jamais autant été politique. Le récit d’Houria nous happe, il échappe à tout pathos maladroit, à toute pitié facile, il trace un chemin, celui de la mémoire qui se met en marche, celui de l’identité qui se relève, et suit le rythme haché du dévoilement au compte-goutte. Tout ne sera pas exprimé d’un coup, mais le coup de grâce arrivera en décalé, et le silence de la salle qui fait bloc répond à la déflagration de la révélation. Entre-temps, Kenza Berrada aura parcouru son territoire dans un quatre-pattes inversé, tête rejetée en arrière, marchant dans son animalité première à l’envers, pour aller voir de l’autre côté, traverser le miroir de l’impossible et de l’impensable. Retournant la chaise comme pour mieux signifier ce renversement de posture, elle donne à entendre ce que rarement l’on entend : la voix de l’autre, de l’agresseur, la voix du danger et de l’oppresseur. Sans, pour autant, le stigmatiser, puisqu’à lui aussi, elle redonne corps et récit dans un moment confondant.
La performance s’achève dans l’énergie et la sorcellerie déployées d’une danse répétitive et ritualisée. Accumulant sur elle les peaux de mouton, Kenza Berrada disparaît sous les couches de fourrure, se bestialise et s’anonymise pour faire corps avec nous toutes, libérer le monstre et la souffrance en une transe féconde bouleversante, tandis que défile un texte d’une beauté folle qui achève de tailler en pièces la loi du silence et des convenances, sacrifie le passé sur l’autel de nos sororités nouvelles, et réconcilie oralité et organicité dans une forme engagée jusqu’à la moelle.
Marie Plantin – www.sceneweb.fr
Boujloud (l’homme aux peaux)
de et avec Kenza Berrada
Création sonore Kinda Hassan
Création vidéo Maud Neve
Création lumière Georgia Ben Brahim
Aide à la chorégraphie Elsa Wolliaston, Annabelle Chambon, Cédric Charron
Extraits de La Liberté de Guillaume Massart et Mettre la hache – Slam western sur l’inceste de Pattie O’Green
Regard extérieur Raphaël ChevènementProduction et diffusion Les Rencontres à l’échelle – Bancs Publics (Marseille) ; KUMQUAT | performing arts (Paris) (jusqu’en 2023)
Coproduction Institut Français du Maroc ; Goethe Institut du Maroc ; GMEM – Centre national de création musicale (Marseille) ; Domaine de Lorient – Saint-Péray ; Le Cube – Independant art room (Rabat, Maroc) ; ONU Femmes Maroc ; Atlas Electronic
Soutien Institut Français (Des mots à la scène, Paris) ; Arab Fund for Arts and Culture (AFAC)Durée : 1h
Vu en novembre 2024 au Théâtre de la Bastille, Paris
Théâtre de l’Odéon, Ateliers Berthier
les 11 et 12 octobre 2025Domaine d’O, Montpellier, dans le cadre de la Biennale des Arts de la Scène en Méditerranée
les 7 et 8 novembre


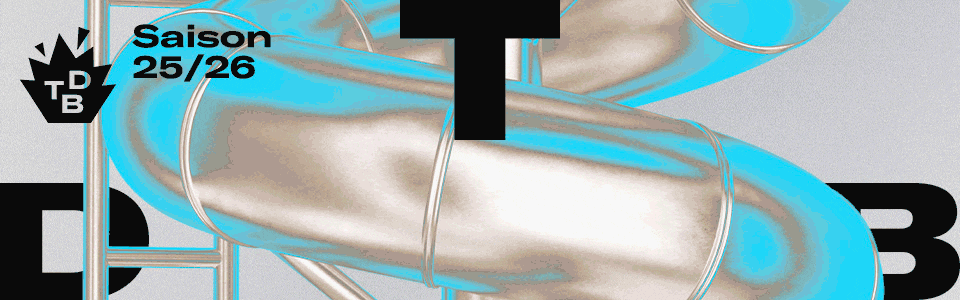


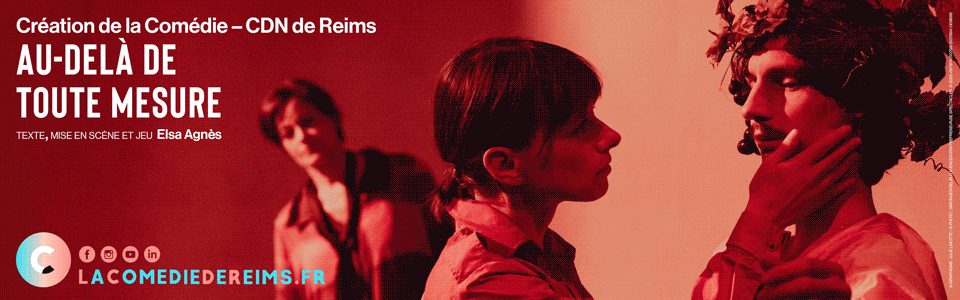
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !