Main dans la main avec le jeune auteur Marcos Caramés-Blanco, le metteur en scène Jonathan Mallard déroule la vie d’une maison où, entre ambiance nimbée d’étrangeté et dramaturgie en rhizome, les individus deviennent ce que les lieux font d’eux.
Emplir le plateau de fumée, de celles, épaisses, denses, lourdes, qui, une fois disséminées, transforment immédiatement la teneur de l’atmosphère. Loin d’une coquetterie scénographique ou d’une métaphore jouant avec le titre du spectacle, le premier geste de Bois brûlé, exécuté par une technicienne à vue (Romane Larivière), et non, comme il est désormais de coutume, par des machines automatisées, s’impose comme un outil dramaturgique que Jonathan Mallard utilise, au moins, à deux niveaux. D’abord, pour signaler aux spectatrices et spectateurs leur entrée dans un autre univers, flirtant, sans jamais y sauter à pieds joints, avec l’horreur et le paranormal, à la manière de ces brouillards fictionnels qui garnissent les forêts trop sombres ou entourent les bâtisses trop louches ; mais aussi pour instaurer un climat, tout à la fois inquiétant et intriguant, que le metteur en scène transforme en moteur central, puis progressivement essentiel, comme il avait si finement su le faire dans son tout premier spectacle, Les Îles singulières. Car pour mener à bon port cette adaptation du Sel de Jean-Baptiste del Amo, Jonathan Mallard s’était déjà appuyé sur un instrument scénographique, le vent, capable de mimer la tramontane sétoise, de faire virevolter les chemises blanches pendues à un fil, de diffuser la bonne odeur d’une ratatouille en train de mijoter, mais également, et peut-être surtout, de charrier avec lui les spectres qui hantaient les existences des membres d’une famille en voie d’archipélisation. Une histoire de fantômes, de transmission générationnelle inconsciente et de passage inéluctable du temps que le metteur en scène remet, telle une marotte, mais sous une autre facette, à nouveau sur le métier.
Cette fois, Jonathan Mallard ne s’est pas emparé d’une oeuvre pré-existante, mais a demandé à un jeune auteur, Marcos Caramés-Blanco – qui commence à avoir le vent en poupe, comme en témoigne sa double programmation dans quelques semaines à Théâtre Ouvert avec la reprise de Ix : Variations et la création de Ce qui m’a pris –, non pas de lui écrire un texte, mais d’entrer avec lui dans une collaboration au long cours pour aboutir à la création d’un spectacle. Conjuguant leurs univers respectifs, les deux artistes ont alors bâti l’histoire d’une maison, qui, plus qu’un simple cadre, constitue le coeur battant de Bois brûlé. Construite sur un terrain a priori hostile et reculé, que l’on devine, sans pouvoir le localiser précisément, à proximité immédiate de l’océan et d’une centrale nucléaire, cette bicoque est le fruit de l’imagination et du labeur d’une femme, Karlota, qui, en 1991, en entreprend seule l’édification. Du passé de cette ouvrière qui, au long des quatorze années qui défilent devant nos yeux, passe ses journées à l’usine et ses soirées dans son fauteuil, vissée devant une collection de séries américaines, d’Urgences à Buffy contre les vampires, en passant par Desperate Housewives, avec, toujours, un verre de vin à la main, ne transparaissent que très peu d’éléments. Y compris dans ses conversations avec son voisin JP, avec qui, au fil des saisons, elle noue une amitié, cette femme brute de décoffrage et dotée d’un réel franc-parler n’est pas franchement encline à la confidence. Isolée, recluse volontaire, elle semble tout autant contrariée par les étranges traces rouges qui apparaissent sur les murs de sa bâtisse que par la visite inopinée de sa fille qu’elle avait, sur le chemin de sa fuite, laissée à son père, et qui lui réclame désormais des comptes. Jusqu’au jour où, alors qu’elle vient de mettre la touche finale à sa maison et d’en achever le bardage en bois brûlé censé la protéger de l’humidité, elle décède. Trop subitement pour que cela semble logique.
Près de vingt ans plus tard, en 2023, c’est au tour de Sebastian d’investir les lieux. Compositeur de musiques de film, le jeune homme a quitté Paris, et son entourage bobo-queer, pour s’isoler dans cette demeure noire du bout du monde. À l’image de Derek Jarman, dont Marcos Caramés-Blanco et Jonathan Mallard se sont inspirés, l’artiste perd progressivement la vue – non pas à cause du Sida, mais d’un diabète qu’il refuse de soigner – et coupe un à un les maigres liens sociaux qui lui restent. Tandis qu’il se noie dans un projet de composition musicale pour un film d’horreur, qui ressemble de plus en plus à une arlésienne, il prend frénétiquement des notes sur son iPhone. Au long de la dizaine d’années passées entre les quatre murs d’une bicoque au jardin de plus en plus luxuriant, et envahissant, ces pensées retranscrites, que les visites épisodiques d’une électricienne ou de la maire du village ne parviennent que très brièvement à endiguer, apparaissent de plus en plus sombres quant à son avenir, et de plus en plus inquiètes quant à d’éventuelles présences dans la maison – où les traces rouges détectées par Karlota se sont transformées en fissures béantes. Un second chapitre auquel, une fois refermé, succède une troisième et dernière partie, beaucoup plus brève et sans doute d’autant plus confuse, où une équipe de tournage réalise, à l’intérieur de la maison vidée de ses habitants et réduite à un décor de cinéma, les scènes d’un film de genre qui, à mi-chemin entre le post-apocalyptique, l’horreur et le survivalisme, aboutirait, en 2082, à la destruction totale de la bâtisse.
Avec cette fresque s’étalant sur près de neuf décennies, au gré d’accélérations et d’ellipses temporelles rondement accomplies grâce à un ensemble de références culturelles, politiques et écologiques qui structurent et, en sous-main, nimbent l’intrigue, Marcos Caramés-Blanco, et c’est là toute la saveur de son texte, déjoue les attendus. Là où les personnages devraient se doter d’une épaisseur temporelle, d’un passé qui les structure autant que d’un avenir à bâtir, le dramaturge nous les donne à apprécier dans un hyper-présent, sans donner toutes les clefs de compréhension de leurs existences avant leur arrivée dans la maison – et il faut alors se résoudre à en rester à l’étape d’hypothèses plus ou moins vérifiables à leur sujet. Dès lors, c’est à ce lieu, et à bien lui, que le jeune auteur donne toute la place dramaturgique, en explorant, de façon peu commune, sa façon d’influer sur ceux qui l’habitent. Tandis que les deux époques dans lesquelles Karlota et Sebastian s’inscrivent ne s’invitent que par le biais de maigres trouées opérées par leurs quelques invités, la bâtisse, pensée à l’origine comme un refuge et un havre de paix, se transforme en lieu d’isolement et de repli, renforcé par le rapport étroit que les deux personnages entretiennent à la fiction. Bien qu’ils pensent avoir encore toutes les cartes entre les mains, ils sont comme matricés, conditionnés, par cet endroit qui les investit autant qu’ils l’ont investi. Pour renforcer cette impression, Marcos Caramés-Blanco développe une dramaturgie en rhizome qui, à la manière du mycélium – un champignon, comme celui qui colonise, et fait rougir, les murs de la maison –, multiplie les connexions souterraines et les résonances, et tisse une logique de transmission générationnelle inconsciente entre des individus qui, s’ils ne se connaissent pas, ont des murs, et donc un même cadre d’existence, en partage – et c’est ainsi que l’artiste, qui vient d’un milieu ouvrier, succède à l’ouvrière et laisse, à son tour, la place à une oeuvre.
Ce cheminement intellectuel qui, derrière sa fausse façade de série B, se révèle exigeant, riche et infiniment précis, Jonathan Mallard lui offre un cadre suffisamment sensible pour qu’il puisse se déployer. Grâce au travail conjoint d’Izumi Grisinger à la scénographie et de Rosemonde Arrambourg à la création lumières, il ne se départit jamais d’une ambiance entre chien et loup, où les contours des lieux, des espaces et des individus sont suffisamment flous pour que tout semble possible, à l’instar de cette maison dont seuls quelques-unes des plus grosses poutres de la charpente et deux modestes pans de murs sont matérialisés afin de laisser toute la place nécessaire à l’imaginaire des spectatrices et des spectateurs pour faire le reste – comme dans les meilleurs films d’horreur, où ce qui est masqué est souvent plus générateur d’effets que ce qui se déroule à vue. Surtout, dans sa direction d’actrices et d’acteur, épaulée par une subtile composition musicale, le metteur en scène instille une juste dose d’humanité qui rend, par l’entremise de Muranyi Kovacs et Raphaël Mars, Karlota et Sebastian infiniment profonds et attachants. Sous sa houlette, leurs fêlures deviennent, comme les fissures de la maison, bien visibles, et leurs blessures sources d’un protocole compassionnel d’autant plus fort qu’elles ne sont pas exposées en pleine lumière. Tant et si bien que, si cette demeure du bout du monde n’a pas constitué, pour eux, la planche de salut qu’ils espéraient – comme unique voie de (sur)vie sans doute possible –, elle offre, à leurs dépens, un espace réflexif stimulant pour penser à la façon dont les lieux nous habitent, et parfois nous hantent, autant que nous les habitons, et parfois les hantons.
Vincent Bouquet – www.sceneweb.fr
Bois brûlé
Texte Marcos Caramés-Blanco
Mise en scène Jonathan Mallard
Avec Muranyi Kovacs, Raphaël Mars, Julia Roche
Scénographie Izumi Grisinger
Création lumières Rosemonde Arrambourg
Composition musicale Raphaël Mars
Création son Louise Prieur
Création costumes Noé Quilichini
Régie générale, plateau Romane Larivière
Construction décor Ateliers de la Comédie de CaenProduction Comédie – CDN de Reims ; Compagnie DE LA LANDE
Coproduction Le Théâtre de Poche, Scène de territoire pour le théâtre Bretagne romantique et Val d’Ille-Aubigné ; Comédie de Caen – Centre dramatique national de Normandie ; L’Archipel, Pôle d’action culturelle Fouesnant-les Glénan
Avec le soutien de L’arc – Scène nationale du Creusot, du Théâtre l’Aire libre – Saint-Jacques-De-La-Lande, de la Chartreuse de Villeneuve-Lez-Avignon, du Théâtre de la Bastille, de la Fondation Jan Michalski pour l’écriture et la littérature et du Théâtre de Lorient – Centre dramatique national et de la DRAC Bretagne.Bois brûlé est lauréat de l’Aide nationale à la création de textes dramatiques d’Artcena, de la bourse mise en scène SACD-Beaumarchais 2025 et du Fonds Régnier pour la Création.
Durée : 2h
Comédie – CDN de Reims
du 10 au 17 décembre 2025L’Archipel, Pôle d’action culturelle de Fouesnant-les Glénan
le 15 janvier 2026Comédie de Caen – CDN de Normandie
les 25 et 26 mars





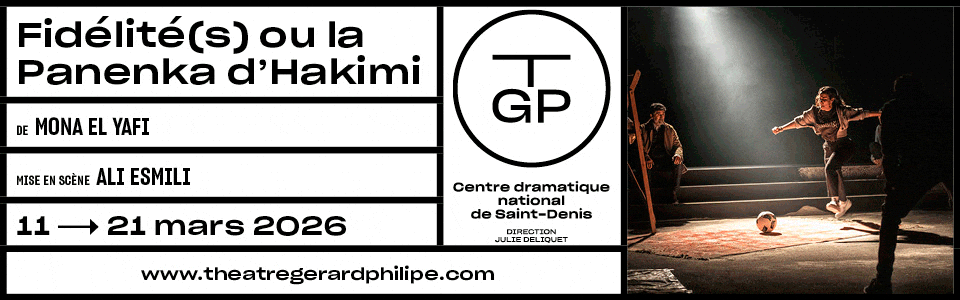








Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !