LAPAS (L’Association des Professionnels de l’Administration du Spectacle) dévoile des perspectives plus qu’inquiétantes pour la diffusion du spectacle vivant la saison prochaine. Tandis que le Festival Off d’Avignon bat son plein, et confirme chaque année son attraction grandissante, des représentants du secteur expliquent le paradoxe de son succès. La crise est profonde, financière et politique. Quelques pistes émergent.
Puisque le Festival Off d’Avignon n’en finit pas d’enfler année après année – plus de 1 700 spectacles en 2025, contre 1 600 l’an passé –, comment croire encore les discours d’un secteur du spectacle vivant qui, année après année, n’en finit pas d’alarmer sur la crise qu’il traverse ? Quand le plus grand marché de théâtre du monde, tel que le Off s’autoproclame, se porte si bien, comment expliquer ces chiffres en cascade qui soulignent l’assombrissement des perspectives ? Car une semaine après la diffusion par l’Observatoire des Politiques culturelles de son étude – qui montrait que la moitié des collectivités territoriales (départements et régions en tête) avait diminué leurs subventions à la culture –, c’est LAPAS qui publie pour la seconde année de suite une étude sur les perspectives de diffusion pour la saison à venir. Et ses résultats sont encore plus « noirs », pour reprendre le qualificatif employé par Véronique Felenbok, sa co-directrice : 25 % de réduction de diffusion, soit 48 % sur les deux dernières années, 18 % des compagnies qui envisagent de cesser leur activité, glissement de 4,6 à 3,7 personnes au plateau en moyenne. L’ensemble de l’étude va dans le même sens : l’activité s’effondre pour des raisons que l’on connaît bien : des lieux en difficulté avec l’inflation des charges fixes, comme le chauffage, par exemple, et les subventions qui diminuent via les collectivités territoriales.
« Cette crise est particulière », note cependant Éric Vanelle, du Syndicat National des Arts Vivants (SYNAVI). Car, dans un secteur où la crise financière est « a way of life », comme l’avaient souligné les économistes américains Baumol et Bowen il y a soixante ans déjà, elle est devenue plus politique que jamais. Les mesures drastiques de la présidente de la Région Pays de la Loire, Christelle Morançais, qui « a bâti son émergence nationale sur la suppression des subventions culturelles et est ainsi devenue vice-présidente d’un parti qui ambitionne de prendre le pouvoir – le parti Horizons d’Édouard Philippe », sont symptomatiques, selon Éric Vanelle, d’une rupture avec toute la philosophie qui sous-tendait les politiques culturelles depuis 1959 et la création d’un ministère des Affaires culturelles par André Malraux. Non seulement les collectivités territoriales sont en proie à une grave austérité budgétaire, mais, en plus, une petite musique se fait entendre de plus en plus nettement, venue de la droite extrême et de celle – LR (Les Républicains) – qui n’est pas censée l’être, qui remet en cause le rôle de la culture dans la cité. Les propos de la patronne de la Région Pays de la Loire, dénonçant un secteur « accroc aux subventions » incapable de générer ses propres ressources, en constituent l’un des plus éloquents symptômes, mais le programme du NFP des dernières législatives, où le volet culture tenait en cinq lignes, également, souligne Éric Vanelle.
« Si les compagnies pouvaient ne pas venir à Avignon, ce serait mieux »
À partir de là, comme interroge Véronique Felenbok : « Où les compagnies trouvent-elles l’argent pour créer ? ». Et bien, c’est la débrouille à tous les étages : réduction des marges à la vente, des équipes techniques, des salaires, des périodes de répétitions, des équipes artistiques… Et toutes ces mesures ont évidemment un coût social, dénué de tout accompagnement par l’État, qui n’a jamais encore été précisément évalué – cela représente, détaille le SYNAVI, 9 000 heures de travail perdues dans le département de l’Hérault, par exemple. Fonpeps, Spedidam et autres dispositifs de soutien, tels que le régime de l’intermittence, permettent de tenir encore la baraque, ainsi que le recours au mécénat par l’intermédiaire des crédits d’impôt qui fait toujours débat dans la profession, mais de nouvelles perspectives se dessinent. De plus en plus de compagnies ouvrent leurs propres lieux intermédiaires en milieu rural, relève Margot Quénéhervé du Syndicat des Entreprises du Spectacle Vivant Public (SYNDEAC), rejoignant ainsi le souhait d’Éric Vanelle d’investir tous ces lieux non utilisés – salles des fêtes, places, jardins et autres écoles désertées – qui fleurissent dans les territoires ruraux. Le tout nécessitant un soutien autrement structuré, poursuit-il, que le plan « Campings » du ministère de la Culture.
Mais, alors, comment s’explique ce paradoxe : si la situation financière se dégrade, pourquoi le Festival Off d’Avignon draine-t-il encore et toujours plus de compagnies et de spectacles ? « Parce qu’Avignon devient le festival des morts de faim », explique Véronique Felenbok, parlant de ces compagnies « qui tirent ainsi leur dernière cartouche en se payant et en se logeant mal ». Tout simplement parce que les programmateurs, eux aussi, se déplacent de moins en moins – réductions de budgets obligent – et qu’Avignon devient donc de plus en plus – puisque les longues séries se raréfient – la seule occasion de jouer vingt fois de suite. Pourtant, selon Éric Vanelle, 80 % des compagnies n’auront vendu qu’entre zéro et cinq dates à Avignon. Pas de quoi rembourser les frais investis. Mais le Off répond aussi au désir, au plaisir pour les artistes de jouer, de tout simplement faire leur métier. Martin Loizillon de la Scène Indépendante rappelle que l’accompagnement des jeunes artistes s’est considérablement développé ces dernières années avec un élargissement de l’offre de formation à des institutions nationales et régionales labellisées. L’offre de spectacles ne peut donc qu’augmenter. Avignon devient ainsi l’ultime refuge quand les possibilités d’émerger par ailleurs se réduisent. « Si les compagnies pouvaient ne pas venir, ce serait mieux », assume Éric Vanelle. « Mais, comme cela fait trois ans qu’elles puisent dans leurs réserves, ce système atteindra bientôt ses limites », conclut Margot Quénéhervé.
Eric Demey – www.sceneweb.fr
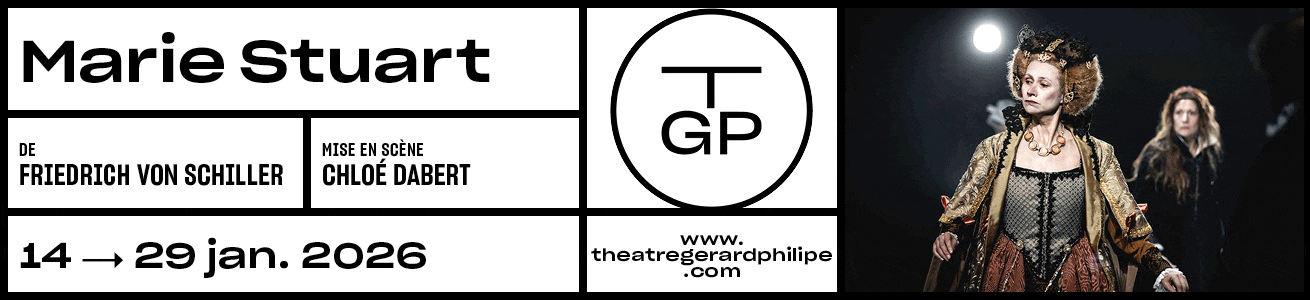

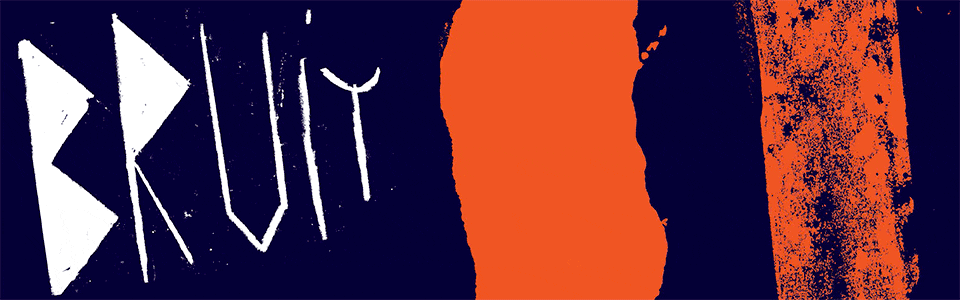


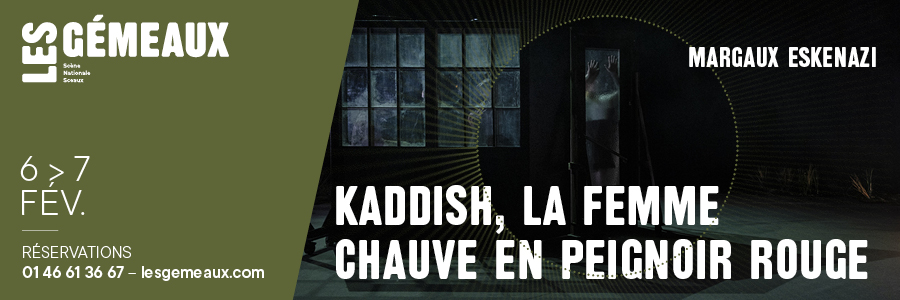







Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !