A 24 ans, l’auteur et comédien prend la direction des Déchargeurs. Il revient sur son parcours, hors des sentiers battus, et sur ses ambitions pour ce théâtre en plein coeur de Paris.
Être à la tête d’un théâtre comme Les Déchargeurs à 24 ans n’a rien de banal. Y étiez-vous prédestiné ?
Adrien Grassard : Pas vraiment ! J’ai passé ma jeunesse à La Rochelle, où j’étais assez cancre à l’école, un peu paumé et en délicatesse avec les cours de Français. Et puis, un jour, je suis tombé sur un cours de théâtre amateur, piloté par Sophie Apréa. Dès le premier cours, j’ai adoré et me suis senti vivre comme rarement grâce à la découverte de la relation qu’on peut avoir avec le public. De fil en aiguille, je me suis laissé embarquer dans la construction d’un spectacle, une réécriture de La Famille Addams où je jouais le rôle d’Oncle Fétide. Je suis resté trois ans là-bas avant de me poser la question de la professionnalisation.
A l’époque, je ne connaissais rien au monde du théâtre, à part le Cours Florent. Je me suis donc inscrit à un stage d’accès et y suis resté trois ans. Là-bas, j’ai rencontré beaucoup de gens et ai pris goût à l’écriture. J’ai commencé à composer ma première pièce, Enquête d’amour, une grosse comédie, un défouloir de jeunes, que les profs nous ont poussés à sortir. C’était un match-up absurde où se croisaient Hamlet, Lucrèce Borgia, Vladimir et Estragon, tous immergés dans le monde actuel. En tout, nous l’avons jouée une vingtaine de fois au Bouffon Théâtre et cela a bien pris.
Vous étiez, alors, sur de bons rails…
Sauf qu’à la sortie du Cours Florent, ce fut le vide intersidéral. Heureusement, j’avais une idée d’écriture, ou plutôt de réécriture contemporaine de Joconde, l’un des premiers textes – un conte sexuel – de La Fontaine. C’était une folie de sortie d’école, mise en scène par Lucie Cinquini, avec neuf comédiens au plateau. Finalement, nous avons pu le jouer une trentaine de fois, dont vingt-cinq fois au Funambule Montmartre et cinq fois au Montmartre Galabru. J’ai également rejoint la compagnie Les Joues Rouges qui, à l’époque, travaillait sur L’Ecume des Jours de Boris Vian. Ce fut l’une des expériences les plus importantes de mon parcours. J’ai pu découvrir que, comme Vian, je faisais de la pataphysique [« la science des solutions imaginaires », selon son inventeur, Alfred Jarry, NDLR] sans le savoir.
En parallèle, vous avez également créé un podcast, Noircir, diffusé sur Facebook et Instagram…
J’ai commencé six mois avant le début du premier confinement. Au départ, l’idée était d’ouvrir un cahier d’écrivain, avec une poésie par semaine, d’abord en vers libres, puis en alexandrins. Comme je suis passionné par les biographes et les cahiers d’auteur, je voulais que tout le monde puisse voir, et entendre, l’avancée de l’écriture, qui est souvent dissimulée dans le processus créatif. Avec le confinement, cela a pris d’un coup et presque 2.000 personnes me suivent désormais régulièrement.
Finalement, et contrairement à tant d’autres, le confinement vous aurait-il profité ?
J’ai aussi poursuivi mon travail sur Pinocchio et sur Anima, une création masquée en alexandrins. Sauf que tout est en pause aujourd’hui… Alors, j’ai traversé une période désertique, sans revenus, ni intermittence. C’est à ce moment-là que j’ai vu une annonce pour la vente des Déchargeurs. J’ai alors pris le temps de réfléchir et me suis dit que rendre un tel théâtre accessible à l’émergence aurait du sens. Aujourd’hui, les compagnies émergentes ont un vrai problème pour accéder à la scène car, la plupart du temps, on leur demande de payer pour jouer.
Pourquoi avoir jeté votre dévolu sur Les Déchargeurs en particulier ?
D’abord car c’est un théâtre qui défend le mot, les auteurs, un théâtre de poètes qui me parlait ; ensuite car j’ai eu un gros coup de coeur pendant la visite. Ce lieu a une âme, notamment grâce à un labyrinthe de caves présent sous la cour et qui renferme une petite salle. A partir de là, je me suis dit : « Je me vois bien tenir ça, mais comment on fait lorsqu’on a 24 ans et pas un sou ? ». J’ai donc pris contact avec les équipes du théâtre et on a tous ensemble monté un business plan avec une seule condition : les compagnies ne doivent pas payer pour jouer.
Un tel business plan a-t-il suffi pour convaincre les banques de vous accorder un crédit, surtout dans un tel contexte ?
Quand je suis arrivé, le banquier a rigolé, puis nous a demandé de retravailler le business plan. Grâce à l’aide de ma famille pour la gestion financière, indispensable pour partir sur des bases saines, je suis revenu avec des arguments de poids, la proposition de quelque chose de neuf, dans un contexte qui ne peut que s’améliorer, voire qui va bénéficier d’une hausse de la demande, fondée sur le besoin de sociabilité que les spectateurs vont éprouver. En tout, les négociations ont durée 7-8 mois et, du côté d’Elisabeth Bouchaud [l’ancienne propriétaire des Déchargeurs, NDLR], ça a été très vite aussi. Mon projet lui plaisait et elle n’avait pas envie que le repreneur potentiel fasse n’importe quoi avec le lieu. Finalement, nous avons signé le compromis de vente en décembre 2020 et la cession a eu lieu le 12 février 2020.
Quel projet avez-vous pour ce lieu dont l’identité fut parfois un peu floue ?
Le mot d’ordre est l’ouverture, même si je ne veux pas faire des Déchargeurs un nid douillet pour l’émergence. Nous allons donc accueillir, à la fois, des artistes émergents, mais aussi des personnes plus expérimentées, comme Pierre Notte. Nous voulons que les uns et les autres se croisent et jouent en parallèle. Nous souhaitons aussi faire des Déchargeurs un lieu de vie où l’on ne vient pas forcément et uniquement pour voir du théâtre, grâce à des expositions, des conférences et des bords de plateau qui serviront à ouvrir le débat et à être pluri-disciplinaire à la manière d’une scène nationale. J’admire, par exemple, le travail qu’Ariane Mnouchkine a pu mener à La Cartoucherie pour en faire un lieu de sociabilité.
Aux Déchargeurs, le théâtre sera une base de discussions. On ne viendra pas simplement pour consommer une pièce de théâtre, mais pour passer une journée avec un repas, dans une vraie ambiance d’agora, ce qui est rare, surtout en plein coeur de Paris. Pour nous, les autres théâtres ne seront pas des concurrents, mais des partenaires potentiels. Nous sommes déjà entrés en contact avec une dizaine de théâtres, comme La Flèche, le Théâtre de Belleville, le Paris-Villette ou le Lavoir Moderne, pour nouer des partenariats et imaginer des échanges de visibilité, histoire de se serrer les coudes.
Comment comptez-vous tenir le choc économique ?
J’essaie d’avancer avec humilité, en trouvant des solutions pas à pas, au cas par cas. Après la période du Covid, il y aura forcément un embouteillage qui sera négatif pour les compagnies émergentes. Pour autant, nous avons décidé de ne pas mettre en place de minimum garanti car le théâtre doit être pleinement engagé à leur côté, y compris financièrement. Les recettes seront, dans un premier temps, partagées selon un ratio 60/40, et peut-être 50/50 ensuite. Nous avons aussi fait une demande de subventions, mais nous n’y croyons pas trop. Nous souhaitons vraiment accompagner les spectacles que nous programmons, faire venir des professionnels, de la presse, grâce à des produits d’appel plus confirmés. Nous leur proposerons également un plan médias très accessible, avec un attaché de presse et des encarts publicitaires.
Sur le plan purement économique, il faut trouver des astuces. Nous programmerons en moyenne quatre pièces par mois, mais il est certain que, si elles ne fonctionnent pas, on meurt. Alors, nous avons remis en état les caves pour débloquer deux lieux de stockage de décor, un atelier de construction et une salle de répétitions qui seront tous ouverts à la location. Le bar devrait représenter 60% de notre chiffre d’affaires, grâce au laps de temps que nous laisserons entre les pièces pour que les spectateurs aient le temps de boire un verre dans un hall réagencé.
Qu’allez-vous faire de l’héritage des Déchargeurs ?
Ludovic Michel lui a donné l’image d’un théâtre public et ainsi pu faire venir des spectacles issus du théâtre public, mais il est, à mon sens, resté sur quelque chose d’un peu vieillot que nous allons dépoussiérer. On ne veut pas garder que les fantômes des Déchargeurs, mais y ramener de la jeunesse, grâce à l’émergence. Dans le salle du haut, nous programmerons des projets d’une certaine envergure et plus seulement du théâtre et des seuls-en-scène. La salle du bas, quant à elle, était réservée à la poésie, mais on y disait seulement des vieux textes. Désormais, y résonneront de nouvelles formes, comme du rap, du slam, de la musique actuelle. Ce format intermédiaire de salle, d’une vingtaine de places, entre le piano-bar et la grosse scène, est assez rare et nous avons déjà beaucoup de demandes.
Nous voulons aussi remettre plus d’humain dans les contacts entre le théâtre et les compagnies. Au lieu de simplement déposer un dossier, les artistes peuvent venir nous voir, tous les lundis de mars, entre 10h et 13h, pour nous raconter leur projet pendant cinq à dix minutes. Cela nous permet de voir les gens, d’analyser leur façon de pitcher leur dossier et de ne le regarder qu’ensuite. Cette méthode plus humaine fera, un jour, peut-être école… dans le monde d’après.
Propos recueillis par Vincent Bouquet – www.sceneweb.fr
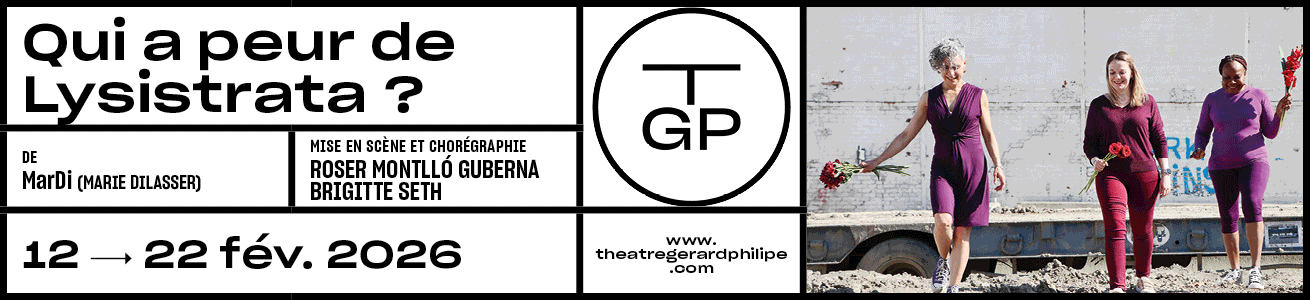






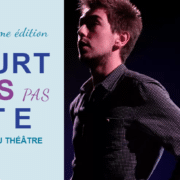






Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !