
Vert territoire Bleu, par Marion Lévêque. Photo Joseph Banderet
Dans le village d’Alloue, en Charente, Johanna Silberstein et Matthieu Roy ont dévoilé quatre créations initiées à la Maison Maria Casarès qu’ils dirigent depuis 2017. Autant de spectacles prometteurs, réalisés par de jeunes artistes qui devraient s’imposer dans le paysage théâtral ces prochaines années.
Johanna Silberstein et Matthieu Roy, le jeune couple de directeurs de la Maison Maria Casarès, située dans le village d’Alloue (en Charente) cultivent un théâtre bio. Ou, plus précisément, un théâtre créé selon les principes de l’agriculture raisonnée. La programmation est pensée selon le rythme des saisons. Le printemps est dédié à l’éclosion des talents (« les jeunes pousses ») : des artistes tout juste sortis d’école (sélectionnés sur dossier puis auditionnés par un comité réuni autour des directeurs) profitent d’une résidence de quelques semaines pour monter un projet professionnel ; leur premier. L’été s’y déroule un festival, on y vient voir des spectacles en famille, en sirotant du rosé et en goûtant la gastronomie locale. L’automne, à leur tour, des d’artistes confirmés travaillent de nouvelles pièces jusqu’à l’hiver, le temps du repos. Et ainsi de suite. Assumée, la métaphore est efficiente, bien trouvée…
Et dans l’air du temps. Nous voilà donc sous un soleil automnal radieux, le lundi 19 septembre, en présence d’une armada de programmateurs de France et de Navarre venus découvrir la sortie de résidence de quatre projets « jeunes pousses » 2022 (pour la première fois, ces derniers présentent leur création aboutie, et non pas leur simple maquette). L’invitation, proposée par l’Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine, se refuse difficilement. Chacun y trouve l’occasion d’y repérer les talents de demain dans un cadre idyllique (bordé par un bras de la Charente, le domaine de plusieurs hectares est idéalement situé hors du temps), de discuter de l’avenir du spectacle vivant sous des pommiers face à des tortillas « façon Casarès » et de visiter la maison où demeurent les fantômes de l’actrice exilée et de son amant Albert Camus disparu en 1960. Rien à dire, Johanna Silberstein et Matthieu Roy savent recevoir et mettre en valeur leur site labellisé « centre culturel de rencontre ».
Place aux quatre spectacles, étonnements éclectiques, où seule la noirceur des propos artistiques s’impose comme le dénominateur d’une journée conçue comme un marathon théâtral. Une question d’actualité (sûrement), une question de génération (peut-être) ; quoi qu’il en soit le monde anxiogène dépeint dans le théâtre, détonnait avec la douceur de la campagne charentaise. Vert territoire bleu, la première pièce, signée Gwendoline Soublin et mise en scène par Marion Lévêque (une Pictave formée à l’ENSATT) raconte le sort de deux ados après une catastrophe nucléaire. Elle s’appelle N. Il se prénomme K. Ensemble, ils fuient un monde agonisant, fascisant, pour inventer autre chose. Essayer de s’aimer. Essayer de concevoir un bébé, pourquoi pas. Essayer, également, de dialoguer avec l’homme fossilisé (pas tout à fait vivant, pas tout à fait mort) assis dans la maison où le couple déboussolé a pris ses quartiers. Excessivement balisée par les codes de la dystopie (on pense beaucoup aux Combattants, le premier film de Thomas Cailley sorti en 2014), la pièce souffre de ses nombreuses références. Mais la recherche linguistique (une novlangue qui résonne comme un argot célinien un peu old school) est intéressante et la direction d’acteurs (Lauriane Mitchell et Yoann Jouneau) est aussi délicate que prometteuse. Pas mal pour un premier spectacle. Marion Lévêque devrait faire parler d’elle dans les années à venir. Prenons-en le pari. Espérons-le.
La suite est un spectacle à la lisière du théâtre d’ombre, de la marionnette et du dessin animé : Eugen. Une pièce singulière, écrite par un Allemand, Tankred Dorst (1925 – 2017), mise en scène (et traduite) par Youn le Guern-Herry. Apparaît sur le plateau, puis essentiellement derrière un voile translucide (animé par Rose Guillon et Élise Rale), le cousin germanique du Petit Prince. Comme dans le conte de Saint-Exupéry, un héros décoiffé à tendance post-socratique se lance dans un parcours initiatique. Sans mièvrerie aucune, les artistes nous présentent un monde où les marginaux trouvent difficilement leur place. On apprécie les inventions visuelles. On est saisi par la tonalité mélancolique du propos. On déplore un problème de rythme et quelques longueurs… Peut-être aurait-il fallu davantage s’affranchir de la trame narrative pour faire surgir l’essence spectaculaire du texte… Qui sait ? Youn le Guern-Herry et les siens ont tout de même la matière pour faire une belle œuvre.
Chantre de l’autofiction, auteur d’une œuvre photographique considérable, Hervé Guibert est actuellement redécouvert par les nouvelles générations. C’est le cas du metteur en scène Arnaud Vrech formé à l’École du Nord. Il porte au plateau À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie où l’auteur culte évoque le virus du Sida (dont il fut victime), le figure de Michel Foucault (dont il fut l’amant) et la question de la trahison (qui l’obsédait). Sur scène, la pièce s’impose contemporaine (elle aurait sa place dans la petite salle de la Colline). L’écriture tortueuse de Guibert détonne avec le style minimaliste de Vrech. L’ensemble est un peu confus (les jeunes artistes n’ont pas choisi le roman le plus facile à adapter), mais on y découvre trois excellents comédiens – Clément Durand, Cécilia Steiner et Johann Weber – qui imposent leur présence magnétique au plateau. Les spectateurs hypocondriaques (dont nous sommes) devraient avoir le droit de passer le lendemain de la représentation au lit.
Last but not least : Les Nuits blanches de Dostoïevski par Mathias Zakhar, un autre diplômé de l’École du Nord, décidément. C’est l’histoire d’une rencontre entre un jeune homme et une jeune femme sur un pont. C’est un texte magnifique (que nous n’avions jamais lu) où l’âme russe est rudement mise à l’épreuve. Et c’est une pièce éprouvante, qui aurait sûrement mérité d’être remontée dans la programmation (mais peut-être que le dispositif bi-frontal l’en empêchait). Quoi qu’il en soit, Mathias Zakhar a choisi d’amplifier l’intensité des sentiments de ses protagonistes. Pour le meilleur (les deux acteurs, Anne Duverneuil et Charlie Fabert sont époustouflants) et pour le pire (la deuxième moitié de la pièce, vociférée, est épuisante). La vidéo, aussi, est un brin datée et chichiteuse. Le spectacle proposé a besoin de mûrir. À moins que ce soit à nous, « vieille branche », de rajeunir… Tout de même, si Mathias Zakhar peine à orchestrer ses deux voix (hyper puissantes), on ne peut lui enlever l’inventivité de sa mise en scène quasi-chorégraphique. Avec un banc et un couloir, il fait advenir le désir, l’immensité d’une ville et l’ambivalence des sentiments de deux (ou plutôt trois) amants. Place maintenant au temps. Ou plutôt à celui des saisons. Ces jeunes pousses sont prometteuses.
Igor Hansen-Løve – Sceneweb.fr


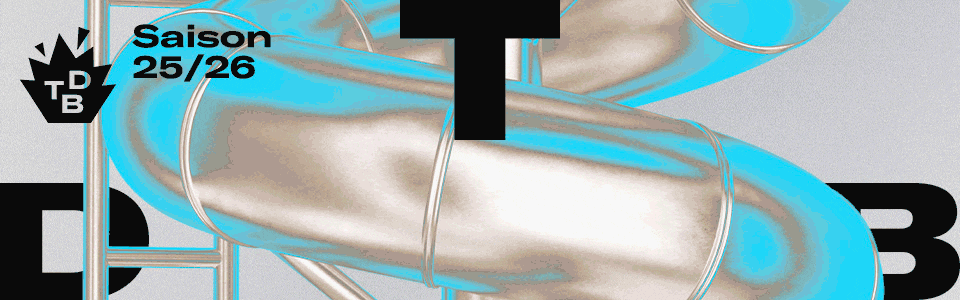

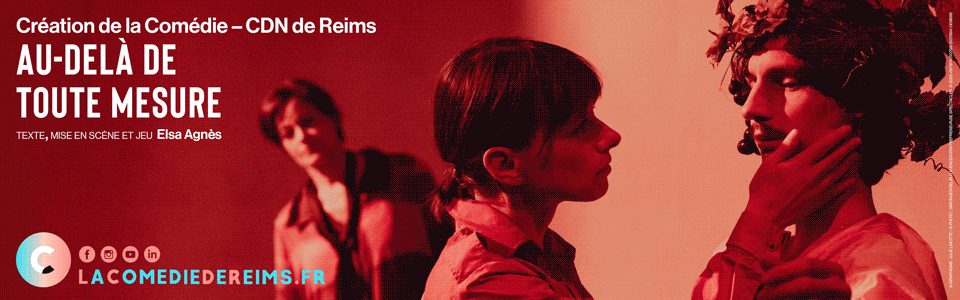








Je crois que Foucault était plutôt le voisin de Guibert !