Passionné par le cinéma de Maurice Pialat, Laurent Ziserman l’a étudié en profondeur. Il a concentré ses efforts sur À nos amours (1983), film charnière dans la carrière du réalisateur, à partir duquel il conçoit son spectacle ANA, créé au Théâtre des Célestins à Lyon. À l’évidence très riche, portée par une belle distribution, sa recherche l’empêche d’atteindre à l’une des grandes qualités du cinéma de Pialat : sa sauvagerie, sa cruauté.
Premier grand succès public de Maurice Pialat, À nos amours a notamment marqué les esprits par la découverte d’une actrice : Sandrine Bonnaire. Non que celle-ci soit alors tout à fait inconnue : apparue dans La Boum (1980) de Claude Pinoteau en tant que figurante, retrouvée dans Les Sous-doués en vacances (1982) de Claude Zidi où elle apparaît discrètement, elle est jusque-là associée à un cinéma léger, adolescent. Avec le rôle de Suzanne, 15 ans, Pialat la fait entrer dans un autre registre. Et surtout, il la place au cœur de l’écran. Sans lui faire tout à fait quitter la légèreté que dégage son physique doux, tout en rondeurs d’où l’enfance semble prête à refaire surface à tout moment, le réalisateur lui confie une partition beaucoup plus complexe, où si joie et désinvolture il y a, c’est souvent pour masquer ou faire taire un mal-être, une mélancolie dont plusieurs causes nous sont suggérées tout au long du film, sans jamais être présentées comme certaines.
Ce n’est toutefois pas ce que le metteur en scène Laurent Ziserman, dont l’entrée dans l’âge adulte est marquée par le cinéma de Pialat – il raconte dans le dossier d’ANA qu’il connaît son premier grand émoi cinématographique à 18 ans avec Loulou, le film qui précède À nos amours – retient le plus de À nos amours. « Je gardais notamment en mémoire la violence, l’intensité, la vérité des scènes de famille. Leur puissance et leur beauté. Leur force dramatique. Le père, la mère, le frère, la sœur. Les repas. L’appartement (…) », explique-t-il. C’est avec ces souvenirs qu’il se lance dans l’écriture d’ANA, où il confie le rôle de Suzanne à Savannah Rol, celui de la mère à Magali Bonat et du frère à Benoît Martin, tandis que lui-même incarne le père, comme le faisait Pialat dans son film. En entrant sur scène munie d’une lampe torche, qui révèle une scénographie dont l’hésitation entre salon et atelier rappelle le décor de À nos amours, Savannah Rol affiche d’emblée sa distance par rapport à Sandrine Bonnaire et au personnage de Suzanne.
Plus qu’une adaptation de l’œuvre de Pialat, ANA est une pièce « sur les traces de ». Cela davantage qu’une pièce « à partir de », comme le prétend Laurent Ziserman. Si Savannah Rol incarne une Suzanne, c’en est une qui semble toujours dans l’état où elle nous apparaît pour la première : à la recherche de quelque chose. D’un temps perdu sans doute, et de ce qu’y était son homonyme chez Pialat, dont elle reprend bien des répliques, dont elle reproduit bien des gestes mais pas dans le même ordre. Pas non plus avec la même intensité. Cette Suzanne-là, comme les trois personnages qui l’entourent, sont beaucoup plus cérébraux, moins débordants que ceux de À nos amours. Comme si le passage du cinéma au théâtre nécessitait d’atténuer l’émotion au profit de la pensée.
Cette pensée est nourrie d’une recherche en profondeur, menée notamment avec des collaborateurs et des proches de Maurice Pialat. Laurent Ziserman raconte en effet avoir rencontré la scénariste Arlette Langmann et le comédien Christophe Odent qui joue dans le film. Il dit s’être fait accompagner sur la question des droits par la productrice Sylvie Pialat et dans la dramaturgie par le chercheur en cinéma Rémi Fontanel et le monteur de Pialat Yann Dedet. Cette démarche peine toutefois à s’incarner au plateau d’une manière très convaincante. En resserrant l’intrigue autour de la famille, et en plaçant en hors-champ les histoires sentimentales de Suzanne – elles sont traitées par l’image, alors que tout le reste l’est au plateau –, le metteur en scène renonce à une partie du trouble, de la complexité d’À nos amours. La perte n’est pas compensée, au contraire, par la pensée sur l’art que Laurent Ziserman met dans la bouche de ses protagonistes. Non que cette réflexion soit tout à fait absente du film : on sait que le frère souhaite devenir écrivain, que Suzanne fait du théâtre, mais cela n’est présent qu’à la marge dans les dialogues. C’est dans le corps que s’exprime d’abord l’intelligence des femmes et des hommes de Pialat, dans leur façon de marcher, de faire l’amour, de crier.
Dans ANA, le frère de Suzanne n’est plus aspirant écrivain mais réalisateur en herbe. Tandis que sa sœur et sa mère se déchirent, lui tente de reconstituer le quotidien du foyer du temps où son père était en vie – cette mort du père est l’une des preuves de l’utilisation par Laurent Ziserman d’un scénario antérieur à celui qui a été tourné : Les filles du faubourg d’Arlette Langmann. Les scènes de famille qui se succèdent, et pour certaines se rejouent plusieurs fois sous la forme de variations, sont ainsi toujours présentées avec une certaine distance, accompagnées d’une intention parfois très visible de faire représentation. Nourries par des propos de Maurice Pialat, les discussions père-fils sur les mérites respectifs du cinéma et de la peinture occupent dans ANA une place si importante qu’elles affaiblissent la relation père-fille centrale dans À nos amours, et beaucoup plus singulière. À force de trop montrer qu’il pense, ANA passe à côté de l’essentiel chez Pialat, la sensation.
Anaïs Heluin – www.sceneweb.fr
ANA
Adaptation : Marion Pellissier, Laurent Ziserman
Scénographie : Emmanuel Clolus
Son : Alain Lamarche
Lumière : Mathias Roche
Vidéo : Florian Bardet
Conseil dramaturgique : Yann Dedet, Rémi Fontanel
Travail musique et voix : Élise Caron, Myriam Djemour
Travail du corps : Julien Scholl
Construction et régie générale : François Dodet
Comédiens film Vincent : Anne Alvaro, Yann Boudaud, Camille Dagen, Axel Giudicelli Comédiens vidéos : Émile Bailly, Laure Barida et les élèves du lycée Saint-Exupéry
Voix off : Émile Bailly, Emmanuel Clolus, Luca Fiorello, Bernard Gaulin
Œuvres graphiques : Amicie d’Aboville
Production : Compagnie Panier-Piano
Direction de production : Pauline Barascou – La Table Verte Productions
Coproduction : Célestins – Théâtre de Lyon, Théâtre national de la Criée – Marseille, Théâtre du Bois de l’Aune – Aix-en-ProvenceSpectacle soutenu par l’ADAMI, la SPEDIDAM, la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville de Lyon
Avec l’aide du Théâtre de l’Aquarium – Vincennes, du Théâtre de l’Oulle – Avignon, de la Fédération – compagnie Philippe Delaigue
Merci à Arlette Langmann et Sylvie Pialat ; Stanley Woodward et Pierre Girerd ; La Cinéfabrique, KomplexKapharnaüm, Cie Chiloé-Friche Lamartine, ENSATT, TNP (résidences), Isabelle Truc-Mien et sa classe de 1ère spécialité théâtre du lycée Saint-Exupéry de Lyon
Diffusion : Jean-Luc Weinich – Bureau RustineDurée : 1h30
Théâtre des Célestins – Lyon
Du 17 au 27 mars 2022
Théâtre du Bois de l’Aune – Aix-en-Provence
Les 29 et 30 mars 2022
La Criée – Théâtre National de Marseille
Du 5 au 7 avril 2022
Théâtre Molière, Scène nationale archipel de Thau
Le 22 avril 2022





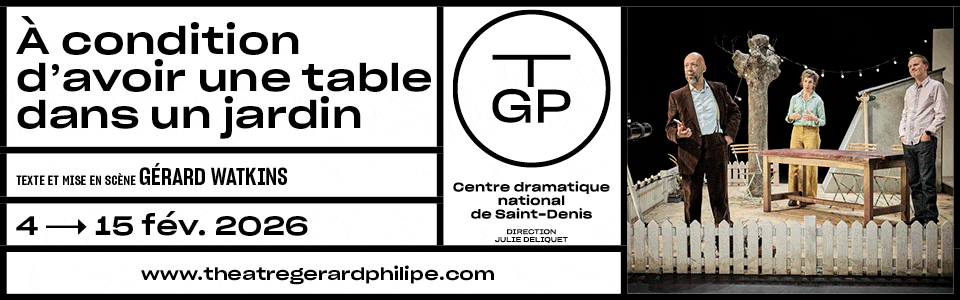








Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !