Habituée du Kunstenfestivaldesarts, l’autrice et metteuse en scène Léa Drouet poursuit un travail fascinant à la frontière de la performance et des arts plastiques, intégrant une dimension chorégraphique et musicale à son positionnement militant dans un geste qui tend à « rapprocher les séparés ». Portrait d’un esprit libre qui a fait de l’exclusion subie dans l’enfance son moteur et s’attache aux marges pour en faire le centre de ses préoccupations.
Cheveux coupés courts, silhouette androgyne, profil d’oiseau et regard vert clair, il se dégage de sa présence une mélancolie légère et une infinie douceur. C’est au Théâtre de la Bastille, où elle présente un spectacle rescapé du Covid, qu’on la rencontre un matin clair. Léa Drouet y joue Violences, seule en scène bouleversant qui jamais n’attise les émotions, mais, au contraire, en se situant en retrait de toute incarnation, les laisse affleurer sans rien forcer et libère une charge politique qui vient s’inscrire au cœur même de la narration, ces récits enchâssés de parentalité, de fuite, de danger, de migration. À la frontière entre le conte, le théâtre documentaire et l’autofiction, entre la performance et l’installation, entre le corps, le verbe et le son, Violences est une expérience sensible rare et fine qui glisse sans arrêt d’un lieu à un autre, avance à son rythme en creusant son sillon, fait confiance au silence et au public, et laisse une trace pénétrante qui se prolonge longtemps au-delà de la représentation. Violences reflète aujourd’hui la démarche de son autrice et interprète, fruit d’un chemin de maturation et de recherches, de rencontres phares et de militantisme.
Première étape : le compagnonnage et l’INSAS
Léa Drouet grandit au cœur d’un quartier populaire de Villeurbanne, entre une mère assistante sociale et un père violoncelliste, dans une famille marquée par des valeurs de gauche, héritées de ses grands-parents communistes installés à Paris. Très jeune, elle entreprend un compagnonnage avec la compagnie Les Trois-Huit, mais c’est un stage avec Adeline Rosenstein qui décidera de la suite car, avec elle, « le monde s’ouvre et se renverse ». L’apprentie comédienne suit la metteuse en scène à Bruxelles afin de participer à l’un de ses projets qui marque le début d’une collaboration toujours en cours ; puis, elle entre à l’INSAS (Institut national supérieur des arts du spectacle et des techniques de diffusion) en section mise en scène. « À ce moment-là, en tant que comédienne, j’avais toujours un petit caillou dans ma chaussure, confie-t-elle, il fallait que je sois d’accord avec tout ce que je disais ». Déjà, se pose la double question de « pourquoi on fait les choses et pourquoi on les raconte ».
À cette époque, Léa Drouet fréquente les milieux alternatifs, tend à s’éloigner du registre théâtral et à aiguiser un vocabulaire lié à la musique et à l’espace. En quête d’une esthétique propre et imprégnée par son engagement militant, elle organise les différentes dimensions du spectacle de manière horizontale et sans prédominance, ni du texte ni du corps. La lumière et le son y ont une place équivalente et ses premières créations défient les cadres traditionnels du théâtre. Derailment (2015) se joue dans une gare tard dans la nuit, dans une situation de concert noïse ; Mais dans les lieux du péril croit aussi ce qui sauve (2016) est une performance dans un skatepark qui met en acte la prise de risque et invite des skateurs à franchir un cercle de feu avec le souci de ne coloniser ni leur territoire ni leur pratique, mais de partager avec eux les moyens d’une occupation à leur façon ; quant à Boundary Games (2018), il transforme le plateau en laboratoire expérimental où gestes et déplacements interrogent sans un mot nos frontières et la notion de groupe. La réconciliation avec le texte viendra après grâce à une rencontre déterminante.
Deuxième virage : la collaboration avec Camille Louis et l’école expérimentale
Elles se sont rencontrées à un colloque et ne se sont plus quittées. Camille Louis est philosophe, dramaturge et activiste et leurs champs d’indignations et d’engagements se recoupent totalement. « Camille m’a renvoyé ma pensée, que je croyais désordonnée, de façon plus articulée, elle a donné de la valeur à mes intuitions », souligne Léa Drouet. Le dialogue avec elle est constitutif de la direction que prend son travail depuis 2016 au sein de VAISSEAU, la structure de production qu’elle a créée en 2014. Ensemble, elles imaginent en binôme une école expérimentale, projet aussi utopique que concret, surgi de leurs préoccupations communes.
Agacées par le jeu sémantique des groupes de public dit « cibles », convaincues que le savoir n’appartient pas qu’aux sachants et qu’il peut se transmettre sans outils pédagogiques préalablement acquis, portées par l’envie de partager leurs périodes de rencontres et de recherches en amont de la création, elles ont imaginé un dispositif horizontal d’échanges de savoirs où, en lien avec les thématiques brassées autour du projet artistique en cours, elles convient public ou associations à devenir, le temps d’un week-end réparti en trois phases (cours, atelier et retour d’expérience) leurs professeurs. « L’idée est de créer des cadres de renversement, de passer du rapport hiérarchique communément admis dans la transmission de savoir à l’égalité radicale », précise Léa Drouet.
L’avenir : à l’horizon 2026
Les prochaines classes de l’École Expérimentale s’inscrivent dans le cycle « Art, soin et citoyenneté » initié par le Théâtre National Wallonie-Bruxelles et se tiendront au Centre d’Art Maison Gertrude, nouvel espace fondé par Mohamed El Khatib dans la capitale belge, dédié à la rencontre entre pratiques artistiques et milieux du soin. Car sa prochaine création, Rodéo, part de la question de l’inflammation et du brouillard mental comme symptômes d’un organisme malade, en surchauffe de défenses immunitaires, et applique son enquête à la cellule familiale en tant que vase clos et nid à traumas autant qu’à la société, en zoomant sur les manifestations insurrectionnelles de sa banlieue d’origine, mais aussi sur la sécheresse de la forêt bruxelloise et les risques de méga-feux qui menacent désormais la Belgique.
Trois portes d’entrée – le corps physique, social et terrestre – organisées en un système de résonance dans une performance en trio qui tient du documentaire, de l’affabulation et de l’album de musique live dans une scénographie – conçue par Carolin Gieszner du collectif d’artistes touche—touche – entre îlots volcaniques, espaces marécageux et ambiances magmatiques. La première est prévue en septembre 2026 à Bruxelles, avant de rejoindre le Festival d’Automne à Paris en 2027, où elle sera de nouveau accueillie par le Théâtre de la Bastille. Un cap supplémentaire qui prolonge la recherche à la fois plastique, sonore et narrative effectuée sur Violences dans une dynamique qui s’ouvre à trois interprètes et élargit le sillon déjà tracé vers de nouvelles promesses.
Marie Plantin – www.sceneweb.fr





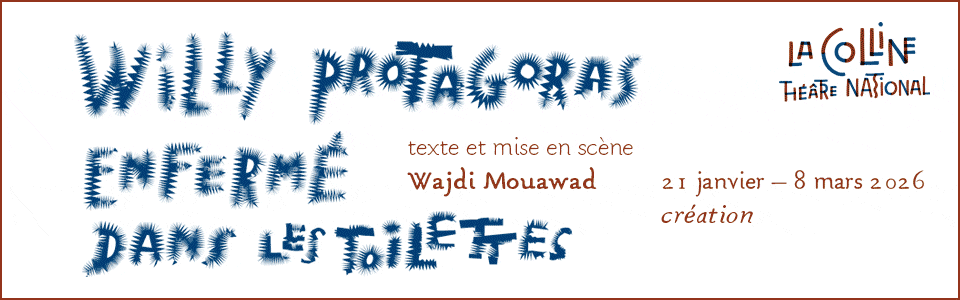




Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !