Touchant à la fin du « portrait » que leur consacre cette année le Festival d’Automne à Paris, Lina Majdalanie et Rabih Mroué y présentent une création inédite. En prenant pour matière l’exil du dramaturge allemand de 1933 à 1947, et en particulier son procès devant le Comité des activités anti-américaines (HUAC), le duo d’artistes libanais poursuit sa patiente et riche entreprise de questionnement de l’Histoire, de ses liens avec le présent.
Il arrive que l’écart qui existe entre le temps, la matière de la création artistique et le cours du monde prenne une densité particulière. La chose est rare, a fortiori sur les scènes théâtrales du moment, dont le goût prononcé pour le documentaire s’attache peu à cet interstice par définition inconfortable. Elle est donc d’autant plus précieuse lorsqu’elle advient, ce qui est le cas avec les six spectacles créés entre 2002 et les cinq « conférences non-académiques » que Lina Majdalanie et Rabih Mroué ont reprises depuis le 20 septembre dernier à l’invitation du Festival d’Automne à Paris, et l’est encore avec Quatre murs et un toit. Soit la première des deux nouvelles créations avec lesquelles les artistes viennent clore ce cycle d’autant plus exceptionnel que l’actualité est venue s’y mêler avec force, sans faire un instant ployer la proposition artistique dans une quelconque commisération ou autre facilité. L’art particulier du duo Majdalanie-Mroué, sa façon d’accumuler au fil du temps des performances anti-spectaculaires qui ne cessent d’interroger leurs propres procédés, autant que ceux que l’on utilise pour fabriquer l’Histoire – en général, et en particulier celle du Liban –, n’est pas de ceux qui peuvent se laisser dépasser par le réel, soit-il aussi violent que la récente attaque du Liban par l’armée israélienne.
Rompus, préparés à la folie du monde, dont leur pays ne cesse d’être victime depuis des années, Lina Majdalanie et Rabih Mroué créent des formes capables de s’en nourrir, d’y faire écho sans l’amoindrir ni en être elles-mêmes écrasées. Leur choix de travailler à l’endroit de l’écart évoqué plus tôt est pour beaucoup dans cette résistance que l’on a pu apprécier tout au long du festival parisien, et qui apparaît intacte, voire grandie, dans Quatre murs et un toit. Après une annonce de solidarité aux peuples palestiniens et libanais, le duo se réinstalle ici d’emblée dans le vrai-faux, qui est de longue date son terrain de jeu, sans cesse changeant, mais de façon subtile, le langage employé étant extrêmement minimaliste. En surgissant de l’obscurité, poussant sur une scène presque nue une petite table identique à celle qu’il utilise pour ses « conférences non-académiques », Rabih Mroué place d’abord la pièce à distance de tout référentiel réaliste. Installée à cour derrière un meuble rigoureusement similaire à celui de son binôme, Lina Majdalanie participe du même mouvement, de même que le complice qu’ils se sont adjoint pour cette aventure : le compositeur et pianiste allemand Henrik Kairies, qui ne quittera pas un instant son piano, comme tapi à jardin dans une semi-pénombre. Dans cette configuration initiale, rien ne dit de quoi il va retourner ensuite. Rien ne laisse présager qu’il va être question du dramaturge allemand Bertolt Brecht, qui ne cesse d’être monté en France, bien que l’ère théâtrale du temps soit moins brechtienne qu’elle a pu l’être.
Les artistes se saisissent de cette figure comme ils ont pu s’emparer plus tôt de l’histoire du Body Art dans Who’s Afraid of Representation (2007) ou fictionnaliser – plus ou moins – leur propre pratique théâtrale dans Biokhraphia en 2002 ou dans Riding on a cloud en 2013 : par le biais d’un dispositif très simple, qui tient autant du rituel que de la performance. Ou plutôt, c’est ici une série de dispositifs que déploie le duo mué en trio. Il peut ainsi faire exister pleinement l’espace vide qui sépare chacun de ses membres, lesquels se détachent de la scène tels des îlots isolés dérivant parfois les uns vers les autres, et surtout s’approcher métaphoriquement de son sujet. Car le Brecht que convoquent ici Lina Majdalanie et Rabih Mroué est comme eux, qui vivent depuis 2013 à Berlin : en exil. Bien que choisie par les deux Libanais et subie par le dramaturge allemand, qui a fui le régime nazi en 1933, cette situation génère de la distance et un manque du pays natal qui constituent dans Quatre murs et un toit un pont entre les cultures et les époques. C’est ainsi, sans s’embarrasser d’explications superflues, que Rabih Mroué déplace d’entrée de jeu le cadre de la conférence qu’il a installé en hâte pour se lancer dans une lecture qui tient de la profération : celle des questions adressées à Brecht lors de son procès en 1947 devant le Comité des activités anti-américaines (HUAC), dans le cadre d’une enquête concernant l’infiltration communiste dans l’industrie cinématographique américaine.
Les nombreuses et insistantes interrogations qu’énumère Rabih Mroué – « Et maintenant Monsieur Brecht, quelle est votre occupation ? », « Quelle place, quel rôle jouez-vous dans la lutte des classes ? »… – échappent au passé pour venir habiter l’espace complexe, ambigu qu’est celui du spectacle. Elles rejoignent toutes les archives liées à l’Histoire libanaise que le couple ne cesse de brasser dans son travail, donnant vie à leur manière au mythe du phénix, qu’ils disent eux-mêmes central dans l’imaginaire libanais. Dans l’apparent tremblement, qui est une autre de leurs marques de fabrique et les ancre fortement au présent en dépit de tout le passé qu’ils charrient de pièce en pièce, ils réactivent les blessures de Brecht à la lumière de leur époque et de leur subjectivité tout à fait assumée. Les chapitres suivants, dont les titres s’affichent sur un écran, où sont aussi projetées toutes les images du PowerPoint très finement théâtralisé que se révèle être Quatre murs et un toit, ne nous font guère avancer dans le parcours du dramaturge. Il s’agit plutôt de faire de son exil un objet critique, ce qu’aurait sans doute apprécié cet homme dont la révolution artistique a consisté à faire du théâtre un espace de pensée et non de simple partage des idées et des savoirs.
La grande intelligence de la proposition repose aussi beaucoup sur sa dimension ludique et sur un absurde d’autant plus efficace qu’il ne se montre jamais comme tel, mais se donne à débusquer, à démasquer. Si les chansons de Brecht interprétées en direct par le pianiste confèrent une certaine patte « authentique » au spectacle, celle-ci est subtilement contredite par les nombreuses manœuvres scientifiquement très douteuses auxquelles se livre le duo. En faisant appel à l’intelligence artificielle pour nous montrer Brecht lire lors de son procès une déclaration écrite pour l’occasion – mais non prononcée, l’assemblée n’ayant alors pas voulu y prêter l’oreille –, ou en ayant recours à un logiciel de traitement d’images pour reconstituer, à partir d’une image de 1933, une photo du dramaturge en 1947 dont elle n’a pas eu les droits, l’association Majdalanie-Mroué réalise de nouveau un excellent coup. La notion de « cold exterminating » (ou « destruction froide ») qu’elle développe, pour qualifier la censure réservée aux artistes du temps de Brecht, résonne d’une façon particulière dans le contexte français de mise à mal de la Culture par des coupes budgétaires et de chute du gouvernement qui survenait le soir même de la première.
Anaïs Heluin – www.sceneweb.fr
Quatre murs et un toit
Texte Lina Majdalanie, Rabih Mroué avec des extraits de Bertolt Brecht
Mise en scène Lina Majdalanie, Rabih Mroué
Avec Henrik Kairies, Lina Majdalanie, Rabih Mroué
Dramaturgie Sandra Noeth
Musique Hanns Eisler, Henrik Kairies
Chansons Bertolt Brecht, Hanns Eisler
Concepteur lumière et directeur technique Thomas KöppelProduction déléguée Festival d’Automne à Paris
Coproduction CENTQUATRE-PARIS ; Künstler*innenhaus Mousonturm (Francfort) ; Residenz-Schauspiel Leipzig ; HAU Hebbel am Ufer (Berlin) ; Berliner Festspiele dans le cadre de Performing Exiles (Berlin) ; Kampnagel (Hambourg) ; Kunstenfestivaldesarts (Bruxelles) ; Forum Freies Theater (Düsseldorf)
Soutenu dans le cadre de l’Alliance des Maisons de Production Internationales par la Commission du Gouvernement Fédéral pour la Culture et les MédiasLes extraits littéraires de Bertolt Brecht sont tirés de ses recueils Poèmes 1 & 3 (traductions de Gilbert Badia, Claude Duchet, et Maurice Regnaut) et de sa pièce Dialogues d’exilés (traduction Gilbert Badia et Jean Baudrillard), L’Arche, éditeur & agence théâtrale.
Durée : 1h40
Centquatre-Paris, dans le cadre du Festival d’Automne à Paris
du 4 au 8 décembre 2024
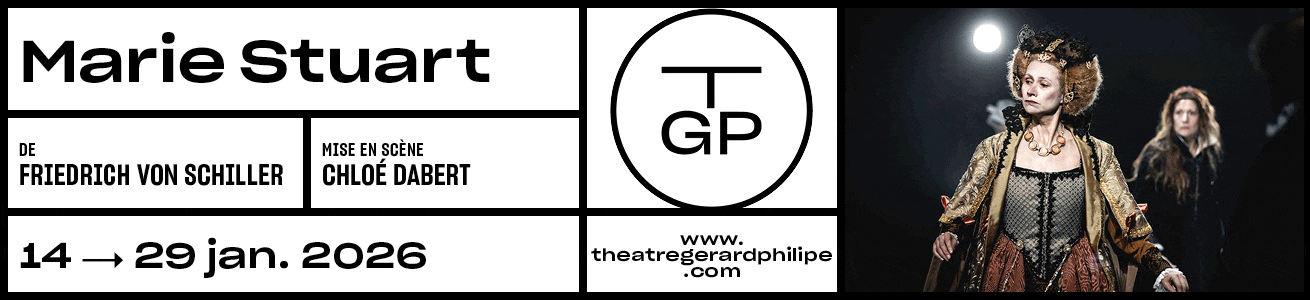

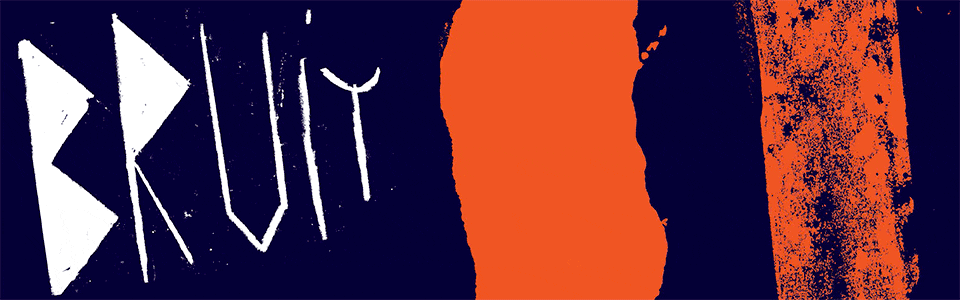


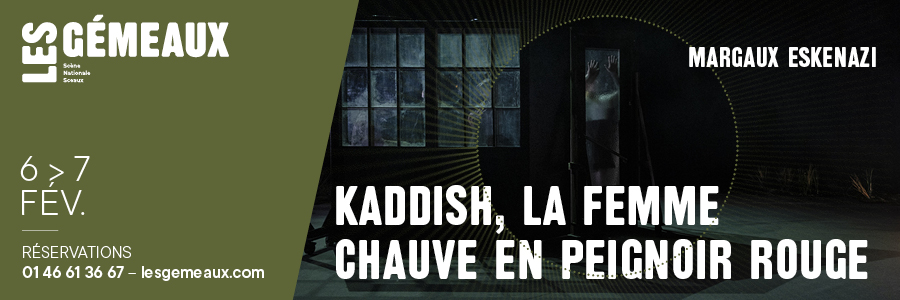


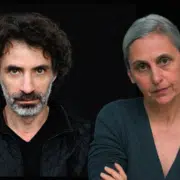





Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !