Le Papier peint jaune rend grâce à l’acuité de l’écriture de Charlotte Perkins Gilman. Dans un écrin scénographique hautement expressif, Laëtitia Poulalion donne à ce monologue fascinant une clarté nouvelle.
Ecrite à la fin du XIXème siècle par Charlotte Perkins Gilman, autrice américaine, Le Papier peint jaune est une nouvelle imprégnée d’autobiographie, qui s’inspire de ce qu’on nomme désormais la dépression post partum pour dénoncer des méthodes médicales d’un autre âge, inhibantes et castratrices, le fardeau des conventions sociales et des rôles assignés. Une femme, jeune mère, s’y voit isolée dans la chambre à l’étage d’un manoir loué pour son repos. Tandis qu’une nourrice s’occupe de son bébé, elle écrit, malgré l’opposition de son mari à toute activité intellectuelle de sa part, et tandis qu’elle réfléchit en continu sur son sort, ses états intérieurs se mêlent à l’observation minutieuse du papier peint jaune de la pièce, source d’émulation artistique autant que de terreur esthétique qui vire à l’obsession pure. C’est un écrit d’un autre siècle, bref et incisif, qui taille dans les circonvolutions mentales d’une femme, comme un journal intime à ciel ouvert, et nous entraîne dans une spirale infernale, faisant du glissement dans la folie la matrice d’un récit fantastique. Il y a dix ans, aux Ateliers Berthier, se jouait Die Gelbe Tapete, adaptation par la metteuse en scène Katie Mitchell de cette même nouvelle transposée dans le Berlin du XXIème siècle à grand renfort de caméras avec montage et son en direct. Une armada technique qui contribuait magnifiquement à l’atmosphère oppressante de la nouvelle, jouait sur le dédoublement de l’héroïne et accentuait son enfermement et son délire.
A la tête de la Compagnie La Patineuse, Laëtitia Poulalion, accompagnée à l’adaptation et la mise en scène par Mathilde Levesque, s’empare de ce texte autrement, sobrement, avec une précision et une justesse remarquables. Il s’agit du premier projet de la compagnie, créée seulement en 2022 et celui-ci se pose comme la pierre angulaire d’une démarche qui s’inscrit dans une réflexion plus large autour du poids de nos héritages et leur impact dans nos vies intimes. Seule au plateau Laëtitia Poulalion porte ce texte de façon magistrale. L’éventail de sa palette expressive, les modulations de sa voix et sa gestuelle, toute en grâce et dignité, comme un nuancier de couleurs offrant un dégradé raffiné, donnent à son jeu une envergure subtile. A l’image de ce chemisier en dentelle ajouré, épaules et manches bouffantes, resserré au niveau des poignets et du cou, qui dit avec une finesse exquise l’époque, la condition sociale et l’oppression exercée sur cette femme, la partition de Laëtitia Poulalion, toute en brisures de rythme, avance en équilibriste sur le fil de l’intensité et de la retenue. Visage diaphane, tantôt exalté, tantôt terrorisé, elle nous cueille dès l’entrée de son regard paradoxal, tout à la fois perdu et vibrant, connecté et dépassé. Cette femme en lutte pour exister, qui n’a pas renoncé, écartelée entre l’obéissance soumise à la volonté de son mari « pragmatique », médecin qui plus est, et son besoin d’exprimer cette puissance de vie qui l’anime, est comme un petit animal pris au piège de sa cage qui, sous nos yeux, se débat. Et ses pensées, agitées par le tumulte de ses états intérieurs mouvants, alertes et perspicaces au début, peu à peu déraillent et l’on assiste, impuissant, à la descente aux enfers d’une femme qui perd pied avec le réel.
La bande sonore et musicale d’Emilie Tramier et Alexandre Saada accompagne impeccablement cette détresse en route vers la dérive. Les bruits d’oiseaux et d’enfants joviaux, de souffle rapide et de machine à écrire, de l’entrée en matière se transforment en une musique de plus en plus inquiétante, avec des motifs mélodiques récurrents, des voix chuchotées en écho aux mots prononcés à voix haute par notre hôte. Seule et isolée sur ce parquet de bois minuscule, comme un radeau au milieu du plateau, qui accueille un matelas pour unique mobilier, Laëtitia Poulalion, fantomatique et incarnée, évolue dans une robe camisole qui depuis la taille s’accroche aux draps du lit. Prolongement de son corps, la literie immaculée est la page blanche évocatrice de son enfermement forcé. Littéralement clouée au lit, la malade n’a pas d’échappatoire. Prolongement du décor, ce costume d’une pertinence folle (signé Mariannick Poulhes) a la force tranquille de l’évidence. Symbolique plus qu’illustratif, il raconte à lui seul le tiraillement, l’empêchement, le poids et l’entrave à la liberté d’action. Le corps même de l’actrice est corseté, emmaillotté tandis que le personnage est infantilisé par un mari dont la gentillesse masque à peine la toute-puissance. Et le malaise qui l’étreint nous atteint. Ce geste scénographique admirable (signé Sandrine Lamblin) zoome sur l’essentiel et en extrait ce tableau vivant fascinant. Le fameux papier peint jaune n’est pas représenté ici et pourtant on l’imagine, on le voit, sa présence mentale n’a d’égale que la description subjective et détaillée qui en est faite dans le texte. Incomprise et démunie, dénuée de libre-arbitre, cette épouse et mère se jette à corps perdu sur ce papier peint maudit, surface de projection infinie de ces fantasmes et de ses angoisses. Jusqu’à se confondre avec la vision hallucinatoire d’une femme qui rampe en dessous. Métaphore de son étouffement. On pense alors à certaines images de la photographe américaine Francesca Woodman, corps nu effacé dans un décor qui l’engloutit, disparaissant à moitié derrière des tranches de papier peint. Emmurée vivante. Et pourtant irradiant de présence absente.
Affutée jusqu’à l’os, la représentation se clôt sur une élévation, comme pour mieux contrer l’enlisement qui s’y trame et inverser le goût amer que nous laisse cette noyade. Sur cette tête de lit couleur rouge feu sur laquelle dépassent branches et racines d’arbres, la prisonnière au lieu de sombrer s’accroche et se hisse sur son propre bûcher. Au-dessus de nous, au-dessus de sa condition. Elle prend de la hauteur sur la situation et cette conclusion offre une lecture neuve qui va dans le sens d’un dépassement de soi, tandis que sa jupe se déploie, verticale, immense et sculpturale.
Marie Plantin – www.sceneweb.fr
Le Papier Peint Jaune
Création 2024
Autrice Charlotte Perkins GilmanTraduction Marine Boutroue et Florian Targa
Adaptation Lætitia Poulalion et Mathilde Levesque
Mise en scène Lætitia Poulalion et Mathilde Levesque
Jeu Lætitia Poulalion
Scénographie Sandrine Lamblin
Création sonore Émilie Tramier
Musiques Alexandre Saada
Lumières Richard Arselin
Travail corporel Leïla Gaudin
Costumes Mariannick Poulhes
Production La Patineuse
Soutiens Super Théâtre Collectif – Studio Théâtre de Charenton / Artéphile – Avignon / La Manekine – scène intermédiaire des Hauts de France / Théâtre de la Jacquerie / La Louisiane SAPartenaires Théâtre de La Reine Blanche – scène des arts et des sciences
Durée : 1h10
Off 2024
Théâtre Transversal
du 29 juin au 21 juillet 2024
à 14h20





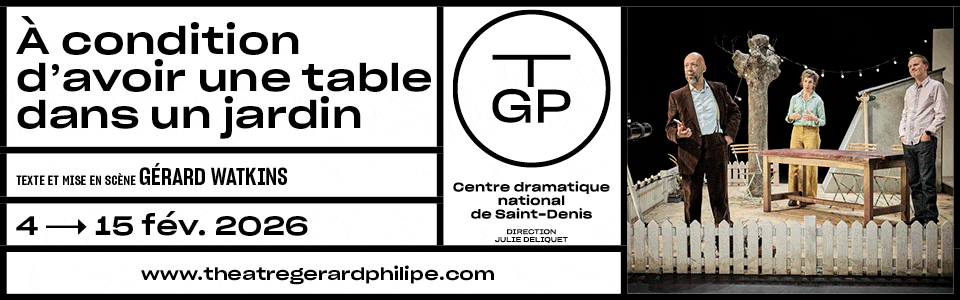





Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !