Génération sceneweb (13/30). Du Théâtre 13 à la Comédie-Française, en passant par le Théâtre de Odéon et la Comédie de Saint-Etienne, la patronne d’In Vitro aura, ces dix dernières années, tracé son sillon, jusqu’à s’installer à la barre du Théâtre Gérard-Philipe, dans un contexte plus tempêtueux qu’attendu.
Pour expliquer son ascension théâtrale de la dernière décennie, Julie Deliquet ne croit pas à la simple puissance du hasard, ni à la magie du « bon endroit au bon moment ». « Cela nous a demandé beaucoup de travail, même si nous avons bénéficié de ce mouvement artistique collectif, de cette vague qui, alors qu’elle n’était pas conscientisée à l’époque, a marqué, à sa manière l’histoire du théâtre, explique-t-elle. Celle de ces groupes qui ont coexisté les uns avec les autres, ont cherché à mettre l’acteur à un endroit premier, avec souvent peu de moyens financiers, fléchés en priorité sur les salaires. » Son collectif, In Vitro, créé en 2009, appartient à cette mouvance et en est rapidement devenu l’une des figures de proue.
Passée, en à peine dix ans, du Théâtre 13, où elle avait obtenu le Prix du public dans la catégorie « jeunes metteurs en scène » pour son adaptation de Derniers remords avant l’oubli de Jean-Luc Lagarce, au Théâtre de l’Odéon avec Un conte de Noël, d’après le film d’Arnaud Desplechin, Julie Deliquet réfute toute idée de fulgurance. « Tout a été, au contraire, très progressif et à rebond, assure-t-elle. J’ai simplement eu la chance de ne pas descendre de marche et d’être en progression constante, avec des moyens peu à peu supérieurs grâce au soutien du TGP, du CDN de Lorient ou de la Comédie de Saint-Etienne. Le seul tournant serait, peut-être, mon exposition à la Comédie-Française, avec Vania et Fanny et Alexandre, qui m’ont donné l’occasion de toucher un autre public. »
Surtout, la metteuse en scène n’a pas ménagé ses efforts. Elle aura créé à un rythme que d’aucuns qualifieraient d’effréné, à raison d’un spectacle par an. « J’ai, effectivement, créé un répertoire et mes premiers spectacles ont joué pendant sept ans, en permanence, ce qui était très calculé de ma part, précise-t-elle. Si je crois beaucoup à l’idée de parcours, je n’ai, en revanche, jamais de plan d’avance. A chaque fois que je fais un spectacle, je pense que ce sera le bon, mais mon insatisfaction permanente aiguise un appétit qui n’est jamais comblé. En créant plus, je crois aussi que j’ai moins peur. Sur une même saison, je peux préparer trois titres dans trois structures différentes car c’est moins paralysant de mon point de vue que d’imaginer pendant deux ans un objet unique. Réaliser un spectacle doit toujours être pour moi quelque chose de léger, sinon, j’ai moins d’appétit. »
L’inspiration souterraine du réel
Pourtant, les substrats textuels dont elle fait son miel, de Lagarce à Tchekhov, de Desplechin à Bergman, semblent à première vue tout sauf « légers », et plutôt en prise avec ce réel qui bouleverse la cellule familiale, sa logique de transmission et son intimité profonde. « Même si je suis de plus en plus dans une logique d’ouverture par rapport au monde, je ne mène aucune action de manière frontale en tant qu’artiste, précise-t-elle. Alors que je suis profondément féministe, je serais incapable de faire un spectacle sur le féminisme car une telle gravité m’inhiberait. Ces questions influent surtout de manière souterraine et ne sont jamais au premier plan. Je ne peux pas faire sans le réel, mais j’ai toujours besoin de le transformer, grâce à la fiction. » Une logique qui présidera, une nouvelle fois, dans son prochain spectacle, consacré à l’autogestion et à l’organisation marxiste de la société, une sorte d’œuvre militante qui, si elle ne doit rien au hasard dans le contexte actuel, n’en aurait pas les contours.
Arrivée à la tête du Théâtre Gérard-Philipe en mars dernier, quelques jours seulement avant l’explosion de la crise du Covid-19, Julie Deliquet cherche aujourd’hui à tirer le meilleur de ce baptême du feu, plus extrême qu’attendu. « La situation est évidemment difficile, épuisante, et nous devons traiter beaucoup de problèmes sans toujours trouver de solutions, mais elle génère chez moi une insolence terrible et un foisonnement d’idées, affirme-t-elle. En traversant ce qui se passe à un point névralgique, je comprends, à la fois, la solidité et la fragilité de nos belles maisons, et ai parfois l’impression de retrouver l’effervescence de ce garage non chauffé où, en 2009, nous avons créé notre compagnie. »
Vincent Bouquet – www.sceneweb.fr





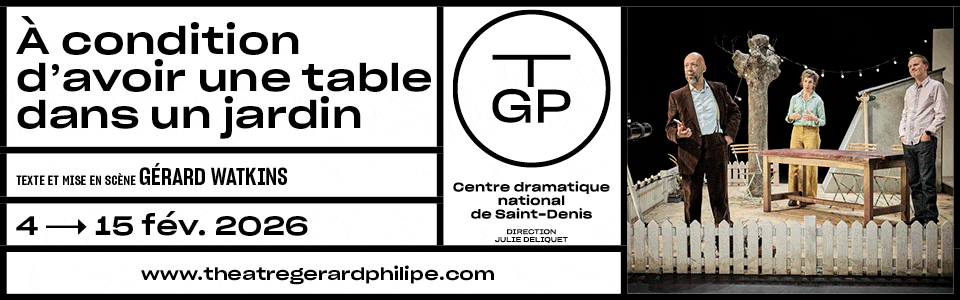








Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !